FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
Vous ne trouvez pas la réponse dans cette section ? Posez-nous votre question !
Chercher une question
| Europe
L’European Board for Media Services (Conseil européen des services de médias), ou “Media Board Européen, est un nouvel organe indépendant prévu par l’European Media Freedom Act (EMFA) qui existait précédemment sous la nommination ERGA. Il est composé de représentants des autorités nationales de régulation des médias de chaque État membre, dont le CSA. Son rôle principal est de renforcer la coopération entre ces autorités et de veiller à l’application cohérente des règles européennes en matière de liberté des médias et de pluralisme, mais aussi d’assurer le suivi et l’implémentation des grands projets législatifs européens, dont la directive SMA. Le Media Board peut rendre des avis sur les mesures nationales ayant un impact sur les médias, évaluer les risques liés à la concentration dans le secteur, et contribuer à la protection contre les ingérences étatiques ou étrangères. Il peut aussi formuler des recommandations, émettre des lignes directrices, et agir en tant que garant du respect de l’indépendance éditoriale des médias dans toute l’Union. L’objectif est de créer un espace médiatique européen plus transparent, équitable et résilient face aux pressions politiques ou économiques.
La directive SMA établit un cadre commun pour tous les services audiovisuels en Europe, y compris les chaînes de télévision, les services de vidéo à la demande (comme Netflix) et les plateformes de partage de vidéos (comme YouTube). Elle garantit la protection des mineurs, interdit les discours haineux, et promeut la diversité culturelle européenne. Elle impose également des quotas de contenus européens dans les catalogues et assure une régulation cohérente entre les médias traditionnels et les services numériques. Chaque État membre adapte la directive dans son droit national tout en respectant les grands principes communs de liberté d’expression et de pluralisme.
Ce règlement vise à encadrer la publicité politique en ligne, notamment pendant les périodes électorales. Il impose des règles strictes de transparence : toute publicité politique devra clairement indiquer qui la finance, quel est son objectif, et à quel public elle est destinée. Il encadre aussi le microciblage basé sur les données personnelles, afin de prévenir la manipulation électorale et garantir un débat démocratique équitable. Les plateformes devront conserver et publier les données liées à ces publicités pendant plusieurs années.
Le DSA est un règlement européen qui impose des obligations aux plateformes numériques (comme les réseaux sociaux, places de marché en ligne, moteurs de recherche) pour lutter contre les contenus illicites, la désinformation et améliorer la transparence des algorithmes. Les très grandes plateformes doivent évaluer et atténuer les risques systémiques, fournir aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils voient, et offrir des mécanismes de signalement plus clairs. L’accent est mis sur la responsabilité, la sécurité en ligne et la protection des droits fondamentaux.
L’European Media Freedom Act vise à protéger l’indépendance des médias dans l’Union européenne. Il interdit notamment toute pression politique ou interférence des gouvernements sur les journalistes et les éditeurs. Il impose plus de transparence sur la propriété des médias et renforce la sécurité des journalistes, y compris contre la surveillance illégale. Cette législation est à l’origine de la création de l’ European Board for Media Services (Media Board), un organe indépendant chargé de surveiller les pratiques des États membres dans lequel le CSA s’investit fortement. L’objectif est d’assurer un marché unique des médias pluraliste, transparent et libre dans l’ensemble de l’UE.
| À propos du CSA
Le CSA est chargé de la régulation du secteur de l’audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). La régulation est une intervention qui vise à maintenir un système économique ou social dans un état réputé souhaitable via une action appropriée et dosée. Un régulateur se doit donc d’intervenir de manière équilibrée et proportionnelle. Pour exercer ses missions de régulation, le CSA agit par le biais de deux organes :
- Le Collège d’avis, qui est un organe composé de membres issus du secteur de l’audiovisuel. Il peut rendre des avis, mais aussi élaborer des codes de conduite et adopter des règlements dans certains domaines bien spécifiques ;
- Le Collège d’autorisation et de contrôle, qui est un organe composé de personnes ayant une expertise en matière audiovisuelle mais non directement issues du secteur régulé. Il peut autoriser certains acteurs du paysage audiovisuel à exercer leurs activités, et exerce également un rôle de contrôle du respect par chacun de ses obligations. Plus précisément :
- Il acte les déclarations des éditeurs de services télévisuels et sonores ainsi que des fournisseurs de services de partage de vidéos, et autorise l'usage de radiofréquences en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ;
- Il contrôle le respect des obligations des éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos. À cette fin, le Secrétariat d'instruction du CSA reçoit et instruit toutes les plaintes du public concernant les programmes radio ou de télévision (atteinte à la dignité humaine, protection des mineurs, violence gratuite, …) et les soumet au Collège d'autorisation et de contrôle, qui peut constater l'infraction et, le cas échéant, la sanctionner ;
- Il s'assure que tous les éditeurs de services (radios et télévisions), les distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos respectent les lois et la réglementation en vigueur. Le CSA (via son Collège d'autorisation et de contrôle) est, par conséquent, compétent pour constater et sanctionner les éventuelles infractions à ces obligations ;
- Il rend, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la FWB, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel ;
- Il adopte des recommandations de portée générale ou particulière.
Le « décret SMA » désigne le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Ce décret remplace l’ancien décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels : il reprend une grande partie de ses dispositions mais y apporte également des modifications et des nouveautés. Le décret SMA est un texte à valeur législative, adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), qui régit la matière de l’audiovisuel en FWB. Une partie des règles qu’il contient transposent des règles issues de directives européennes. Il s’applique à tous les éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos qui relèvent de la compétence territoriale de la FWB, et encadre leurs activités en les soumettant à un certain nombre de règles concernant par exemple la communication commerciale, la protection des mineurs, l’interdiction des discours de haine au sens large, le soutien à la production, etc. Il fixe également des règles formelles organisant la déclaration ou l’autorisation auxquelles sont soumis les différents régulés. Enfin, il organise le contrôle de toutes ces règles par le CSA. Le décret SMA est la principale source de droit de l’audiovisuel en FWB mais il est également complété par d’autres sources telles que, notamment, des arrêtés d’exécution, le contrat de gestion de la RTBF, etc.
Le Collège d’avis (CAV) est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Bureau. Il se compose de maximum vingt-quatre membres effecti.f.ve.s : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que vingt autres membres (maximum). Ces vingt derni.er.ère.s membres ont chacun.e un.e suppléant.e. Ils et elles sont désigné.e.s par le Gouvernement, de façon à assurer la représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d’une des tendances ou d’un ensemble de groupements d’utilisateurs se réclamant d’une même tendance. Sauf en ce qui concerne les membres du Bureau, désigné.e.s pour cinq ans, leur mandat est de quatre ans, et est renouvelable. Le CAV est l’organe de co-régulation du CSA, ce qui signifie qu’il fait participer des représentants du secteur régulé à l’exercice de missions de régulation. Dès lors, les vingt membres hors-Bureau du CAV représentent différentes catégories d’éditeurs (la RTBF, les TV privées, différentes catégories de radios, etc.), les distributeurs, opérateurs et fournisseurs de services de partage de vidéos. A côté de ces vingt membres ayant voix délibérative (et leurs suppléant.e.s), certaines personnes peuvent également assister aux réunions du CAV mais avec une voix seulement consultative. Elles sont également désignées par le Gouvernement, ont aussi un.e suppléant.e, et représentent différentes catégories socio-professionnelles qui ne sont pas régulées directement par le CSA mais qui participent à l’écosystème des médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit notamment de représentant.e.s des product.eur.rice.s indépendant.e.s, du Conseil de déontologie journalistique ou encore de l’Association des journalistes professionnel.le.s. Le Collège d’avis ne se réunit pas sur une base régulière, mais à chaque fois que son intervention est requise par le Parlement, le Gouvernement ou le CAC, ou lorsqu’il décide d’agir d’initiative. Ses compétences sont les suivantes :
- Adopter des codes de conduite pour uniformiser et renforcer les bonnes pratiques au sein du secteur ;
- Adopter, dans certains domaines particuliers limitativement énumérés (notamment l’information politique en période préélectorale), des règlements destinés ensuite à être rendus obligatoires par le Gouvernement ;
- Rendre des avis sur toute question relative à l’audiovisuel et ne relevant pas de la compétence du CAC ;
- Rendre un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international ;
- Rendre un avis préalable sur certaines questions spécifiques liées aux opérateurs de réseaux.
Non. Chaque éditeur de services décide librement de la programmation des services qu'il propose, en fonction notamment des publics qu'il souhaite toucher et des moyens financiers dont il dispose. C’est ce qu’on appelle la liberté éditoriale, qui découle du principe plus large de la liberté d’expression. Cette liberté connaît cependant certaines limites qui visent notamment à protéger certains publics ou à assurer un juste équilibre avec l'exercice d'autres libertés démocratiques. Mais ces limites ne sont pas fixées par le CSA ; elles sont fixées par des textes législatifs, éventuellement complétés par des textes réglementaires. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est essentiellement le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos qui fixe ces limites. Ce décret, adopté par le Parlement, encadre la liberté d’expression des éditeurs de services de médias audiovisuels (SMA). Si un éditeur de SMA ne respecte pas ces règles, le CSA pourra intervenir pour le sanctionner, mais cette intervention se fait toujours a posteriori, en cas d’infraction. Il ne s’agit donc pas d’une intervention a priori dans la programmation. Voir aussi : Le CSA censure-t-il ?
Le CSA est compétent pour réguler tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relèvent de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Depuis l’entrée en vigueur du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, il est également compétent pour réguler tout fournisseur de services de partage de vidéos et tout fournisseur de services de communications électroniques relevant de la compétence de la FWB (article 1.1-2 du décret du 4 février 2021). Ce domaine de compétence du CSA comporte une dimension matérielle et territoriale :
- D’un point de vue matériel, tomberont dans la compétence du CSA les personnes qui répondent à la définition d’éditeur de services, de distributeur de services, d’opérateur de réseau, de fournisseur de services de partage de vidéos, ou de fournisseur de services de communications électroniques : sur ces questions, il est renvoyé aux FAQs qui définissent ces notions.
- D’un point de vue territorial, ces personnes ne tomberont dans la compétence du CSA que si elles relèvent de la compétence de la FWB : sur ces questions, les règles de compétence territoriale sont résumées ci-dessous.
- à un réseau de communications électroniques hertzien utilisant une ou des radiofréquences de la FWB ;
- à un réseau de télédistribution situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l’activité est rattachée exclusivement à la FWB ;
- à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la FWB ;
En théorie, le CSA peut bénéficier de cinq types de ressources (art. 9.1.6-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos) :
- une dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- une dotation complémentaire spécifique, destinée à couvrir les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions, mais qui n'est versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA ;
- les dons et legs faits en sa faveur ;
- les revenus de ses biens propres ;
- les subventions octroyées dans le cadre de missions spécifiques non couvertes par le contrat de financement.
Après une procédure d'instruction ou un avis annuel constatant un ou des griefs, la notification de griefs par le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC), et l'éventuelle comparution du contrevenant, le CAC peut, en appréciant les faits, prononcer une sanction dans les cas suivants :
- Violation des lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ;
- Manquement(s) aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’éditeur ou le distributeur mis en cause ;
- Manquement(s) à son contrat de gestion par la RTBF ;
- Manquement(s), par un média de proximité, à la convention qu’il a conclue avec le Gouvernement ;
- Manquement(s) à des engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres (dont notamment les appels d'offres visant à l’autorisation des éditeurs de services sonores en FM et/ou en DAB+) ;
- Non-exécution d'une sanction prononcée par le Collège d'autorisation et de contrôle.
En vertu de son statut d’autorité administrative indépendante, le CSA ne peut recevoir d'injonction directe d'aucune autorité publique ou privée. En revanche, il peut rendre, d'initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, des avis ou faire des recommandations de portée générale ou particulière sur des questions relatives à l'audiovisuel. Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA ainsi que les membres du personnel du CSA sont soumis à un régime d'incompatibilités et de règles déontologiques destinés à éviter des conflits d'intérêts lors de l'exercice des missions du CSA. En outre, le personnel du CSA est soumis à un code de bonne conduite administrative dans ses relations avec le public. Sur le plan budgétaire et financier, le CSA est soumis à un contrôle de ses comptes annuels par la Cour des comptes et par un commissaire aux comptes, nommé parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise. En amont, les décisions prises par l’organe de gestion du CSA (le Bureau) sont contrôlées par un commissaire du gouvernement. Le pouvoir de ce dernier se limite toutefois à un contrôle de pure légalité et, contrairement aux commissaires de gouvernement désignés dans d’autres organismes, il n’exerce pas de contrôle d’opportunité. Quant aux décisions prises par le Collège d'autorisation et de contrôle dans le cadre de ses compétences régulatoires, elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. De façon plus générale, le CSA publie annuellement un rapport d'activités, qui est communiqué au Parlement et au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est l'occasion d'un échange de vues sur l'exécution des missions du CSA avec la Commission de l'audiovisuel du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, interlocuteur naturel et régulier du CSA sur les questions audiovisuelles. Enfin, le CSA poursuit une politique de relations avec le public marquée par une transparence de ses actes et de ses documents administratifs en publiant ses avis et décisions sur son site internet et par le biais de ses outils d'information et de communication :
- newsletters ;
- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
- webzine Régulation et mini sites thématiques;
- publications ponctuelles relatives à certaines activités du CSA.
En droit, la censure se définit comme l’exigence d’une autorisation préalable de l’autorité pour pouvoir réaliser une publication. Elle est interdite par l’article 25 de la Constitution. Le CSA n’exerce donc pas de censure : il n’intervient jamais a priori sur les programmes des éditeurs de services. Il peut, par contre, intervenir a posteriori. En effet, même si le principe de la liberté d’expression permet à chaque éditeur de décider en toute liberté du contenu et de l’organisation de ses services, il doit le faire dans le respect de certaines limites qui sont apportées à cette liberté par le législateur. Un des objectifs poursuivis par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos est d’encadrer la liberté d’expression des éditeurs de services et des utilisateurs qui diffusent des vidéos sur les services de partage de vidéos, en y mettant certaines limites qui visent notamment à protéger certains publics ou à assurer un juste équilibre avec l'exercice d'autres libertés démocratiques. Si ces limites ne sont pas respectées par les éditeurs de services ou si les fournisseurs de services de partage de vidéos ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger leurs utilisateurs, ils pourront être sanctionnés a posteriori par le CSA. Ces limites sont notamment prévues aux articles 2.3-1 et 2.3-2 du décret du 4 février 2021 susmentionné. Ils interdisent la diffusion de contenus
- contraires aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général ;
- portant atteinte à la dignité humaine ;
- contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste ;
- favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou visant à abuser de la crédulité du public ;
- tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide ;
- constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie ;
- constituant des infractions liées à la pédopornographie
Pour remplir ses missions, le CSA se doit d'être indépendant à la fois du pouvoir politique et des acteurs (publics et privés) du secteur audiovisuel. C'est pourquoi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle (CAC) ainsi que les membres du personnel du CSA sont soumis à un régime d'incompatibilités et de règles déontologiques destinés à éviter des conflits d'intérêts lors de l'exercice des missions du CSA. Les incompatibilités sont permanentes : toute personne qui se trouve dans une situation d’incompatibilité ne peut pas (ou plus) être membre du CAC ou du personnel du CSA. Les situations suivantes sont listées dans la législation comme causes d’incompatibilité (article 9.1.2-7, §§ 2 et 3 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos) :
- la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional ;
- la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional ;
- la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire ;
- la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial ;
- la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ;
- avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services, de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel ;
- la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés ;
- le fait d’avoir été condamné ou d’avoir appartenu à un organisme condamné pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide.
Une permanence téléphonique est assurée entre 9h et 16h sur le numéro principal du CSA le 02.349.58.80. En dehors de ces heures et en cas d’absence, un répondeur permet à chacun et chacune de laisser un message et ses coordonnées pour être recontacté.e dans les meilleurs délais. Pour tout appel sur une ligne téléphonique direct d’un membre du personnel, il est également préférable d’appeler dans cette tranche horaire. En cas d’absence de réponse, soit en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions en cours, de télétravail ou encore de congés, n’hésitez pas à rappeler à un autre moment ou à adresser un mail à cette personne. Les coordonnées des membres du personnel sont accessibles via le lien suivant : https://www.csa.be/membres/ Si vous souhaitez nous visiter, il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la question: “Comment me rendre au CSA?”
L’accès aux bureaux du CSA est relativement simple mais il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. En effet, si vous venez spontanément nous ne pouvons vous garantir de pouvoir vous recevoir en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions planifiées, de télétravail ou encore de congés. Il n’est par ailleurs dans la plupart des cas pas nécessaire de vous déplacer. L’ensemble du personnel veille à répondre à toute prise de contact (mail, courrier postal, téléphone, …) dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à privilégier ces modes de contact. Pour obtenir un rendez-vous ou prendre contact avec le CSA, veuillez consulter la question: “Comment joindre le CSA?” Si vous deviez nous rejoindre à nos bureaux, ceux-ci se trouvent au 89 Rue Royale à 1000 Bruxelles. La gare de train la plus proche (moins d’1 km à pied) est la gare de Bruxelles-Centrale. Si vous préférez nous rejoindre par transport en commun:
- depuis la gare centrale, bus 29 63 65 et 66 (jusqu’à Treurenberg)
- depuis l’arrêt Palais tram 92 93 (jusqu’à Congrès)
- depuis la gare du Nord bus 270 271 272 318 351 358 410 (jusqu’à Botanique)
- depuis l’arrêt Ste-Marie tram 92 93 (jusqu’à Congrès)
Le site du CSA comporte un formulaire qui vous permet d’introduire une question. Cette question sera directement transmise à la personne ou au service le plus à même de vous répondre et qui vous répondra dans les meilleurs délais. https://www.csa.be/posez-une-question/ Les adresses générales du CSA qu’elle soient postale, téléphonique ou email peuvent également être utilisées. Elles sont gérées de manière dynamique et permettent que toute prise de contact arrive également à la personne ou au service le plus à même de vous répondre. Conseil supérieur de l’audiovisuel - Rue Royale 89, 1000 Bruxelles – 02.349.58.80 - info@csa.be Enfin, la page organigramme de notre site internet liste l’ensemble des membres du personnel et leurs coordonnées. Si vous pouvez identifier clairement la personne ou le service que vous souhaitez joindre, n’hésitez pas à utiliser ces coordonnées. https://www.csa.be/membres/
Le Bureau est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de quatre membres, à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), qui sont tou.te.s désigné.e.s par le Gouvernement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Les quatre membres du Bureau sont également membres du Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et du Collège d’avis (CAV). Le Bureau se réunit en moyenne une fois par mois. C’est l’organe de gestion du CSA. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
- Il coordonne et organise les travaux du CSA
- Il représente le CSA en justice et à l’égard des tiers
- Il conclut les contrats au nom du CSA
- Il chapeaute les relations internationales du CSA
- Il recrute le personnel du CSA
- Il assure la gestion financière du CSA
Le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) est l’un des trois organes du CSA, avec le Bureau et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de dix membres : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que six autres membres. Certains de ces membres sont désignés par le Gouvernement, et d’autres sont désignés par le Parlement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans pour les membres du Bureau et de quatre ans pour les autres membres. Ces mandats sont renouvelables. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Le CAC se réunit en moyenne deux fois par mois et exerce, au sein du CSA, les compétences de régulation à proprement parler. Cela couvre notamment les compétences suivantes :
- Autoriser les éditeurs, distributeurs et opérateurs soumis à autorisation (notamment les éditeurs de radio en FM et en DAB+) et acter la déclaration de ceux qui doivent simplement se déclarer ;
- Rendre un avis annuel sur le respect, par les différents régulés, de leurs obligations lors de l’exercice écoulé ;
- Rendre une décision vis-à-vis des régulés qui sont poursuivis pour ne pas avoir respecté la législation en matière audiovisuelle et, dans ce cadre, prendre d’éventuelles sanctions ;
- Rendre des avis sur certaines questions ;
- Adopter des recommandations de portée générale ou particulière ;
- Déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations ;
- Participer à la réalisation d’une analyse périodique comportant des recommandations spécifiques et encourageant la diffusion des bonnes pratiques concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la lutte contre les stéréotypes sexistes et le traitement médiatique des violences faites aux femmes ;
Le CSA est une autorité publique active dans le domaine culturel. A ce titre, il est soumis à la loi du 16 juillet 1973 dite du « Pacte culturel », dont le but est de garantir le pluralisme idéologique, philosophique et politique dans les institutions culturelles publiques et d’éviter toute discrimination des utilisat.eur.rice.s. Pour cette raison, la composition de ses organes doit respecter un principe de représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques. Plus précisément, en ce qui concerne le Bureau et le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC), la législation prévoit que leurs membres doivent être désigné.e.s dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela signifie donc que les membres du Bureau et du CAC ont une « étiquette politique ». Toutefois, il existe également des règles d’incompatibilité s qui font que ces membres ne peuvent pas être des mandataires politiques ou membres de cabinets (le seul mandat qu’ils peuvent éventuellement exercer est celui de conseill.er.ère communal.e). S’ils et elles ont une couleur politique, ce ne sont donc pas pour autant des politicien.ne.s aguerri.e.s, mais plutôt des personnes qui partagent certaines valeurs communes avec un parti politique. Il ne leur est pas demandé de mettre de côté ces valeurs dans leurs décisions mais bien, comme le précise la législation, qu’elles exercent leurs missions « au moment opportun et de manière indépendante, impartiale et transparente, non discriminatoire et proportionnée aux objectifs poursuivis ». Par ailleurs, en ce qui concerne le Collège d’avis (CAV), la législation prévoit que ses membres doivent être désigné.e.s « de façon à assurer la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d’une des tendances ou d’un ensemble de groupements d’utilisateurs se réclamant d’une même tendance ». Là, il n’y a donc plus de lien direct entre la composition de l’organe et celle du Parlement. Et plutôt que d’une politisation des membres, il faut plutôt parler d’une attention portée au fait qu’il n’y ait pas de prédominance injustifiée d’une tendance ou d’un groupement utilisateur. Les membres du CAV étant issus du secteur régulé (représentant.e.s des éditeurs, distributeurs, opérateurs, etc.), ils et elles n’ont pas nécessairement d’étiquette politique, mais l’idée est essentiellement de veiller à ce que le secteur soit représenté de manière pluraliste.
Le CSA est une autorité administrative indépendante. Cela signifie qu’en tant qu‘autorité administrative, elle est instituée par une autorité publique (en l’occurrence la Communauté française), mais qu’en tant qu’autorité indépendante, elle dispose d’une large autonomie dans l’exercice de ses compétences. Le CSA comporte trois organes, chacun doté de compétences propres. Le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC), composé de dix membres, est l’organe du CSA qui exerce ses missions de régulation à proprement parler : il contrôle le secteur de l’audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles, peut délivrer des autorisations et prendre des sanctions. Le Collège d’avis (CAV), composé de maximum vingt-quatre membres effecti.f.ve.s (et autant de suppléant.e.s), est l’organe du CSA qui exerce des missions de co-régulation. Contrairement aux membres du CAC, qui doivent être indépendants par rapport au secteur régulé, les membres du CAV sont en effet issus de ce secteur. Et à ce titre, ils et elles sont invité.e.s à collaborer à leur régulation, soit en rendant des avis, d’initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, soit en adoptant des règles dans des codes de conduite ou dans des règlements, ces derniers étant destinés à être rendus contraignants par arrêté du Gouvernement. Enfin, le Bureau est composé de quatre membres : le Président et les trois vice-Présidents du CSA. Il s’agit de l’organe de gestion du CSA. Le Bureau assure la gestion administrative de l’institution (budget, personnel, etc.) et organise ses travaux. C’est donc lui qui détermine l’agenda des autres organes et qui, en dehors des missions légales et incontournables, décide quels dossiers seront mis en avant. Il faut également noter que les quatre membres du Bureau siègent dans les deux autres organes du CSA, ce qui leur donne une vue d’ensemble sur les activités de l’institution. Pour préparer leur travail, les trois organes précités peuvent s’appuyer sur les services du CSA, c’est-à-dire le personnel de l’institution. Composé d’une trentaine de personnes, ce personnel comporte trois unités spécifiques (télévision, radio, distributeurs & opérateurs), des agents ayant des compétences transversales (par exemple en matière de protection des mineurs, de communication commerciale, de pluralisme, etc.), un Secrétariat d’instruction qui instruit les plaintes, une direction des études et recherches, ainsi qu’une direction et des services d’appui.
| Communication du CSA
Les photos, images, graphiques utilisés par le CSA ne relèvent pas tous de sa propriété intellectuelle. Certaines font l’objet d’autorisations d’utilisation décernées au CSA, d’autres ont été achetées pour l’unique utilisation du CSA, d’autres sont soumises à conditions d’utilisation… Pour toute utilisation d’une photo, d’une image, d’un graphique publié par le CSA, veuillez prendre contact avec le service communication du CSA: communication@csa.be.
Une permanence téléphonique est assurée entre 9h et 16h sur le numéro principal du CSA le 02.349.58.80. En dehors de ces heures et en cas d’absence, un répondeur permet à chacun et chacune de laisser un message et ses coordonnées pour être recontacté.e dans les meilleurs délais. Pour tout appel sur une ligne téléphonique direct d’un membre du personnel, il est également préférable d’appeler dans cette tranche horaire. En cas d’absence de réponse, soit en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions en cours, de télétravail ou encore de congés, n’hésitez pas à rappeler à un autre moment ou à adresser un mail à cette personne. Les coordonnées des membres du personnel sont accessibles via le lien suivant : https://www.csa.be/membres/ Si vous souhaitez nous visiter, il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la question: “Comment me rendre au CSA?”
L’accès aux bureaux du CSA est relativement simple mais il est indispensable de prendre rendez-vous avec la personne ou le service que vous souhaitez rencontrez au préalable. En effet, si vous venez spontanément nous ne pouvons vous garantir de pouvoir vous recevoir en raison des déplacements des équipes du CSA, de réunions planifiées, de télétravail ou encore de congés. Il n’est par ailleurs dans la plupart des cas pas nécessaire de vous déplacer. L’ensemble du personnel veille à répondre à toute prise de contact (mail, courrier postal, téléphone, …) dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à privilégier ces modes de contact. Pour obtenir un rendez-vous ou prendre contact avec le CSA, veuillez consulter la question: “Comment joindre le CSA?” Si vous deviez nous rejoindre à nos bureaux, ceux-ci se trouvent au 89 Rue Royale à 1000 Bruxelles. La gare de train la plus proche (moins d’1 km à pied) est la gare de Bruxelles-Centrale. Si vous préférez nous rejoindre par transport en commun:
- depuis la gare centrale, bus 29 63 65 et 66 (jusqu’à Treurenberg)
- depuis l’arrêt Palais tram 92 93 (jusqu’à Congrès)
- depuis la gare du Nord bus 270 271 272 318 351 358 410 (jusqu’à Botanique)
- depuis l’arrêt Ste-Marie tram 92 93 (jusqu’à Congrès)
Le site du CSA comporte un formulaire qui vous permet d’introduire une question. Cette question sera directement transmise à la personne ou au service le plus à même de vous répondre et qui vous répondra dans les meilleurs délais. https://www.csa.be/posez-une-question/ Les adresses générales du CSA qu’elle soient postale, téléphonique ou email peuvent également être utilisées. Elles sont gérées de manière dynamique et permettent que toute prise de contact arrive également à la personne ou au service le plus à même de vous répondre. Conseil supérieur de l’audiovisuel - Rue Royale 89, 1000 Bruxelles – 02.349.58.80 - info@csa.be Enfin, la page organigramme de notre site internet liste l’ensemble des membres du personnel et leurs coordonnées. Si vous pouvez identifier clairement la personne ou le service que vous souhaitez joindre, n’hésitez pas à utiliser ces coordonnées. https://www.csa.be/membres/
En cohérence avec ses missions en ce qui concerne cette matière pour les services de médias audiovisuels, le site du CSA est doté d’un outil qui permet à chacun et chacune de modifier des paramètres d’affichage du site. Cet outil est disponible sur l’entièreté du site via un bouton identifié avec une icône d’oeil barré et identifié par le texte “outils d’accessibilité”. Cet accès permet aussi bien d’agrandir les caractères de textes sur le site, de modifier la couleur des arrières plans, d’appliquer un haut contraste, etc...
Il est également possible pour les personnes qui le souhaitent d’adresser leur plainte en langue des signes par vidéo en transférant celle-ci plutôt qu’en adressant un mail écrit ou en remplissant le formulaire en ligne. Pour accéder à cette possibilité de dépôt de plainte: https://www.csa.be/accessibilite-depot-de-plainte/Toutes les informations sur l’actualité du CSA sont publiées sur son site internet. Ces dernières concernent autant les avis, que les décisions, les autorisations, les déclarations de nouveaux services, les recommandations, mais aussi des dossiers relatifs aux études et recherches du CSA . Ces informations se trouvent principalement dans la section “activité décisionnelle”, ou sous formes de brèves dans ses actualités. Le CSA propose également des mini-sites et des pages spécifiques pour vulgariser une série de thématiques. Le CSA utilise également les réseaux sociaux pour partager certaines informations: Twitter, Linkedin, Instagram, Facebook, Viméo, Youtube. Enfin, il propose un webzine d’information pour traiter en profondeur les actualités qui concernent la régulation des médias. Le webzine est logé sur le site regulation.be Chaque mois, le CSA adresse une newsletter qui condense toute l’actualité qui le concerne. Cette newsletter compile les brèves, les appels à candidatures, les études publiées, les offres d’emploi et toutes les documents adoptés par ses collèges. Pour rester informer de l’activité du CSA, il suffit de s’inscrire à cette newsletter. D'autres newsletters sont également proposées. Une newsletter pour la presse, une newsletter pour le magazine d’information regulation.be et une newsletter destinée au public académique. L’ensemble de ces lettres d’information sont accessibles ici.
| Porter plainte
Une plainte peut être classée sans suite si, à l'issue d'un premier examen par le Secrétariat d'instruction et avant même toute interpellation du service de média audiovisuel mis en cause, il apparaît qu’aucune infraction à la législation ou à la réglementation en matière d’audiovisuel n’a été commise. Le Secrétariat d’instruction peut également classer la plainte sans suite après instruction si, à la suite de son examen approfondi, et après avoir considéré les observations du service de média audiovisuel mis en cause, il considère que les arguments développés permettent de conclure à l’absence d’infraction à la législation ou à la réglementation en matière d’audiovisuel .
Une plainte est irrecevable lorsque :
- La plainte est anonyme ou que le nom du plaignant est délibérément erroné;
- L’adresse (courrier ou électronique) du plaignant est absente ou incomplète, rendant impossible toute correspondance avec celui-ci;
- La plainte n’énonce aucun grief précis, aucune infraction potentielle;
- Le CSA n’est pas compétent pour traiter la plainte.
Ce n'est pas le CSA, mais le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui perçoit les amendes dues. Dès que le CSA décide d'infliger une amende, le Gouvernement (ou un fonctionnaire chargé du recouvrement) invite le débiteur à payer l'amende. En cas de non-paiement, il dresse une contrainte, c'est-à-dire une décision administrative pouvant conduire à la saisie, qui sera exécutée par un huissier de justice.
En tant qu'autorité administrative, le CSA peut prononcer des sanctions administratives à l'encontre des éditeurs, distributeurs et opérateurs relevant de sa compétence, et ce, par l'intermédiaire de son Collège d'autorisation et de contrôle (CAC). Les sanctions possibles sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- la diffusion d'un communiqué relatant l'infraction ;
- la suspension du programme incriminé ;
- le retrait du programme incriminé ;
- la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois ;
- la suspension de la distribution du service incriminé ;
- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 € ni excéder 3% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe;
- le retrait de l'autorisation.
La durée de traitement des plaintes varie en fonction des suites qui leur sont réservées. Elle peut s’étendre d’une semaine à plusieurs mois, en cas de procédure d’instruction. L’équipe du Secrétariat d’instruction veille à apporter à chaque plaignant.e une réponse complète, dans les meilleurs délais. Elle s’assure qu’une première réponse à la plainte puisse être envoyée dans le mois à compter de la date de réception.
Chaque plainte est examinée par le Secrétariat d’instruction. Après, le cas échéant, avoir visionné ou écouté le programme concerné, il peut décider :
- de déclarer la plainte irrecevable;
- de classer la plainte sans suite;
- ou de procéder à une instruction.
- de classer la plainte sans suite;
- ou de proposer une notification de grief au Collège d’autorisation et de contrôle, lorsqu’il conclut qu’une infraction à la législation audiovisuelle a été commise.
Si le CSA n’est pas compétent, le Secrétariat d’instruction réoriente le ou la plaignant.e vers l’autorité compétente ou, le cas échéant, transfère lui-même la plainte.
Les éditeurs de radio, de télévision, de chaines de vidéos en ligne et les services de partage de vidéos bénéficient de la liberté d’expression et de la liberté éditoriale. Cela signifie que le CSA n’intervient jamais dans les choix de programmation et n’exerce aucun pouvoir de censure : il ne peut pas interdire la diffusion d’un programme de manière préventive. Il ne peut pas, non plus demander à une chaîne de rétablir une émission supprimée ou de programmer tel ou tel type d’émissions ou se prononcer sur la qualité d’un programme. Le CSA ne peut intervenir dans le contenu des programmes qu'après la diffusion de ceux-ci. Son pouvoir d'intervention s’exerce donc a posteriori et est limité à certains cas précis définis dans la législation audiovisuelle, à savoir :
- L’atteinte aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général ;
- L’atteinte à la protection des mineurs (signalétique, horaires de diffusions, codes d’accès) ;
- L’atteinte au respect de la dignité humaine ;
- L’atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- Les incitations à la haine, à la violence ou à la discrimination ;
- Les provocations publiques à commettre une infraction terroriste ;
- La négation, la minimisation, la justification, l’approbation des génocides ;
- Le fait de favoriser un courant de pensée, une opinion ou une croyance constituant une menace pour la démocratie et les droits fondamentaux ;
- Les infractions aux législations relevant du racisme et de la xénophobie ;
- Les infractions liées à la pédopornographie ;
- La publicité et la communication commerciale (parrainage, placement de produit, publicité clandestine, durée publicitaire, respect des règles d’identification et de séparation de la publicité, etc.) ;
- L’accessibilité des programmes aux personnes avec des déficiences sensorielles ;
- Le respect des règles en matière de couverture médiatique des élections, lors des périodes électorales, etc.
Le Secrétariat d’instruction (SI) est un service institué au sein du CSA dans le but de traiter les plaintes émanant du public. Il est composé d’un.e Secrétaire d’instruction et d’autres membres du personnel qui l’assistent dans ses missions. Le Secrétariat d’instruction est placé sous l’autorité du Bureau mais jouit, dans le cadre de ses missions d’instruction, d’une indépendance par rapport à celui-ci. Cela signifie qu’il ne reçoit pas de consignes sur les dossiers à instruire ou à classer sans suite et décide en toute autonomie sur l’issue réservée à ses dossiers. Le Secrétariat d’instruction reçoit les plaintes du public et instruit celles-ci à charge et à décharge, en rassemblant tous les éléments d’information nécessaires à sa bonne compréhension du dossier, notamment en interrogeant le régulé qui fait l’objet de la plainte. Selon les cas, il pourra considérer la plainte irrecevable (et éventuellement la transmettre à une autre institution potentiellement compétente pour la traiter à sa place), la considérer recevable mais néanmoins la classer sans suite lorsqu’il n’existe pas, à ses yeux, d’éléments suffisants pour justifier des poursuites, ou encore établir un dossier d’instruction qu’il transmettra au Collège en lui proposant de notifier un ou plusieurs griefs à l’intéressé. Voir également les questions relatives aux plaintes
Oui. Les audiences du Collège d’autorisation et de contrôle sont publiques. Le huis-clos peut toutefois être ordonné par le Collège.
Les plaintes peuvent porter sur la réglementation audiovisuelle en général. Le texte sur lequel se base principalement l’action du CSA – mais pas exclusivement – est le décret du 3 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage vidéo, entré en vigueur le 15 avril 2021. Le CSA vérifie également le respect des règlements approuvés par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des conventions conclues entre un éditeur ou un distributeur de services et la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est-à-dire du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacun des médias de proximité ou des engagements pris dans le cadre de la réponse aux appels d’offre pour les services sonores. L'action du CSA concerne donc tant les éditeurs que les distributeurs et les opérateurs ». - Consulter les textes réglementaires - Pour en savoir plus sur les matières, consultez également la question " Quels types de plainte peut-on introduire ?"
Toute personne, physique ou morale, peut introduire une plainte auprès du CSA. Les plaintes peuvent être introduites :
- via ce formulaire en ligne;
- par courrier à l’attention du Secrétariat d’instruction, au 89 rue Royale, 1000 Bruxelles;
- par email : publics@csa.be;
- en nous envoyant une vidéo en langue des signes via notre page dédiée à cette transmission.
Les plaintes peuvent prendre différentes formes : vous pouvez compléter le formulaire en ligne (https://www.csa.be/a-votre-service/porter-plainte/), ou nous adresser votre plainte par mail, à l’adresse publics@csa.be. Il est par ailleurs possible de nous transmettre votre plainte sous la forme d’une vidéo en langue des signes. Pour se faire, un formulaire spécifique est mis à disposition à l’adresse suivante : https://www.csa.be/accessibilite-depot-de-plainte/. Les vidéos peuvent également être envoyées directement par mail à publics@csa.be.
| Glossaire
Le « décret SMA » désigne le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Ce décret remplace l’ancien décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels : il reprend une grande partie de ses dispositions mais y apporte également des modifications et des nouveautés. Le décret SMA est un texte à valeur législative, adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), qui régit la matière de l’audiovisuel en FWB. Une partie des règles qu’il contient transposent des règles issues de directives européennes. Il s’applique à tous les éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de partage de vidéos qui relèvent de la compétence territoriale de la FWB, et encadre leurs activités en les soumettant à un certain nombre de règles concernant par exemple la communication commerciale, la protection des mineurs, l’interdiction des discours de haine au sens large, le soutien à la production, etc. Il fixe également des règles formelles organisant la déclaration ou l’autorisation auxquelles sont soumis les différents régulés. Enfin, il organise le contrôle de toutes ces règles par le CSA. Le décret SMA est la principale source de droit de l’audiovisuel en FWB mais il est également complété par d’autres sources telles que, notamment, des arrêtés d’exécution, le contrat de gestion de la RTBF, etc.
Le Collège d’avis (CAV) est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Bureau. Il se compose de maximum vingt-quatre membres effecti.f.ve.s : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que vingt autres membres (maximum). Ces vingt derni.er.ère.s membres ont chacun.e un.e suppléant.e. Ils et elles sont désigné.e.s par le Gouvernement, de façon à assurer la représentation des différentes tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d’une des tendances ou d’un ensemble de groupements d’utilisateurs se réclamant d’une même tendance. Sauf en ce qui concerne les membres du Bureau, désigné.e.s pour cinq ans, leur mandat est de quatre ans, et est renouvelable. Le CAV est l’organe de co-régulation du CSA, ce qui signifie qu’il fait participer des représentants du secteur régulé à l’exercice de missions de régulation. Dès lors, les vingt membres hors-Bureau du CAV représentent différentes catégories d’éditeurs (la RTBF, les TV privées, différentes catégories de radios, etc.), les distributeurs, opérateurs et fournisseurs de services de partage de vidéos. A côté de ces vingt membres ayant voix délibérative (et leurs suppléant.e.s), certaines personnes peuvent également assister aux réunions du CAV mais avec une voix seulement consultative. Elles sont également désignées par le Gouvernement, ont aussi un.e suppléant.e, et représentent différentes catégories socio-professionnelles qui ne sont pas régulées directement par le CSA mais qui participent à l’écosystème des médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit notamment de représentant.e.s des product.eur.rice.s indépendant.e.s, du Conseil de déontologie journalistique ou encore de l’Association des journalistes professionnel.le.s. Le Collège d’avis ne se réunit pas sur une base régulière, mais à chaque fois que son intervention est requise par le Parlement, le Gouvernement ou le CAC, ou lorsqu’il décide d’agir d’initiative. Ses compétences sont les suivantes :
- Adopter des codes de conduite pour uniformiser et renforcer les bonnes pratiques au sein du secteur ;
- Adopter, dans certains domaines particuliers limitativement énumérés (notamment l’information politique en période préélectorale), des règlements destinés ensuite à être rendus obligatoires par le Gouvernement ;
- Rendre des avis sur toute question relative à l’audiovisuel et ne relevant pas de la compétence du CAC ;
- Rendre un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international ;
- Rendre un avis préalable sur certaines questions spécifiques liées aux opérateurs de réseaux.
La péréquation tarifaire, basée sur le principe d'égalité de traitement des citoyens, a pour but d’assurer que pour la même offre de services, le distributeur de services garantit un même prix à l'égard de tout utilisateur des services. Cela vise à éviter les traitements discriminatoires en matière de commercialisation et de tarification des services offerts par le distributeur, par exemple en fonction de la zone desservie. Conformément au principe de neutralité technologique, cela s'applique à l'ensemble des distributeurs déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles, quelle que soit la plateforme utilisée. Avec le service universel, la péréquation tarifaire constitue un élément essentiel de la mission de défense des utilisateurs telle que souhaitée par le législateur et appliquée par le régulateur.
DAB+ est l'abréviation de Digital Audio Broadcasting. Il s’agit de la norme pour la diffusion de la radio numérique sur les ondes hertziennes terrestres la plus largement utilisée en Europe. A terme, la diffusion analogique via les fréquences FM devrait être progressivement remplacée par une diffusion en numérique, soit via la norme DAB+, soit via internet (webradio). La réception de radios en DAB+ nécessite un récepteur compatible.
TNT est l'abréviation de "télévision numérique terrestre". La TNT désigne la diffusion sous format numérique de chaînes de télévision et de radio via les fréquences hertziennes terrestres. Aujourd'hui, un seul bouquet numérique est diffusé sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il contient les trois chaînes de la RTBF et Euronews ainsi que les radios de la RTBF et de la BRF. Chez nous, la réception de la TNT est entièrement gratuite et ne nécessite pas d'abonnement, il suffit pour la recevoir d'une antenne (idéalement de toit) et d'un décodeur DVB-T (présent dans tous les téléviseurs récents). Plus d'information sur la TNT de la RTBF dans la section « 100 questions sur la TNT ».
Par opérateur le décret entend toute entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques ou des ressources associées nécessaires à la transmission auprès du public de services de médias audiovisuels. Actuellement, seules les plateformes du câble coaxial et de l'xDSL sont représentées en Communauté française : le registre publié sur le site du CSA énumère tous les opérateurs de réseau déclarés.
L’IPTV, ou Internet Protocol Television, est une forme de télévision où les programmes sont diffusés par IP (Internet Protocol) On l’appelle aussi TV sur IP (IPTV) ou encore télévision sur xDSL. Contrairement à télévision linéaire, qui est diffusée en direct, l’IPTV est diffusée via des boxes Internet. Le câble téléphonique de Proximus (anciennement Belgacom), aussi appelé câble « bifilaire » puisque constitué d’une paire de fils de cuivre, couvre pratiquement l’ensemble du territoire et est d’abord connu comme réseau de téléphonie et de transmissions de données (fax, Internet,…). Depuis 2005, ce réseau est également utilisé pour la télévision numérique qui est aujourd’hui disponible dans un grand nombre de foyers moyennant l’utilisation d’un matériel de décodage. En savoir plus sur l'IPTV : rendez-vous sur notre site dédié.
La CRC ou conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) réunit les différentes autorités de régulation compétentes dans le domaine des télécommunications et de l'audiovisuel (IBPT, VRM, Medienrat et CSA). Des projets de décision initiés par un membre de la CRC sont ainsi régulièrement soumis à l'accord des autres membres de la CRC.
Un distributeur est une société qui met à disposition du grand public (les consommateurs) des chaînes de télévision, de radio et des programmes TV ou radio à la demande. Le distributeur choisit les contenus qui seront disponibles dans son offre. Ces derniers sont fournis la plupart du temps par d’autres entreprises (des éditeurs), dont les chaînes de TV belges et étrangères. La mise à disposition de ces contenus aux consommateurs se fait en recourant à des réseaux de communication : câbles, satellites, ondes hertziennes, etc. Le distributeur est parfois également opérateur de tels réseaux.
Le placement de produit est une forme de communication commerciale, comme la publicité, le parrainage ou l'autopromotion. Elle consiste à insérer un produit, un service ou une marque, ou une référence à un produit, service ou marque dans un programme ou une vidéo créée par l’utilisateur moyennant paiement ou une autre contrepartie. On peut distinguer deux formes de placement de produit : le placement de produit contre paiement et le « placement d'accessoires ». Le placement d'accessoires consiste pour un annonceur à fournir un bien ou un service en vue de l'inclure dans un programme, sans qu'aucun paiement n'intervienne. Il s'agira par exemple des accessoires de production et des lots.
VOD pour « vidéo on demand » : désigne les services de médias audiovisuels non linéaires. Leurs programmes sont visionnables à tous moments par les téléspectateurs, soit gratuitement (souvent en contrepartie du visionnage de publicités), soit moyennant un paiement à l’unité (on parle alors de « TVOD » pour désigner le caractère « transactionnel » du visionnage), soit moyennant la souscription d’un abonnement qui permet l’accès illimité à un catalogue (on parle alors de « SVOD » pour désigner le fait qu’une souscription est nécessaire). Les services VOD peuvent également revêtir un caractère hybride en cumulant les types de commercialisation décrits ci-dessus.
Le prix du CSA vise à récompenser un mémoire de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long (Master 120 d’une université, haute école ou école supérieure artistique ; Master complémentaire et Master de spécialisation) qui constitue une contribution scientifique originale à la compréhension et à la réflexion sur les enjeux juridiques, économiques, sociologiques, politiques, culturels, technologiques ou créatifs de l’audiovisuel. Le prix, d’une valeur actuelle de 1.500 €, est décerné tous les ans. Pour tout savoir sur les conditions de participation, consultez la page: https://www.csa.be/etudes-et-recherches/prix-du-memoire/
Un service de partage de vidéos est défini par la législation comme « un service dont l’objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement » (article 1.3-1, 54° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médis audiovisuels et aux services de partage de vidéos). Un service de partage de vidéos (SPV) présente donc plusieurs points communs importants avec un service de médias audiovisuels (SMA) :
- c’est un service
- dont l’objet principal (ou une de ses fonctionnalités essentielles)
- consiste à communiquer au public
- des programmes (ou des vidéos créées par l’utilisateur)
- par le biais de réseaux de communications électroniques
- dans le but d’informer, divertir ou éduquer
Le Bureau est l’un des trois organes du CSA, avec le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de quatre membres, à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), qui sont tou.te.s désigné.e.s par le Gouvernement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Les quatre membres du Bureau sont également membres du Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) et du Collège d’avis (CAV). Le Bureau se réunit en moyenne une fois par mois. C’est l’organe de gestion du CSA. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
- Il coordonne et organise les travaux du CSA
- Il représente le CSA en justice et à l’égard des tiers
- Il conclut les contrats au nom du CSA
- Il chapeaute les relations internationales du CSA
- Il recrute le personnel du CSA
- Il assure la gestion financière du CSA
Le Secrétariat d’instruction (SI) est un service institué au sein du CSA dans le but de traiter les plaintes émanant du public. Il est composé d’un.e Secrétaire d’instruction et d’autres membres du personnel qui l’assistent dans ses missions. Le Secrétariat d’instruction est placé sous l’autorité du Bureau mais jouit, dans le cadre de ses missions d’instruction, d’une indépendance par rapport à celui-ci. Cela signifie qu’il ne reçoit pas de consignes sur les dossiers à instruire ou à classer sans suite et décide en toute autonomie sur l’issue réservée à ses dossiers. Le Secrétariat d’instruction reçoit les plaintes du public et instruit celles-ci à charge et à décharge, en rassemblant tous les éléments d’information nécessaires à sa bonne compréhension du dossier, notamment en interrogeant le régulé qui fait l’objet de la plainte. Selon les cas, il pourra considérer la plainte irrecevable (et éventuellement la transmettre à une autre institution potentiellement compétente pour la traiter à sa place), la considérer recevable mais néanmoins la classer sans suite lorsqu’il n’existe pas, à ses yeux, d’éléments suffisants pour justifier des poursuites, ou encore établir un dossier d’instruction qu’il transmettra au Collège en lui proposant de notifier un ou plusieurs griefs à l’intéressé. Voir également les questions relatives aux plaintes
Le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) est l’un des trois organes du CSA, avec le Bureau et le Collège d’avis (CAV). Il se compose de dix membres : les quatre membres du Bureau (à savoir le président et les trois vice-président.e.s du CSA), ainsi que six autres membres. Certains de ces membres sont désignés par le Gouvernement, et d’autres sont désignés par le Parlement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur mandat est de cinq ans pour les membres du Bureau et de quatre ans pour les autres membres. Ces mandats sont renouvelables. Les membres doivent être choisi.e.s sur la base de leurs titres et mérites dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. Le CAC se réunit en moyenne deux fois par mois et exerce, au sein du CSA, les compétences de régulation à proprement parler. Cela couvre notamment les compétences suivantes :
- Autoriser les éditeurs, distributeurs et opérateurs soumis à autorisation (notamment les éditeurs de radio en FM et en DAB+) et acter la déclaration de ceux qui doivent simplement se déclarer ;
- Rendre un avis annuel sur le respect, par les différents régulés, de leurs obligations lors de l’exercice écoulé ;
- Rendre une décision vis-à-vis des régulés qui sont poursuivis pour ne pas avoir respecté la législation en matière audiovisuelle et, dans ce cadre, prendre d’éventuelles sanctions ;
- Rendre des avis sur certaines questions ;
- Adopter des recommandations de portée générale ou particulière ;
- Déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations ;
- Participer à la réalisation d’une analyse périodique comportant des recommandations spécifiques et encourageant la diffusion des bonnes pratiques concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la lutte contre les stéréotypes sexistes et le traitement médiatique des violences faites aux femmes ;
La définition légale de l’éditeur de services est : « la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé » (article 1.3-1, 13° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos). Cette définition implique trois éléments :
- Un éditeur est une personne (physique ou morale) : il peut donc s’agir d’un individu, d’une société ou encore d’une ASBL.
- Cette personne exerce une « responsabilité éditoriale »: cela signifie, conformément à la définition légale de la notion de responsabilité éditoriale (article 1.3-1, 47° du décret précité), qu’elle exerce un contrôle effectif sur la sélection et l’organisation de programmes. C’est elle qui, en pratique, sélectionne les programmes qui figureront dans le service, et qui détermine comment ces programmes seront agencés (dans une grille horaire s’il s’agit d’un service linéaire, ou dans un catalogue s’il s’agit d’un service non linéaire ou « à la demande »).
- Cette responsabilité s’exerce sur un « service de médias audiovisuels »: le service sur lequel l’éditeur exerce sa responsabilité éditoriale doit correspondre à la définition légale d’un service de médias audiovisuels (SMA), à savoir « un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale (…) » (article 1.3-1, 52° du décret précité). Cette définition comporte sept critères qui sont détaillés dans la réponse à la question "Qu’est-ce qu’un service de médias audiovisuels (SMA) ?".
Il s'agit d'un indicateur qui consiste à évaluer dans quelle mesure le public a accès à un nombre suffisamment élevé de médias et à mesurer l'impact respectif de ceux-ci sur l'audience et sur le marché. Une offre plurielle est une condition nécessaire d'un paysage audiovisuel reflétant la diversité culturelle, politique, d'idées et d'opinions, et garantissant la liberté d’information ; tout aussi nécessaire, la mesure de son impact sur le public. En effet, une situation monopolistique ou oligopolistique dans laquelle un ou quelques médias imposeraient leurs points de vue et façonneraient l'opinion publique en faveur d'intérêts particuliers est contraire aux valeurs d'un état démocratique. Le pluralisme structurel vise donc à diversifier l’actionnariat pour assurer les conditions structurelles de diversité de marché.
Par définition, un quota est un pourcentage, contingent déterminé, imposé ou autorisé. Dans le domaine de l'audiovisuel européen, ce terme recouvre un objectif de protection de la diversité culturelle et de promotion des œuvres audiovisuelles (largement définies dans l'article 1er 23° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels). Les quotas ont été mis en place pour que les oeuvres audiovisuelles européennes ne pâtissent pas de la prolifique production étrangère bon marché, et bénéficient d'une visibilité, voire d'un financement, accrus.
La notion d’accessibilité renvoie à l’obligation qu’ont les chaînes de diffuser des programmes sous-titrés, interprétés en langue des signes ou audiodécrits, mais pas seulement. Il s’agit également de s’assurer que les menus de navigation soient faciles d’utilisation et permettent d’accéder aisément aux programmes rendus accessibles. Cette obligation s’adresse aux distributeurs de services. L’accessibilité des programmes peut bénéficier à divers publics à besoins spécifiques, notamment les personnes en situation de déficience sensorielle dont les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap intellectuel, ou celles qui apprennent la langue française. Cette notion d’accessibilité revêt un caractère primordial pour garantir, à chacun.e, l’exercice du droit à l’accès à l’information et à la participation à la vie démocratique et sociale. Vous trouverez plus d’information sur l’accessibilité des programmes en Fédération Wallonie-Bruxelles sur notre site : https://www.csa.be/accessibilite/
| Accessibilité des programmes
En 2018, à la suite d’une évaluation de la situation et en vue d’améliorer l’accès des personnes en situation de déficience sensorielle aux services de médias audiovisuels, le Collège d’avis a adopté un règlement en matière d'accessibilité. Entré en vigueur au 1er janvier 2019, le Règlement prévoit une période de transition d’une durée de cinq pour la mise en œuvre des obligations. Durant cette période, un groupe de suivi est institué pour accompagner les éditeurs et les distributeurs dans l’implémentation des obligations et permettre une amélioration progressive et continue de l’accessibilité des programmes. Une Charte de qualité fut également rédigée en collaboration avec les représentants des associations de défense des droits des personnes en situation de déficience sensorielle. Son objectif est d’encadrer le travail des éditeurs dans la production et l’acquisition des pistes d’accessibilité. En effet, pour garantir une expérience équivalente à tous les publics, il convient d’associer aux ambitieuses obligations quantitatives des standards de qualité. La Charte de qualité et le Guide des bonnes pratiques à destination des professionnels de l’audiodescription en Belgique francophone furent adoptés par le Collège d’avis du CSA en 2019. Les différentes obligations feront l’objet d’un contrôle annuel par les services du CSA. De même, le règlement prévoit que le Collège d’Autorisation et de Contrôle du CSA rende « un avis sur la réalisation des obligations des éditeurs et distributeurs ». Il peut dès lors constater toute infraction au règlement ainsi qu’à la charte, et prononcer le cas échéant une sanction administrative. Il est également possible pour les téléspectateurs d’adresser une plainte au Secrétariat d’Instruction du CSA sur des motifs exposés au sein des textes susmentionnés. (Voir aussi : Existe-t-il des dispositions spécifiques pour porter plainte si je suis en situation de déficience sensorielle ?) En savoir plus sur l'accessibilité: https://www.csa.be/accessibilite/
Les programmes interprétés en langue des signes sont immédiatement accessibles comme tels, sans manipulation technique particulière. Les fonctions « audiodescription » et « sous-titrage » sont quant à elles activables/désactivables. La marche à suivre pour activer ces fonctions diffèrent d’un décodeur à l’autre (consulter le mode d’emploi). Pour obtenir plus d’informations concernant l’activation des mesures d’accessibilité, vous pouvez consulter les liens ci-dessous :
Réglage des sous-titres :
| ORANGE | Assistance technique |
| TELENET | Service client |
| VOO | Assistance technique - BOX EVASION Assistance technique - VOO CORDER Assistance technique - VOO TV+ |
| PROXIMUS | Support technique |
Réglage de l’audiodescription :
| ORANGE | Assistance technique |
| TELENET | Service client |
| VOO | Assistance technique - VOO CORDER Assistance technique - TV+ |
| PROXIMUS | Support technique |
Le Règlement relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle vise la plus grande diversité possible de programmes rendus accessibles.
Toutefois, ledit Règlement prévoit quelques exceptions : la radio filmée, la communication commerciale et les représentations musicales en direct ne sont pas concernés par l’obligation d’accessibilité. Par ailleurs, l’audiodescription est circonscrite aux programmes de fictions et de documentaires diffusés entre 13h et 24h .
Outre ces dispositions, les éditeurs de services sont libres de choisir quels programmes seront rendus accessibles et par quels moyens. De même, ils peuvent choisir d’acquérir les programmes déjà rendus accessibles ou de les rendre accessible par leurs propres moyens.
Par ailleurs, le règlement prévoit que les chaînes s’engagent à sous-titrer et, dans la mesure du possible, à interpréter en langue des signes les messages d’intérêt général à caractère urgent, de sécurité ou de santé publique.
(Voir aussi : Comment identifier les programmes rendus accessibles ?)
En savoir plus sur l'accessibilité: https://www.csa.be/accessibilite/Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Les téléspectateurs doivent donc être informés de l’accessibilité des programmes par :
- L’incrustation du pictogramme approprié en début de programme et dans les bandes annonces ;
- Une mention sonore, lorsqu’il s’agit de programmes à destination des personnes en situation de déficience visuelle.
- Au sein de la communication externe des éditeurs et des distributeurs (sur leur site par exemple, ou au sein de la presse écrite);
- Au sein des guides électroniques de programmes ( EPG) ;
- Au sein des catalogues de services de vidéos à la demande.
- Un pictogramme comportant les lettres "ST" indique la présence de sous-titres à destination des personnes en situation de déficience auditive .
- Un pictogramme comportant les lettres "AD" indique la présence d’une audiodescription à destination des personnes en situation de déficience visuelle.

 Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants
Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants
Le Contrat de gestion de la RTBF prévoit le respect des « obligations quantitatives et de moyens énoncés par le Règlement du Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle ». Les tableaux ci-dessous reprennent les obligations énoncées par le Règlement du 17 juillet 2018 qui s’appliquent aux chaînes de la RTBF à partir de l’année 2024, au terme de la période transitoire :
| Audience des chaînes de la RTBF | Obligations en matière de sous-titrage adapté et d’interprétation en langue des signes |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 95% des programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 35% de programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |
| Audience des chaînes de la RTBF | Obligations en matière d’audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 25% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 15% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
- Garantir un accès avec traduction gestuelle au JT de début de soirée et au JT spécifiquement destiné à la jeunesse, sur AUVIO ou sur une de ses chaînes;
- Considérer les sous-titres comme le principe d’écriture des programmes d’information à destination des plateformes internet ;
- Diffuser sur la plateforme AUVIO les programmes rendus accessibles et diffusés sur les chaînes de télévision ; En vertu du Règlement, la RTBF est également soumise pour sa plateforme AUVIO à l’obligation de tout mettre en œuvre pour atteindre les seuils fixés : 25% de programmes disposant d’un sous-titrage adapté et 25% des programmes de fiction et documentaires audiodécrits. (Voir aussi : Qu’offre la video à la demande en matière d’accessibilité).
- Rendre leur site internet progressivement accessible aux personnes en situation de déficience visuelle ;
- Sous-titrer les interviews réalisées en langue étrangère au sein des JT et magazine d’information, autant que possible.
- La RTBF doit également respecter les critères de qualité énoncés par la Charte de qualité du Collège d’Avis.
- https://www.csa.be/document/reglement-accessibilite-juillet-2018/
- https://www.csa.be/97195/accessibilite-des-programmes-le-secteur-publie-une-charte-qualite/.
La vidéo à la demande présente un certain nombre d’opportunités en matière d’accessibilité des programmes. La principale est que l’utilisateur peut choisir le moment où il souhaite consulter le programme. Avec le règlement du 17 juillet 2018, l’accessibilité des programmes à la demande aux personnes en situation de déficience sensorielle s’adresse également aux “services non linéaires” . Ce terme désigne les services dont les programmes sont destinés à être reçus au moment choisi par le consommateur sur la base d’un catalogue de programmes à la demande. Les éditeurs de services non linéaires ont l’obligation de tout mettre en œuvre afin que 25% des programmes de leur catalogue soient sous-titrés. La même proportion de programmes audiodécrits est attendue. Les critères de qualité énoncés par la Charte du Collège d’Avis du 26 novembre 2019 s’appliquent également aux contenus à la demande. En savoir plus: https://www.csa.be/accessibilite/
L’audiodescription consiste à décrire oralement les événements qui apparaissent à l’écran, entre les dialogues ou les commentaires d’un programme. Elle intervient donc en tant que complément sonore au programme afin de faciliter sa compréhension par les personnes en situation de déficience visuelle notamment. Avec la télévision numérique, il est possible d’utiliser plusieurs canaux sonores, dont une piste qui peut être consacrée à l’audiodescription. La Charte, de même que le Guide de bonnes pratiques, définissent des principes directeurs pour la production d’une audiodescription de qualité. En savoir plus sur l'accessibilité: https://www.csa.be/accessibilite/ Voir aussi dans la liste des FAQ : Comment identifier les programmes rendus accessibles ?
Certains programmes, notamment des programmes d’information et d’actualité, sont interprétés en langue des signes . Pour se faire, un interprète traduit, par ses gestes , la partie audio du programme télévisé afin de le rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes. C’est la langue des signes de Belgique francophone (LSFB) telle que reconnue par le décret relatif à la reconnaissance de la langue des signes du 22 octobre 2003, qui est utilisée. L’interprétation des programmes en langue des signes est soumise à des critères de qualité définis par la Charte de qualité du Collège d’Avis du CSA du 26 novembre 2019. En savoir plus sur l'accessibilité: https://www.csa.be/accessibilite/
Le sous-titrage est une technique qui consiste à associer du texte aux images et au son d’un programme télévisé. Il existe deux types de sous-titres :
- Le premier vise à traduire un programme diffusé en version originale. Il s’agit des sous-titres “interlinguistiques” désignés par le sigle “VOSTFR”.
- Dans le cas du sous-titrage à destination des personnes en situation de déficience sensorielle, le sous-titrage doit répondre à des exigences de qualité supplémentaires telles que le type de police utilisé, la couleur du texte ou son positionnement sur l’écran par exemple. Le respect de ces critères doit garantir la bonne compréhension du programme disposant de sous-titres à destination des personnes en situation de déficience sensorielle par le public cible. En outre, ces sous-titres doivent également transmettre le plus fidèlement possible le contenu sonore d’un programme sous forme de texte et permettre l’identification des sources sonores .
Les plaintes peuvent prendre différentes formes : vous pouvez compléter le formulaire en ligne (https://www.csa.be/a-votre-service/porter-plainte/), ou nous adresser votre plainte par mail, à l’adresse publics@csa.be. Il est par ailleurs possible de nous transmettre votre plainte sous la forme d’une vidéo en langue des signes. Pour se faire, un formulaire spécifique est mis à disposition à l’adresse suivante : https://www.csa.be/accessibilite-depot-de-plainte/. Les vidéos peuvent également être envoyées directement par mail à publics@csa.be.
Le Règlement du 17 juillet 2018 stipule que les distributeurs des chaînes ont l’obligation de mettre à disposition du public, sans coût supplémentaire, les programmes rendus accessibles par les éditeurs. Ils doivent également veiller à faciliter l’utilisation des menus de navigation et plus particulièrement l’activation des fonctionnalités d’accessibilité . Enfin, les distributeurs doivent garantir l’information du public via l’incrustation des pictogrammes définis en annexe du Règlement du 17 juillet 2018 au sein des guides électroniques de programmes , des catalogues de vidéos à la demande et de leur communication externe. Dans le même objectif, les distributeurs doivent s’assurer de l’identification de la piste d’audiodescription. Pour plus d’informations, le Règlement du 17 juillet 2018 est disponible sur notre site : https://www.csa.be/document/reglement-accessibilite-juillet-2018/.
Une Charte de qualité ainsi qu’un Guide des bonnes pratiques à l’attention des professionnels de l’audiodescription furent adoptés le 26 novembre 2019 par le Collège d’Avis du CSA . En effet, pour garantir une expérience équivalente à tous les publics, il convient d’associer aux obligations quantitatives, certes ambitieuses, des standards de qualité . Les éditeurs sont invités à tout mettre en œuvre pour respecter les critères énoncés par la charte, tant pour le sous-titrage que pour l’interprétation en langue des signes ou encore l’audiodescription. Ainsi , les critères visent à assurer la lisibilité, la précision et la compréhension des sous-titres à destination des personnes en situation de déficience sensorielle, y compris pour les programmes en direct. Outre les critères relatifs à la compréhensibilité de l’interprétation en langue des signes de Belgique, la Charte du Collège d’avis définit des exigences en matière de visibilité pour l’interprète. Pour l’audiodescription, la Charte renvoie aux principes de respect de l’œuvre originale, d’intelligibilité et de précision pour les descriptions. Ces critères objectivables sont complétés par des exigences plus difficilement contrôlable mais néanmoins essentielle à la réalisation d’une audiodescription de qualité. Ces dernières sont mentionnées au sein du Guide de Bonnes pratiques à destination des professionnels de l’audiodescription. La Charte ainsi que le Guide des bonnes pratiques à destination des professionnels de l’audiodescription sont disponibles sur le site du CSA : https://www.csa.be/97195/accessibilite-des-programmes-le-secteur-publie-une-charte-qualite/.
Les chaînes ont l’obligation de diffuser sur leurs services linéaires et non-linéaires un certain pourcentage par an de programmes dits « accessibles aux personnes en situation de déficience visuelle », c’est-à-dire audiodécrits. Ces quotas varient notamment en fonction de l’audience moyenne annuelle de chaque service et de son statut privé ou public. Le tableau ci-dessous reprend les obligations qui s’appliquent aux chaînes privées à partir de l’année 2024, au terme de la période transitoire :
| Audience des médias de proximité | Obligations en matière d’audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 25% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 15% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
Les chaînes ont l’obligation de diffuser sur leurs services linéaires et non-linéaires un certain pourcentage par an de programmes dits « accessibles aux personnes en situation de déficience auditive », c’est-à-dire sous-titrés ou interprétés en langue des signes. Ces quotas varient notamment en fonction de l’audience moyenne annuelle de chaque service et de son statut privé ou public. On distingue par ailleurs les obligations de résultat des obligations de moyens. Ces dernières ne correspondent pas à une absence d’obligation. Les chaînes doivent pouvoir démontrer et justifier que tout a été mis en œuvre pour tendre vers les seuils fixés par le Règlement. Au regard de l’article 5 du Règlement, les programmes interprétés en langue des signes sont réputés constituer des programmes rendus accessibles sur plateforme de distribution fermée au moyen de sous-titrage). Le tableau ci-dessous reprend les obligations qui s’appliquent aux chaînes privées à partir de l’année 2024, au terme de la période transitoire :
| Audience des médias de proximité | Obligations en matière de sous-titrage adapté et d’interprétation en langue des signes |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 95% des programmes du service doit disposer d’un sous-titrage adapté. |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 35% de programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |
Les chaînes ont l’obligation de diffuser sur leurs services linéaires et non-linéaires un certain pourcentage par an de programmes dits « accessibles aux personnes en situation de déficience visuelle », c’est-à-dire audiodécrits. Ces quotas varient notamment en fonction de l’audience moyenne annuelle de chaque service et de son statut privé ou public. On distingue par ailleurs les obligations de résultats des obligations de moyens. Ces dernières ne correspondent pas à une absence d’obligation. Les chaînes doivent pouvoir démontrer et justifier que tout a été mis en œuvre pour tendre vers les seuils fixés par le Règlement. Le tableau ci-dessous reprend les obligations qui s’appliquent aux chaînes privées à partir de l’année 2024, au terme de la période transitoire :
| Audience des chaînes privées | Obligations en matière d’audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 20% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation de tout mettre en œuvre pour atteindre 15% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
Les chaînes ont l’obligation de diffuser sur leurs services linéaires et non-linéaires un certain pourcentage par an de programmes dits « accessibles aux personnes en situation de déficience auditive », c’est-à-dire sous-titrés ou interprétés en langue des signes. Ces quotas varient notamment en fonction de l’audience moyenne annuelle de chaque service et de son statut privé ou public. On distingue par ailleurs les obligations de résultat des obligations de moyens. Ces dernières ne correspondent pas à une absence d’obligation. Les chaînes doivent pouvoir démontrer et justifier que tout a été mis en œuvre pour tendre vers les seuils fixés par le Règlement. Aussi, au regard de l’article 5 du Règlement, les programmes interprétés en langue des signes sont réputés constituer des programmes rendus accessibles sur plateforme de distribution fermée au moyen de sous-titrage). Le tableau ci-dessous reprend les obligations qui s’appliquent aux chaînes privées à partir de l’année 2024, au terme de la période transitoire :
| Audience des chaînes privées | Obligations en matière de sous-titrage adapté et d’interprétation en langue des signes |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 75% des programmes du service doit disposer d’un sous-titrage adapté. |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation de tout mettre en œuvre pour d’atteindre 35% de programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |
La notion d’accessibilité renvoie à l’obligation qu’ont les chaînes de diffuser des programmes sous-titrés, interprétés en langue des signes ou audiodécrits, mais pas seulement. Il s’agit également de s’assurer que les menus de navigation soient faciles d’utilisation et permettent d’accéder aisément aux programmes rendus accessibles. Cette obligation s’adresse aux distributeurs de services. L’accessibilité des programmes peut bénéficier à divers publics à besoins spécifiques, notamment les personnes en situation de déficience sensorielle dont les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap intellectuel, ou celles qui apprennent la langue française. Cette notion d’accessibilité revêt un caractère primordial pour garantir, à chacun.e, l’exercice du droit à l’accès à l’information et à la participation à la vie démocratique et sociale. Vous trouverez plus d’information sur l’accessibilité des programmes en Fédération Wallonie-Bruxelles sur notre site : https://www.csa.be/accessibilite/
| Egalité et diversité dans les médias audiovisuels
Les obligations définies par le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéo (relatives au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la dignité humaine, à l’incitation à la violence et aux questions de discriminations) s’appliquent aussi bien aux services linéaires que non-linéaires, c’est-à-dire sur internet (web TV, web radio, services de vidéo à la demande, catch up TV/rattrapage, les chaînes des « Vloggeurs » rencontrant les critères d’un service de média audiovisuel). En outre, La directive européenne 2018/1808 sur les services de médias audiovisuels a introduit le concept de « service de plateforme de partage de vidéos » comme nouvelle catégorie à laquelle la régulation audiovisuelle attachait désormais des obligations. Cette directive a été transposée dans la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Désormais, les plateformes de partage de vidéo se voient donc attacher certaines obligations notament pour les fournisseurs de services de partage de vidéos de prendre des mesures pour protéger les utilisateurs (système de signalisation, procédure pour le traitement des réclamations, …).
Depuis 2011, le CSA réalise un Baromètre de l’Egalité et de la Diversité dans les services de médias audiovisuels actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de dresser un état des lieux de l’égalité et de la diversité dans les différents services sur la base de cinq critères : le genre, l’origine, l’âge, la situation socio-professionnelle et le handicap. Quatre éditions du Baromètre Egalité-Diversité des services télévisuels ont été réalisées entre 2011 et 2017. Les trois premières se sont inscrites dans le cadre du Plan pour la diversité et l’égalité dans les médias audiovisuels qui avait été lancé par la ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de l’Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’édition 2017 s’est inscrite, quant à elle, dans le cadre de nouvelles missions confiées au CSA par le législateur*. En 2019 le CSA a mis en œuvre un nouveau Baromètre consacré aux services radiophoniques. * Depuis 2016 la législation audiovisuelle prévoit en effet que le CSA participe à la réalisation d’une analyse périodique concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Consultez le site consacré aux différents Baromètres Le CSA réalise également toute autre recherche en matière d’égalité et de diversité. En effet, outre les Baromètres, le CSA a mené plusieurs recherches portant sur la question de l’égalité. On citera notamment la recherche relative à l’égalité de genre dans les métiers de l’audiovisuel. Elle vise, en autres, à quantifier la présence des femmes et des hommes dans les métiers de l’audiovisuel ainsi qu’à comprendre leurs trajectoires professionnelles. Ces études sont également disponibles sur le site: https://www.csa.be/egalitediversite
- Le CSA contrôle le respect des dispositions prévues dans le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéo (1) ;
- Le CSA contrôle le respect des dispositions prévues dans le contrat de gestion de la RTBF (2) ;
- Le CSA formule des recommandations et des avis (3) ;
- Le CSA réalise un Baromètre de l’Egalité et de la Diversité (4) ;
- Le CSA réalise toute autre recherche en matière d’égalité et de diversité (5) ;
- Le CSA propose des modules de formations à destination des étudiant.e.s (6) ;
- Le CSA participe à divers projets internationaux, notamment sur les questions d’égalité et de diversité (7).
(1) L’article 2.4-1 du décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéo précise que : « Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : 1° portant atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée sur la base du sexe ou de critères assimilés que sont notamment la grossesse, et la maternité, le changement de sexe, l’expression de genre, l’identité de genre ou contenant des incitations à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique ; 2° comportant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier en raison de la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale ». Le CSA contrôle le respect de ces dispositions et peut, le cas échéant, prendre des décisions de sanction.
(2) Le CSA contrôle le respect des dispositions en la matière prévues dans le contrat de gestion de la RTBF. Consutez la question "Quelles sont les obligations de la RTBF en matière d’égalité et de diversité ?".
(3) Le CSA formule des recommandations en matière d’égalité et de diversité à destination des pouvoirs publics et des acteurs du secteur. Son Collège d’avis remet des avis sur les futurs textes de lois ou politiques de l’audiovisuel à la demande des autorités publiques, notamment en matière d’égalité et de diversité.
(4) Depuis 2011, le CSA réalise un Baromètre de l’Egalité et de la Diversité dans les services de médias audiovisuels actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de dresser un état des lieux de l’égalité et de la diversité dans les différents services sur la base de cinq critères : le genre, l’origine, l’âge, la situation socio-professionnelle et le handicap. Plusieurs éditions du Baromètre Egalité-Diversité des services télévisuels ont été réalisées entre 2011 et 2017. Les trois premières se sont inscrites dans le cadre du Plan pour la diversité et l’égalité dans les médias audiovisuels qui avait été lancé par la ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de l’Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’édition 2017 s’est inscrite, quant à elle, dans le cadre de nouvelles missions confiées au CSA par le législateur*. Enfin, en 2019 le CSA a mis en œuvre un nouveau Baromètre consacré aux services radiophoniques. * Depuis 2016 la législation audiovisuelle prévoit en effet que le CSA participe à la réalisation d’une analyse périodique concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Consultez le site entièrement consacré à ces différentes étude: https://www.csa.be/egalitediversite
(5) Le CSA réalise toute autre recherche en matière d’égalité et de diversité. En effet, outre les Baromètres, le CSA a mené plusieurs recherches portant sur la question de l’égalité. On citera notamment la recherche relative à l’égalité de genre dans les métiers de l’audiovisuel. Elle vise, en autres, à quantifier la présence des femmes et des hommes dans les métiers de l’audiovisuel ainsi qu’à comprendre leurs trajectoires professionnelles. Toutes les études du CSA sont disponibles sur notre site internet.
(6) Le CSA propose des modules de formations à l’égalité et à la diversité. Ils sont dispensés dans les Hautes Ecoles, Universités et Ecoles supérieures artistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de renforcer la formation des futurs professionnels et professionnelles des médias et du cinéma sur la représentation des genres et sur les stéréotypes de genre à l’écran. En savoir plus sur les modules de formation.
(7) Enfin, le CSA participe à divers projets internationaux, notamment sur les questions d’égalité et de diversité. Ainsi, il a piloté le groupe de travail Gender Diversity de l’ERGA. Celui-ci avait pour objectif d’augmenter les connaissances que les autorités de régulation et les acteurs du secteur audiovisuel ont quant aux initiatives existant à travers l’UE destinées à promouvoir l’égalité de genre dans les médias et lutter contre les discriminations. Dans le cadre d’un projet de coopération internationale entre la Tunisie et la Fédération Wallonie-Bruxelles le CSA a réalisé, en partenariat avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA), une recherche relative à la place et à la représentation des femmes dans les fictions télévisuelles.
Le Département Etudes et Recherches du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel poursuit plusieurs objectifs :
- Premièrement, un objectif d’analyse prospective sur le paysage audiovisuel, ses transformations et sur les enjeux régulatoires qui en découlent. Il s’agit de mettre en place des recherches sur un ensemble de thématiques qui se trouvent au cœur de l’activité de régulation : l’égalité et la diversité, la consommation des médias, la communication commerciale, etc. Le département fait connaître les résultats de ces recherches en intervenant à des conférences, des colloques, des cours, des formations, ….
- Deuxièmement, le Département Etudes et Recherches vise à stimuler la recherche sur la régulation, éveiller l’intérêt des étudiants, étudiantes, chercheurs et chercheures sur cette thématique. Il développe des liens entre le CSA et le monde académique, belge et étranger, notamment via l’accueil de stagiaires, le développement d’un centre de documentation, la remise d’un Prix du mémoire, la mise en place d’une newsletter à destination du milieu académique.
- Troisièmement, il s’agit de créer des espaces de dialogue et de débat sur les problématiques qui font l’actualité de l’audiovisuel : colloques et conférences, workshops, séminaires, webinaires, rencontres thématiques avec le secteur, etc.
- Enfin, le dernier objectif est de communiquer de l’information spécialisée sur le secteur au secteur, au monde académique, aux étudiants, étudiantes, chercheurs et chercheures.
En tant que service public, la RTBF a des obligations spécifiques en matière d’égalité et de diversité. Elles sont définies dans son contrat de gestion. Le contrat de gestion de la RTBF stipule que « la RTBF veille à l’absence de toute discrimination dans sa gestion des ressources humaines et met en œuvre un plan relatif à la diversité au sein de son personnel, basé sur le concept de diversité inclusive et relatif à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein, tant pour le recrutement que pour la gestion de carrière, notamment afin d’augmenter progressivement le nombre de femmes dans les fonctions de responsabilité et managériales ainsi que dans les fonctions à forte visibilité (…) ». Plus particulièrement, le contrat de gestion définit quatre axes s’agissant de l’égalité et de la diversité : mettre en œuvre un plan de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein du personnel ; désigner un référent interne chargé de l’égalité hommes-femmes et de la diversité ; adopter la Charte de l’UER sur l’égalité des chances ; soutenir toute initiative visant à renforcer pratiquement la diversité inclusive dans ses services audiovisuels et inciter son personnel en ce sens. Le CSA remet chaque année un avis sur la réalisation de ces obligations. Les avis qui concernent la RTBF sont disponibles via l'onglet "Régulation" de la fiche RTBF sur notre site pluralisme.
| Information
Non. Dans les journaux télévisés et parlés, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion sont interdits. Le placement de produit et l'écran partagé sont interdits dans les journaux télévisés. Les journaux télévisés et parlés, de même que les programmes d'actualité, ne peuvent être parrainés.
Le fact-checking consiste à la fois dans la vérification de la véracité ou l’exactitude des faits, des informations, des chiffres ou encore des images et vidéos présentés dans les médias ou sur internet par des personnes publiques, notamment des personnalités politiques et des experts, ainsi que dans l’évaluation de l’objectivité des médias (traditionnels et sur internet) eux-mêmes dans leur traitement de l’information. L’exercice du fact-checking relève soit d’entités spécifiques au sein des médias traditionnels (Faky pour la RTBF, La Source pour La Libre Belgique en Belgique francophone) ou d’entités non journalistiques spécialisées (NewsGuard, NewsBack). Pour aller plus loin : http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/fact-checking/
Lorsque l'on est confronté à une fausse information ou de la désinformation, il est possible de :
- Signaler le contenu à la plateforme où celui-ci est hébergé (YouTube, Meta, TikTok, etc.)
- Alerter les sites de fact-checking ou de vérification des faits (Faky, La Source, NewsGuard, Hoaxbuster, etc.)
- Alerter les autorités si le contenu est manifestement illégal (appel à la violence, discours de haine, escroquerie, etc.)
- Eviter de relayer l’information pour lui donner plus d’ampleur
Lorsque l'on est confronté à une information douteuse ou au statut incertain, plusieurs actions peuvent être mises en oeuvre :
- Vérifier si l’information est reprise par différents sites d’information ou médias traditionnels
- Vérifier s’il ne s’agit pas d’un site, compte ou blog satirique/parodique (Le Gorafi, NordPresse, Complots faciles pour briller en société, etc.)
- Consulter des sites de fact-checking ou de vérification des faits (Faky, La Source, NewsGuard, Hoaxbuster, )
- Se référer aux pictogrammes de certification des informations
- Consulter l’avis d’experts du sujet concerné ou se référer au consensus scientifique
- Utiliser des logiciels de vérification d’image et de vidéo (Google image inversé, fotoforensics, InVidWeverify, TinEyes, etc.)
- Consulter les métadonnées du contenu
- Echanger avec des membres de mon entourage (famille, amis, collègues, etc.)
- Eviter de relayer l’information pour lui donner plus d’ampleur
Si une fausse information « bien faite » n’est pas identifiable comme telle, il existe toutefois une série d’indices ou de questionnements qui peuvent permettre (d’essayer) de la repérer :
- Qui est l’auteur de l’information, est-il connu (nom, initiales, etc.), semble-t-il fiable, quel est son objectif, quelle est sa légitimité (expert, profane, etc.) à traiter de tel ou tel sujet, etc. ?
- Quelle est la nature du support où l’information circule (médias traditionnels, blog individuel, site « alternatif », blog parodique, etc.), quelle est sa réputation ?
- Les sources, les illustrations et dates de l’information sont-elles correctement référencées et facilement accessibles ?
- Est-ce que l’information est relayée par différents types et supports médiatiques fiables ou reconnus ?
- Est-ce que la syntaxe et/ou l’orthographe semblent corrects ? La rhétorique utilisée est-elle grandiloquente et/ou catastrophiste ? Les titres semblent-ils accrocheurs voire racoleurs ?
- Est-ce que l’information présentée semble cohérente ou non ?
Les fakes news sont des énoncées (discours, images ou montages vidéos – on parle alors de deepfake) délibérément conçus comme faux et mensongers par des acteurs sociaux identifiés ou identifiables (individus isolés, groupements politiques, etc.) situés le plus souvent en dehors ou aux marges du champ du pouvoir et mis volontairement en circulation dans l’espace public, en particulier l’espace numérique (sites internet, réseaux socionumériques, etc.). Ces énoncés mobilisent souvent des affects, des stéréotypes ou des préjugés et ils sont sciemment conçus afin de tromper le public en vue de retombées politiques et/ou économiques favorables à leurs auteurs et/ou défavorables à leurs adversaires, opposants ou concurrents. Pour aller plus loin : https://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2020-2-page-371.htm
Publié par la Commission européenne le 16 juin 2022, le Code Renforcé des Bonnes Pratiques contre la Désinformation (ci-après le Code) vient compléter et remplacer le précédent texte adopté en 2018. Il contient 44 engagements et 128 mesures, qui ne constituent cependant pas une base légale, liés à :
- La publicité commerciale et à caractère politique en ligne (démonétisation)
- La lutte contre les pratiques de manipulation de l’information (« Désinformation »)
- La transparence des données (intelligence artificielle et algorithmes)
- L’accès aux données pour les chercheurs agréés
- Le renforcement et le financement du fact-checking
- La participation au groupe de travail permanent (task-force) et ses sous-groupes
- La mise en place d’un Centre de transparence sous la forme d’un site internet
- Le suivi et l’évaluation du Code
- Mettre en place des politiques afin de démonétiser la désinformation et réprimer les publicités commerciales contenant de la désinformation.
- Adopter une définition commune de la publicité à caractère politique si aucun accord politique portant sur la définition n’était conclu entre colégislateurs européens.
- Fournir des informations transparentes sur le caractère politique des contenus proposés aux usagers, mettre en place des systèmes de vérification et publiciser leurs pratiques en la matière.
- Lutter contre la création et la prolifération de faux comptes (proxies), de bots (comptes en automation), le piratage, l’usurpation d’identité, les deepfake (vidéos truquées) malveillants (non-parodiques), les faux recrutements, les messages payants manquant de transparence diffusés par les usagers ainsi que les actions de manipulation coordonnées (« raids »).
- Développer l’éducation aux médias en ligne (littéracie numérique) et la pensée critique, y compris pour les usagers les plus vulnérables ; mettre en place des outils (flags, labels, pictogrammes) permettant aux usagers d’évaluer la qualité des sources (indicateurs de confiance) établis par des organismes de vérification des faits (fact-checking) indépendants et transparents ; développer la certification par des sources faisant autorité et la possibilité pour les usagers de signaler aisément les contenus trompeurs (« bouton » de signalement).
- Fournir aux chercheurs un accès automatisé aux données non personnelles et anonymisées (conception quantitativiste de la recherche – big data), agrégées ou manifestement rendues publiques par les internautes eux-mêmes.
- Coopérer avec les fact-checkeurs de façon transnationale, transparente, non discriminatoire (notamment sur le plan linguistique) et financièrement viable.
La désinformation relève de la fabrication et la diffusion dans un but stratégique d’un énoncé orienté mais qui semble neutre en apparence. La désinformation relève ainsi d’un ensemble de techniques de manipulation de l’opinion publique par la diffusion d’informations fausses, véridiques mais tronquées ou véridiques avec l’ajout de compléments faux. L’objectif est de donner une image erronée de la réalité, à des fins politiques, économiques ou militaires, à une opinion publique d’un camp adverse. Ce camp peut-être un pays, les partisans d’une idéologie particulière, un groupe social, une entreprise ou un individu. La désinformation se distingue du mensonge, du stratagème, de l’intoxication informationnelle ou de l’idéologie puisqu’elle repose sur trois critères cumulatifs : 1°) l’intention stratégique des auteurs du faux ; 2°) sa médiatisation ou sa publicisation ; 3°) que le processus serve aux intérêts de son initiateur au détriment de la cible. La désinformation se distingue également de la propagande qui comporte une dimension systémique et actionnelle. La désinformation n’est pas liée à l’émergence d’internet. La diffamation, la ruse, la manipulation sont l’objet de recherches et de réflexions depuis l’Antiquité. Historiquement, la désinformation (contrairement aux fake news – fausses nouvelles/informations – contemporaines) provient d’une transformation de l’information initiale par sa dénaturation, sa dé/recontextualisation afin de lui conférer volontairement une nouvelle unité de sens, différente, opposée ou, simplement, erronée. Surtout, la désinformation emprunte les mêmes canaux que l’information et est donc davantage l’apanage des dirigeants politiques. Dit autrement, la désinformation, qui ne se reconnaît jamais comme telle, participe au même titre que la propagande de stratégies mises en œuvre par les gouvernants afin de peser sur l’opinion publique. De ce point de vue, contrairement aux fake news, la désinformation ne fait pas l’objet de contre-discours ou de mesures répressives de la part des pouvoirs publics et des médias. http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/desinformation/
Tout éditeur privé de service de médias audiovisuels, distribué via une plateforme de distribution fermée, doit, s’il diffuse de l’information :
- faire assurer, par service, la gestion des programmes d’information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d’emploi, et reconnus comme journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité ;
- établir un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité dans le traitement de l’information et s’engager à le respecter ;
- reconnaître une société interne de journalistes en qualité d’interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l’organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d’information et sur la désignation du rédacteur en chef.
- être membre de l’Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique
En tant que régulateur du secteur des médias audiovisuels, il revient au CSA de veiller au bon respect de la réglementation du secteur selon le cadre défini dans le « décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ». Le CSA est notamment compétent en matière de protection des mineurs, de discriminations et discours de haine, d’égalité entre les femmes et les hommes, de communication commerciale, de respect du pluralisme, etc. Le Conseil de déontologie journalistique, créé en 2009, est un organe d’autorégulation des médias francophones et germanophones de Belgique. Le CDJ est compétent pour traiter les questions qui relèvent de la déontologie journalistique quel qu’en soit le support (presse écrite, radio, télévision, sites internet, blogs, réseaux sociaux). Ces questions s’articulent en quatre volets : respect de la vérité, indépendance, loyauté, droit des personnes. En raison de leurs champs de compétence respectifs, le CSA et le CDJ sont amenés à traiter, des questions en lien avec la déontologie et l’information qui se recouvrent parfois. Dans le but d’améliorer les processus de collaboration, les deux instances se réunissent régulièrement et publient un rapport annuel commun.
Non. Sauf pour ce qui concerne la RTBF, les médias de proximité qui doivent diffuser des programmes d’’information, la décision de diffuser ou non de l’information relève des choix programmatiques de l’éditeur.
Selon une Recommandation du Collège d’avis du CSA, relèvent a priori de la catégorie des programmes d’information, les programmes, quel que soit leur format ou syntaxe, conçus comme visant à communiquer au public via un service de média audiovisuel, des contenus d’actualité faisant l’objet d’un traitement de nature journalistique et éventuellement réalisés par des journalistes professionnels. Ces contenus ont notamment trait à l’actualité économique, politique, sociologique, culturelle et sportive et répondent à des objectifs d’intérêt général pour le public. Leur traitement, dans une perspective régulatoire, vise à rencontrer les principes d’équivalence de traitement, de proportionnalité et de cohérence, et ce, dans le respect des objectifs fixés par le législateur.
En tant qu’autorité administrative indépendante en charge de la régulation du secteur des médias audiovisuels, il revient notamment au CSA de veiller au bon respect de la réglementation. Toute une série d’articles du décret coordonné sur les services de médias audiovisuel ont pour objectif de garantir la liberté et l’indépendance éditoriale de l’éditeur de SMA et du personnel appelé à traiter l’information et cela en lien avec les programmes dédiés à l’information et également d’assurer la qualité de l’information dans les programmes. Afin d’assurer la cohérence et l’égalité de traitement entre les éditeurs dans le cadre de la régulation, le Collège d’avis du CSA a établi une « Recommandation relative aux programmes d’information », texte qui permet également de clarifier la notion de programme d’information. Consulter la Recommandation information
| Influenceurs, influenceuses
Le CSA. Il est le garant de la législation audiovisuelle. Il traite les plaintes du public. Il effectue également des contrôles du respect de la réglementation publicitaire. Vous pouvez lui poser toute question relative à vos activités, il vous réorientera le cas échéant. En fonction des thématiques, d’autres institutions pourraient prendre contact avec vous, notamment : Le SPF Économie. Il est compétent pour la protection des consommateurs. Il intervient en cas de publicité trompeuse, c’est-à-dire lorsque la publicité n’est pas correctement identifiée ou lorsque le message publicitaire tente de duper le public sur les qualités réelles d’un produit ou d’un service. Plus d’information : https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/publicite/vous-etes-createur-de-contenu Le Jury d’éthique publicitaire. Il veille au respect de la législation publicitaire par vos partenaires commerciaux que sont les marques, les annonceurs. https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/recommandations_du_conseil_de_la_publicite_influenceurs_en_ligne_fr.pdf La Commission des jeux de hasard. Elle encadre la publicité spécifique pour les jeux d’argent : casinos, paris, etc. Si un annonceur de ce type prend contact avec vous, deux réflexes s’imposent : 1. refuser le partenariat si votre communauté est largement mineure. 2. vérifier qu’il s’agit un organisme de jeu autorisé en Belgique. La Commission tient à jour une liste des sites illégaux : https://gamingcommission.be/fr/commission-des-jeux-de-hasard/jeux-de-hasard-illegaux/liste-des-sites-de-jeux-de-hasard-illegaux
NON. Vous devez garder la maitrise éditoriale sur votre vidéo. C’est votre création, votre communauté, votre crédibilité. La marque partenaire peut faire des propositions de scripts, de réalisation, de montage, mais vous devez pouvoir prendre toutes les décisions finales.
NON. Sur la plupart des plateformes, il vous est possible d’accepter l’insertion de spots publicitaires avant ou pendant vos vidéos. Vous recevez dans ce cas une rémunération proportionnelle à votre nombre de vues. Contrairement aux cas exposés précédemment, c’est ici la plateforme qui choisit l’annonceur, le spot, sa durée et parfois même ses modalités d’insertion. Vous n’avez donc pas de contrôle sur ces aspects. Sur certaines plateformes, vous pouvez toutefois définir le moment que vous jugez opportun, en tant que créateur.trice, pour l’insertion du spot publicitaire dans votre vidéo. Il s’agit alors d’identifier une pause, un genre de « respiration », et d’indiquer le « time code » précis au moment duquel la publicité pourra être insérée sans qu’elle interrompe brusquement une phrase ou une action. Cette précaution indispensable rencontre deux objectifs : elle maintient un certain confort de visionnage pour votre communauté, elle respecte votre vidéo, son contenu, son intégrité.
OUI. Les règles décrites ici s’appliquent à toutes les plateformes de partage de vidéos existantes (et à venir) : YouTube (en ce compris les Lives et les Shorts), Instagram (en ce compris les Stories, Reels et Live), TikTok (en ce compris les Lives), Facebook Watch, Twitch, ...
L’audience des vidéastes sur Internet est globalement plus jeune que celle des télévisions traditionnelles. Le CSA constate d’ailleurs que certaines chaînes, sur YouTube par exemple, semblent s’adresser spécifiquement à des enfants ou à des adolescent.e.s. Si c’est votre cas, vous devez prendre des précautions supplémentaires : il est notamment interdit d’inciter directement les mineurs à l’achat par des formules de type « achetez tout de suite via ce lien », « ajoutez à votre panier », « achetez vite », « attention il n’y a plus de stock »… De plus, si votre communauté est largement composée de mineurs, vous ne pouvez pas faire de la publicité pour de l’alcool, vous devez également veiller à ne pas faire de la publicité pour des aliments trop gras, trop salés ou trop sucrés. Le Code de publicité pour les denrées alimentaires et le Belgian Pledge interdise la publicité pour les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de 13 ans.
Oui. À certaines conditions : - elle ne cible pas les mineurs en s’adressant spécifiquement à eux ou en affichant des mineurs consommant ce genre de boissons ; - elle ne présente pas la consommation de boissons alcoolisées comme un symbole de maturité ; - elle ne représente pas des personnes conduisant sous l’emprise de l’alcool ; - elle n’établit aucun lien entre la consommation d’alcool et une amélioration des performances physiques ou de la conduite motorisée ; - elle ne crée pas l’impression que la consommation d’alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels ; - il n’y est pas suggéré que les boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions ; - elle ne peut pas inciter à une consommation immodérée, irréfléchie ou illégale. Une Convention intersectorielle en matière de publicités et de commercialisation de boissons contenant de l’alcool vient compléter la législation existante.
Non. La législation interdit la publicité pour les armes, le tabac et les produits associés (en ce compris les cigarettes électroniques et le CBD à fumer), les soins médicaux et la chirurgie esthétique, les désherbants à base de glyphosate. En outre, une législation spécifique est en cours d’élaboration afin d’interdire la publicité pour les jeux de hasard (casinos, paris sportifs, etc.).
La première chose, c’est l’identifier ! En effet, si votre communauté n’est pas clairement informée, il s’agit de « publicité trompeuse » ou de « publicité clandestine », ce qui constitue une infraction à plusieurs lois et décrets. Avant toute chose, sachez que la loi impose aux plateformes sur lesquelles vous diffusez vos vidéos (Youtube, TikTok, etc.) de mettre à votre disposition une fonctionnalité d’identification de la publicité. Le CSA vous recommande d’utiliser cette fonctionnalité. Elle permet d’associer automatiquement à votre vidéo un message d’information de type « inclut de la publicité ». Toutefois, cette précaution n’est pas suffisante pour garantir une information claire de votre communauté. En effet, d’une part, ces mentions restent limitées en visibilité (taille, durée d’apparition), et d’autre part, elles ne permettent pas, lorsque plusieurs marques apparaissent dans la vidéo, d’identifier celles qui font spécifiquement l’objet d’un partenariat publicitaire. Vous devez par conséquent fournir une information complémentaire. Le CSA sait que vous connaissez votre communauté mieux que quiconque. C’est donc à vous que revient le choix de la méthode d’identification la plus adaptée, tant que vous combinez au minimum une mention orale et une mention écrite.
- Mention orale pendant la vidéo
- Mention écrite pendant la vidéo
- Mention écrite dans le titre de la vidéo
- Mention écrite dans le descriptif de la vidéo
- une mention orale dans la vidéo, en début de vidéo ou de séquence de communication commerciale ;
- la mention « publicité » en toutes lettres apparaissant en début de descriptif ou de post, afin d’avertir votre communauté que la vidéo contient de la communication commerciale, sans qu’ils n’aient à procéder à aucune manipulation supplémentaire ;
- la mention « publicité » en toutes lettres apparaissant durant toute la durée de la communication commerciale afin d’éviter toute confusion sur la nature commerciale de la part de votre communauté Dans le cas spécifique d’un branded content, la mention publicité doit apparaître durant toute la durée de la vidéo.
- l’activation de la fonctionnalité de la plateforme.
- une mention orale dès le début de la vidéo ;
- la mention « publicité » en toutes lettres apparaissant durant toute la durée de la vidéo ;
- l’activation de la fonctionnalité de la plateforme.
OUI. Si vous proposez de gagner un produit qui vous a été offert par une marque, il s’agit d’une forme de contrepartie car disposer gratuitement d’un « lot » vous permet de stimuler la relation avec votre communauté au travers d’un jeu-concours. De plus, pour favoriser la participation vous aurez naturellement tendance à valoriser ce que vous proposez de gagner. Dans la plupart des cas, il s’agit donc de publicité.
OUI. Passé un certain niveau d’audience et de professionnalisation, vous pourriez, comme beaucoup de vidéastes, décider de commercialiser des produits « dérivés » : vêtements, cosmétiques, spectacles… Si c’est le cas, et que vous valorisez ces produits dans vos vidéos, les mêmes règles s’appliquent : afin d’être transparent avec votre audience, vous devez l’informer que ce sont vos produits et que vous en faites dès lors la publicité. Vous êtes en quelque-sorte votre propre annonceur.
On parle légalement de publicité sitôt que : 1. vous abandonnez votre objectivité, 2. vous valorisez une marque dans vos vidéos 3. en échange d’une contrepartie :
- Votre objectivité, c’est votre intégrité, vos opinions, votre liberté éditoriale et créative.
- La valorisation, c’est en général un discours positif tenu à l’oral, ou une apparition intentionnelle de la marque à l’écran (produit, logo…).
- La contrepartie peut prendre plusieurs formes : une rémunération, un produit ou un service offert, une réduction, un pourcentage sur des ventes, un lot à faire gagner à votre communauté, etc.
Il peut arriver que vous soyez contacté.e par des marques ou des agences afin de conclure des partenariats publicitaires. Comme c’est le cas pour les médias traditionnels, ces revenus vous permettent de financer vos productions et de vous professionnaliser. Cependant, faire de la publicité, c’est encadré par la loi, tout n’est pas permis… Il convient dès lors d’adopter quelques bons réflexes. De manière générale, vous devez rester « transparent ». Cela signifie que la publicité doit toujours être clairement identifiable. Lorsqu’une marque apparait dans une de vos vidéos, quelle que soit la manière, votre communauté doit savoir si c’est à des fins publicitaires. Aucun doute ne peut subsister. D’ailleurs, l’identification de la publicité vous permet de maintenir la relation de confiance que vous avez construite avec votre communauté, c’est donc aussi dans votre intérêt de le faire. Si vous n’identifiez pas la publicité, c’est une infraction et plusieurs instances peuvent intervenir selon les cas : le CSA, bien sûr, mais également le SPF Économie, ou encore le Jury d’éthique publicitaire. Ces infractions peuvent mener à des amendes importantes.
Vous êtes considéré.e comme éditeur ou éditrice responsable. Cela signifie que vous êtes légalement responsable des vidéos que vous proposez à votre communauté. Ce qui implique certaines précautions, comme par exemples : identifier la publicité ou protéger les mineurs face aux contenus susceptibles de les heurter.
Vous publiez des vidéos sur Youtube, TikTok, Twitch, Instagram… ? Vous habitez en Wallonie ou à Bruxelles ? Vous utilisez principalement le français dans vos vidéos et/ou pour communiquer avec votre communauté ? Pour garantir la sécurité juridique de vos activités audiovisuelles, vous devez les signaler au CSA. Il s’agit d’une obligation légale qui s’accomplit via un court formulaire. Il suffit de renseigner votre nom, celui de vos vlogs, ainsi qu’une adresse courriel de contact. Le CSA garantit la stricte confidentialité des données transmises.
Les Belges francophones sont de plus en plus nombreux.ses à se lancer dans la création de vidéos sur Internet (YouTube, TikTok, Twitch, Instagram…). Le CSA encourage ce mouvement de réappropriation des médias par les citoyennes et les collectivités. En effet, ces nouvelles offres de programmes, en augmentation constante, sont un apport considérable pour la diversité de notre paysage audiovisuel. Le CSA dialogue avec les influenceurs et les influenceuses: il les sensibilise au cadre légal de leurs activités, il met son expertise à leur disposition, il les aide à réseauter, il relaye les enjeux liés à leur développement, notamment auprès de la presse et des pouvoirs publics. Au vu du développement de leurs audiences et de leurs activités commerciales, les influenceur.euse.s sont considéré.e.s comme des éditeurs de service de média audiovisuels au regard de la législation. Le CSA veille dès lors au respect de certaines règles. Cette section du site vous propose un récapitulatif de la législation qui encadre leurs activités audiovisuelles.
| Médias et élections
La diffusion de débats électoraux la veille du scrutin est interdite. Le règlement prévoit cependant une exception "en cas d'urgence dûment motivé par des circonstances exceptionnelles". Le cas échéant, l’éditeur veillera tout particulièrement à respecter le caractère équilibré et représentatif des différentes tendances idéologiques, philosophiques et politiques.
Le règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale prévoit qu’un animateur, présentateur, journaliste, candidat à une élection s’abstienne:
- de faire état de sa candidature dans ses fonctions ;
- et d'être présent à l’antenne durant la campagne électorale.
En matière d'accès à l'antenne, les éditeurs de services bénéficient de la liberté éditoriale, dans le respect de leur règlement d’ordre intérieur pour les éditeurs privés, et des règles spécifiques qui leurs sont applicables pour les éditeurs publics.
Toutefois, les éditeurs de services ont établi un "cordon sanitaire" et s’interdisent de donner l'accès aux tribunes et débats électoraux qu'ils diffusent à des représentants de partis, mouvements ou tendances politiques prônant des valeurs liberticides ou racistes, sur base des dispositions contenues dans la loi du 30 juillet 1981 pénalisant les actes racistes et xénophobes (dite « loi Moureaux »), dans la loi du 23 mars 1995 réprimant le négationnisme, dans le décret sur les services de médias audiovisuels et dans la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme. Ils ne diffusent pas non plus d'émissions où des représentants des partis, mouvements ou tendances précités interviendraient en direct.
Les éditeurs sont invités à consulter le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ou la Commission nationale permanente du Pacte culturel pour se renseigner sur le caractère antidémocratique d'un parti.
Oui. Le règlement sur les programmes de radio et de télévision en période électorale acquérant force obligatoire, son article 7 prévoit que les éditeurs adoptent désormais des dispositions spécifiques au sein d'un dispositif électoral. Ils doivent transmettre ce dispositif au CSA pour information et le mettre à la disposition du public sur leur site internet, ou, s’ils n’en disposent pas, sur le site internet du CSA.
Le dispositif électoral doit expliquer les modalités de mise an oeuvre par l'éditeur de toutes les dispositions du règlement qui s'appliquent à sa propre situation. Tous les éditeurs sont concernés au moins par les "dispositions générales" du règlement qui concernent l'ensemble des programmes diffusés durant la période électorale.
Les éditeurs sont invités à déléguer à leur rédaction l'élaboration des éléments de leur dispositif électoral relatifs aux programmes électoraux et d'information. En tout état de cause, la rédaction rendra un avis sur ces éléments avant apporbation du dispositif par le conseil d'administration du service de médias. Lorsqu'un éditeur ne recourt aux services d'un journaliste professionnel que dans le cadre de la campagne - ce qui est obligatoire pour la gestion de ses programmes électoraux et d'information en période électorale -, c'est ce journaliste qui rend l'avis précité.
Par ailleurs, tout éditeur de services doit, en règle générale, adopter un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité dans le traitement de l’information et s’engager à le respecter.
Dans la perspective de chaque échéance électorale, le CSA (le Collège d’avis) adopte un règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale qui détermine quels sont les principes à respecter, en matière d’information notamment, dans les trois mois qui précèdent le scrutin. Ce règlement a force obligatoire ayant été approuvé le 3 mars 2012 par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans la perspective des élections communales d'octobre 2012. Les recommandations du Collège d’avis sont débattues et adoptées par les acteurs concernés.
Le CSA recueille les dispositifs électoraux adoptés par les éditeurs et en assure, le cas échéant, la publicité sur son site. Il assure également une mission d'information quant au contenu du règlement adopté par son Collège d'avis.
Le CSA (Collège d’autorisation et de contrôle) exerce enfin une mission de contrôle et a le pouvoir de sanctionner des éditeurs de services en cas d’infraction aux lois, décrets et règlements en matière d’audiovisuel ou de violation d’obligation conventionnelle.
Ce règlement est adopté par le Collège d'avis du CSA en prévision des échéances électorales. Il a force obligatoire ayant été adopté sous forme d'arrêté le 23 mars 2012 par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le règlement s'adresse à l'ensemble des éditeurs de services de médias audiovisuels de la FWB qu'ils consacrent ou non des émissions ou parties d'émissions aux élections. Il s'applique durant les trois mois qui précèdent la date du scrutin. Les services édités sur plateforme ouverte "édités par ou pour le compte de candidats, listes, idéologies ou partis et ouvertement dédiés à la communication électorale de ceux-ci" sont exclus du champ d'application du règlement.
Les dispositions inscrites au règlement sont issues à la fois des textes légaux et des pratiques et usages des éditeurs.
Le règlement comporte deux parties: le texte du règlement proprement dit est en effet précédé d'une "note explicative" qui pourra éclairer les éditeurs sur le contenu des dispositions applicables. Cette note explicative fait partie intégrante du règlement.
| Pluralisme et transparence des médias
Depuis 2012, le Centre pour le pluralisme des médias (CMPF), a mis en place un outil, le Pluralism Monitor qui vise à mesurer le pluralisme des médias dans chaque pays. Ce moniteur s’intéresse au pluralisme en étudiant l’écosystème médiatique dans sa totalité, en passant par la TV, la Radio, la distribution, la presse écrite et les médias digitaux. Cet exercice est entrepris à ce jour par les 28 pays de l’Union Européenne. Les rapports sont publiques et consultable sur leur site.
Pour évaluer la sauvegarde du pluralisme, le CSA a décidé d’implémenter la méthode du « Media Pluralism Monitor ». Cet outil développé, entre autres, par le Center for media pluralism and media freedom (CMPF) analyse le marché selon quatre composantes (protection de base, conditions de marché, indépendance politique et inclusion sociale) et trois indicateurs (légal, socio-démographique, économique). Le but est de réaliser un monitoring régulier afin de détecter les menaces qui pèseraient sur la notion de pluralisme médiatique. Les indicateurs sont pensés dans un cadre global, convivial, simple et regroupant les différents domaines de risques auxquels le pluralisme est soumis. Il aide les prises de décisions politiques en leur fournissant un outil et les moyens pour mettre en lumière les risques potentiels, permettant une comparaison entre les différents pays et les réponses apportées dans les différentes. En effet, ce monitoring est réalisé par les 28 pays de l’Union Européenne et son consultable sur leur site (https://cmpf.eui.eu/). Cet outil est mis à jour par le CMPF afin d’y inclure les nouveaux risques auxquels le pluralisme pourrait être soumis.
La notion de position significative dans le secteur audiovisuel est comparable à la notion de position dominante telle que définie en droit de la concurrence, mais s'en distingue en ce qu'elle se réfère à des critères et une intensité de la concentration spécifiques au secteur audiovisuel. Selon le décret sur les services de médias audiovisuels, l'exercice d'une position significative survient notamment dans les cas où : Une personne physique ou morale détient plus de 24% du capital de deux éditeurs de télévision ou de radio; L’audience cumulée de plusieurs éditeurs de service télévisuels, détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale atteint 20% de l'audience totale. L’audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique ou numérique détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l’audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique ou numérique. Par « audience potentielle cumulée », il faut entendre la somme des populations recensées sur le territoire de la Communauté française, défini comme regroupant les territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que ces populations sont desservies par une ou plusieurs radiofréquences, agrégées ou non en réseaux, constituant le plan de radiofréquences de référence de la Communauté française ; Il est important de nommer le concept d’abus de position dominante. Il consiste, pour une entreprise présente sur un marché, ou un groupe d'entreprises, à adopter un comportement visant à éliminer, à contraindre ou encore à dissuader tout concurrent d'entrer ou de se maintenir sur ce marché ou un marché connexe, faussant ainsi la concurrence et de fait le pluralisme des médias.
La transparence des éditeurs est une composante essentielle du pluralisme puisqu'elle permet au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et opinions diffusées dans les programmes de radio et de télévision. C'est la raison pour laquelle les éditeurs de services (radios et télévisions) ont l'obligation de rendre publique, sur leur site internet ou sur celui du CSA, une série d'informations les concernant. Il s'agit entre autres, des services édités, de l'actionnariat, du conseil d'administration, des derniers comptes annuels. C'est le gouvernement de la Communauté française qui fixe la liste de ces informations par arrêté. Transparence aussi à l'égard du régulateur : au moment de leur autorisation et lors du contrôle annuel, les éditeurs et distributeurs de services communiquent au CSA des informations afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle, ainsi que leur degré d'indépendance. Ces informations reprennent, entre autres, l'actionnariat et les participations de l'éditeur ou du distributeur ainsi que la liste des fournisseurs de ressources qui interviennent de façon significative dans la mise en œuvre des programmes. Ce principe de transparence est primordial car il permet d'une part, de rendre des informations essentielles accessibles au public et d'autre part, au CSA d'assurer une veille visant à prévenir les risques d'atteinte au respect du pluralisme.
Selon le décret sur les services de médias audiovisuel (art. 2.2-2), il faut entendre par offre pluraliste "une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées".
- Pluralité de médias : ce premier indicateur consiste à évaluer dans quelle mesure le public a accès à un nombre suffisamment élevé de médias et à mesurer l'impact respectif de ceux-ci sur l'audience et sur le marché. Une offre plurielle est une condition nécessaire d'un paysage audiovisuel reflétant la diversité culturelle, politique, d'idées et d'opinions, et garantissant la liberté d'information; tout aussi nécessaire, la mesure de son impact sur le public. En effet, une situation monopolistique ou oligopolistique dans laquelle un ou quelques médias imposeraient leurs points de vue et façonneraient l'opinion publique en faveur d'intérêts particuliers est contraire aux valeurs d'un état démocratique.
-
Médias indépendants et autonomes : il s'agit là de mesurer si le public dispose d'un accès à une offre médiatique dont les composantes sont suffisamment indépendantes et autonomes les une des autres. Pour évaluer le degré d'indépendance des télévisions ou des radios, on identifiera principalement le groupe média auquel elles appartiennent, ainsi que leur poids économique et leur impact sur le paysage audiovisuel. L'autonomie des services dépend quant à elle du nombre et de la diversité de fournisseurs de sources d'informations ou de contenus auxquels les éditeurs ont recours pour établir leur programmation.
-
Diversité d'opinions : le pluralisme se mesure également au regard du nombre et de la variété de sources d'informations auxquelles les journalistes font appel ainsi qu'au processus de collecte de l'information. Des sources et journalistes communs, des rédactions communes ou encore des partenariats au sein d'un même groupe médias constituent des indices pouvant affecter l'accès du public à une diversité d'opinions.
-
Diversité d'idées : le degré global de pluralisme dans les médias est également conditionné par la variété des contenus et la manière dont ils sont produits. Si les programmes d'informations sont essentiels pour assurer la liberté d'expression, d'autres catégories de programmes peuvent aussi véhiculer plus largement des idées et influencer, même si c'est indirectement, le point de vue des individus sur la société. Là encore, des liens structurels tels qu'un personnel ou des programmes communs, le recours à des fournisseurs de programmes ou d'autres ressources identiques ou encore des partenariats privilégiés intragroupes sont des indices susceptibles d'affecter une diversité d'idées.
Pour assurer la transparence, le décret sur les services de médas audiovisuels (art. 6) impose aux éditeurs et aux distributeurs de rendre publiques certaines informations de base les concernant. Cette publicité a pour but d'assurer la transparence des structures de propriété et de contrôle ainsi que le degré d'indépendance des éditeurs et des distributeurs et doit permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes de l'éditeur. Le Gouvernement a fixé la liste de ces informations qui doivent être disponibles sur le site internet des éditeurs (lorsqu'ils en disposent) ou sur demande écrite à leur adresser. Il s'agit de :
- leur dénomination, ainsi que, s’ils sont constitués sous forme de personne morale, leur siège social et leur forme juridique ;
- leurs coordonnées téléphoniques ;
- leur adresse de courrier électronique
- leur adresse de site web ;
- leur numéro de T.V.A. (ou numéro d'entreprise) ;
- Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, la liste des actionnaires et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité ;
- Lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres. Chaque membre est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité ;
- La liste des membres du conseil d'administration et, le cas échant, leur mandant ;
- La liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière ;
- La liste des services de médias audiovisuels édités ;
- Les bilan et compte de résultats du dernier exercice financier ;
- Les coordonnées du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services.
Le Pluralisme des médias est un concept qui va au-delà de la propriété des médias. Il embrasse pleins d’aspects comme le contrôle des fusions, la liberté éditoriale, la capacité d’exercer le journalisme, la garantie d’informer et de la liberté d’expression, la représentation des minorités, etc.. En résumé, il rend compte de toutes les mesures assurant un accès aux citoyens aux différentes sources d’informations sans l’influence indue d’une opinion dominante. (European Commission, Commission Staff Working Document, SEC(2007)32, 5)
Il s'agit d'un indicateur qui consiste à évaluer dans quelle mesure le public a accès à un nombre suffisamment élevé de médias et à mesurer l'impact respectif de ceux-ci sur l'audience et sur le marché. Une offre plurielle est une condition nécessaire d'un paysage audiovisuel reflétant la diversité culturelle, politique, d'idées et d'opinions, et garantissant la liberté d’information ; tout aussi nécessaire, la mesure de son impact sur le public. En effet, une situation monopolistique ou oligopolistique dans laquelle un ou quelques médias imposeraient leurs points de vue et façonneraient l'opinion publique en faveur d'intérêts particuliers est contraire aux valeurs d'un état démocratique. Le pluralisme structurel vise donc à diversifier l’actionnariat pour assurer les conditions structurelles de diversité de marché.
D’après le Décret relatif aux services de médias audiovisuels, le rôle du CSA en matière de pluralisme consiste en une veille sur les marchés qu’il régule. Le CSA peut constater des atteintes au pluralisme et prendre des mesures correctrices. 1° Lorsqu’une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d’un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24%du capital d’un autre éditeur de services télévisuels ; 2° lorsqu’une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d’un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24% du capital d’un autre éditeur de services sonores ; 3° lorsque l’audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de l’audience totale des éditeurs de services télévisuels ; Par « audience cumulée », il faut entendre, le nombre de téléspectateurs différents dans la cible "4 ans et plus" calculé pendant une durée ou une plage horaire définie ; Enfin, Le Collège d’autorisation et de contrôle procède régulièrement, et au moins tous les deux ans, à l’évaluation du pluralisme.
| Publicité, communication commerciale
La RTBF, entreprise publique culturelle autonome, est financée principalement par une dotation de la Communauté française et par des ressources commerciales (publicité, parrainage, commission sur les appels téléphoniques payants et vente de produits dérivés). La part de la publicité commerciale ne peut pas dépasser 25 % des ressources annuelles de la RTBF. Ce financement mixte est caractéristique des éditeurs publics de télévision et de radio en Europe, à l’exception de la radio-télévision publique britannique (BBC), financée exclusivement par la redevance et la vente de produits dérivés et de la radio-télévision publique portugaise (RTP) financée exclusivement par des ressources commerciales. Le financement partiel de la radio-télévision publique par la publicité commerciale est le plus souvent justifié par l’impossibilité pour les pouvoirs publics de financer l’ensemble des activités du service public ou décrite comme un moyen d‘assurer une autonomie relative du service public par rapport aux pouvoirs publics. Inversement, les ressources publiques sont la contrepartie des missions de service public qui lui sont imposées. L’équilibre entre les impératifs d’intérêt général et les contraintes de la concurrence est assuré par l’entreprise dans le cadre de l’autonomie de gestion dont elle dispose en vertu du décret et des obligations découlant du contrat de gestion, obligations dont le respect est contrôlé chaque année par le CSA.
Oui. Selon le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, la publicité et l’autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. La diffusion d’œuvres de fiction cinématographique, d’œuvres de fiction télévisuelle, à l’exclusion des séries et des feuilletons, de programmes d’actualités, de documentaires, de programmes religieux et philosophiques non confessionnels, peut être interrompue par la publicité et l’autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins. Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les médias de proximité, la publicité et l’autopromotion ne peuvent interrompre ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme. La publicité et l’autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et philosophiques non confessionnelles. Les spots isolés de publicité et d’autopromotion doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. La RTBF, tout comme les médias de proximité, ne peut diffuser de programmes de télé-achat.
Oui, dans le respect de la législation fédérale sur les dépenses électorales. L’interdiction, initialement prévue dans la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été levée suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010. Toutefois, le contrat de gestion de la RTBF interdit la publicité et le parrainage pour les partis politiques et les candidats aux élections européennes, fédérales, communautaires, régionales, provinciales et communales, ainsi que les organisations syndicales et patronales, à l’exception des campagnes d’intérêt général émanant de plateformes intersyndicales ou interpatronales. Consultez également notre section "Médias et élections" de notre site
Oui. Seule la publicité pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé est interdite. Le jeu de hasard est défini comme étant « tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou pari pour le lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ». La Commission des jeux de hasard est chargée d'accorder les licences pour exploiter des jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard.
Oui, moyennant le respect de certaines règles. La publicité pour l’alcool relève d’une compétence de l’Etat fédéral qui a privilégié la conclusion d’une convention avec les différents secteurs concernés (producteurs, distributeurs, fédérations horeca, organisations de consommateurs, jury d’éthique publicitaire). Cette convention établit une série de règles relatives notamment aux mineurs d’âge, à la publicité pour des boissons alcoolisées et à leur distribution, ainsi que des dispositions relatives aux médias. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que les radios et télévisions diffusant de la publicité en faveur des boissons alcoolisées mettent gratuitement à la disposition du gouvernement des espaces publicitaires pour la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services. Par ailleurs, le contrat de gestion de la RTBF interdit la publicité commerciale et de parrainage pour les boissons alcoolisées titrant à plus de 20 degrés. Enfin, le Collège d'avis du CSA a adopté un code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants. Il prévoit que la publicité pour les boissons contenant de l'alcool, quelle qu'en soit la teneur, ne peut être spécifiquement adressée aux enfants, ni présenter des mineurs consommant lesdites boissons, et que ces publicités ne peuvent être diffusées pendant les émissions pour enfants, ni dans les écrans publicitaires diffusés immédiatement avant ou après celles-ci.
Non. Cette interdiction ne figure toutefois pas dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dans la mesure où il s'agit d'une interdiction générale (tous médias confondus) énoncée par article du code pénal. Le respect de cette interdiction incombe donc aux tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire (Etat fédéral) et non au CSA.
Oui, moyennant le respect de certaines règles. De manière générale, est autorisée la publicité pour les médicaments qui sont admis sur le marché belge. Cette publicité ne peut pas être trompeuse et doit encourager un usage rationnel du médicament, sans en exagérer les propriétés. À ce titre, les mentions obligatoires relatives à un bon usage du médicament doivent être communiquées de manière lisible. En ce qui concerne la publicité auprès du grand public, seule la publicité pour les médicaments en vente libre (sans ordonnance) est autorisée, sous réserve d’un contrôle préalable à sa diffusion. En télévision et en radio, ce contrôle prend la forme d’un visa octroyé par le ministre de la Santé publique, sur avis de la Commission de contrôle de la publicité des médicaments. Pour ce qui est des autres médias, les publicités diffusées doivent être notifiées auprès de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) au moins 30 jours avant leur diffusion. De plus, la publicité à destination des enfants est interdite. Pour plus d’informations, consultez le site de l’AFMPS. En regard de la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, outre le respect des principes fondamentaux que doit respecter toute publicité, les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, de la Région wallonne et de la Commission communauté française, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d’éducation pour la santé ayant reçu l’accord des autorités compétentes, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.
Non. Comme indiqué dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, les éditeurs de services de médias audiovisuels et les fournisseurs de services de partage de vidéos ne peuvent diffuser, sur l’ensemble de leurs services, de la communication commerciale pour les cigarettes et autres produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et leurs recharges. Le Contrat de gestion de la RTBF fait également état de l’interdiction de publicité et de parrainage pour le tabac, les produits à base de tabac et produits similaires tout comme les biens ou services évoquant directement ou indirectement, des marques de tabac, de produits à base de tabac ou similaires.
Oui, moyennant le respect de certaines dispositions. En effet, le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que la communication commerciale ne doit pas porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères suivants pour leur protection. voir aussi: De quelle protection bénéficient les mineurs en matière de communication commerciale ? En outre, la publicité à destination des enfants fait l'objet des certaines restrictions présentes dans un code d'éthique adopté par le Collège d'avis du CSA. Ce code définit le message publicitaire destiné aux enfants comme "tout message concernant un produit ou un service dont les enfants sont les principaux utilisateurs et qui est présenté, dans sa forme, de telle façon qu'il s'adresse spécifiquement à un public d'enfants de moins de 12 ans".
Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels précise que la communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit respecter les critères suivants pour leur protection :
- Elle ne peut encourager un usage excessif de produits alimentaires et de boissons contenant des acides gras trans, du sel, du sodium ou des sucres ;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;
- elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
- elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
- Ainsi, l’éditeur de service public ne peut diffuser de publicité et de parrainage moins de 5 minutes avant et après les programmes de radio et de télévision, spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, et identifiés comme tels par la RTBF dans ses grilles de programmes ;
- la RTBF ne peut insérer de publicité et de parrainage avant, pendant ou après les programmes proposés à la demande et s’adressant spécifiquement à des mineurs de moins de 12 ans.
- en outre, la RTBF ne peut insérer aucune publicité sur le site internet de La Trois, ni aucune publicité sous forme de « prerol » avant les programmes pour enfants accessibles dans l’offre de services de médias audiovisuels non linéaires de la RTBF.
Non. Dans les journaux télévisés et parlés, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion sont interdits. Le placement de produit et l'écran partagé sont interdits dans les journaux télévisés. Les journaux télévisés et parlés, de même que les programmes d'actualité, ne peuvent être parrainés.
Certains programmes ne peuvent être interrompus : les journaux télévisés, le programmes pour enfants et les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.
Les autres programmes sont soumis aux règles suivantes:
- Les films, les œuvres de fiction télévisuelle (ne comprenant pas les séries et les feuilletons), les programmes d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle peuvent être interrompus par de la publicité, du télé-achat et/ou de l'autopromotion toutes les 30 minutes.
En outre, sur la RTBF et des télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre une œuvre de fiction cinématographique, ni une œuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. Une dérogation introduite par le décret du 17 décembre 2009 permet à la RTBF d’interrompre les œuvres de fiction cinématographique par de la publicité et de l’autopromotion jusqu'au 31 décembre 2012. Il s’agit d’un corollaire du plan d’économie imposé à cet éditeur. Le contrat de gestion de la RTBF (2013-2017) prévoit que le Gouvernement s'engage à déposer un projet de décret devant être adopté avant le 31 décembre 2014 supprimant l'interdiction de la coupure publicitaire des œuvres de fiction cinématographique à la RTBF. - La publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent interrompre les autres programmes à condition de ne pas porter atteinte à leur intégrité et à leur valeur, en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
En outre, sur la RTBF, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre des émissions d'information sauf aux moments des interruptions naturelles ; les retransmissions de compétitions sportives ne comportant pas d'interruptions naturelles peuvent être interrompues à intervalles de 20 minutes au moins.
Pour les services linéaires en télévision et en radio, la durée maximale de diffusion de publicité par heure d'horloge est fixée à 20 %, soit 12 minutes. Pour les services non linéaires en télévision et en radio, la durée maximale de diffusion de publicité par programme est fixée à 20 % de la durée de ce programme. Selon son contrat de gestion, la RTBF doit respecter, sur ses services télévisuels linéaires, des règles plus strictes, à savoir :
- le temps de transmission consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, ne doit pas dépasser une durée journalière moyenne de 6 minutes par heure de transmission aux heures de grande écoute ;
- le temps de transmission quotidien consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, entre 19 et 22 heures, ne doit pas dépasser une durée totale de 30 minutes.
- les messages promotionnels en faveur de la presse écrite imprimée, du cinéma et des institutions culturelles, dans le cadre des échanges promotionnels visés par le présent contrat de gestion ;
- les messages institutionnels, émanant des pouvoirs publics ou d'organisations non-gouvernementales ;
- les messages diffusés gratuitement en faveur des œuvres de bienfaisance
Un programme qui comporte du placement de produit doit dans tous les cas répondre aux quatre conditions énoncées dans le décret :
- son contenu et sa programmation ne doivent pas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services ;
- ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
- ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
- ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit.
Le CSA est compétent, en tant qu'organe de régulation, pour les règles publicitaires en télévision et en radio contenues dans le décret coordonné sur les médias audiovisuels et le contrat de gestion de la RTBF.
Ces règles ne portent pas sur le contenu des publicités, à l'exception des article 11 à 13 du décret (respect de la dignité humaine, discriminations, protection des mineurs...).
Les plaintes qui portent sur le contenu des publicités, en dehors des articles précités, relèvent de la compétence du Jury d'éthique publicitaire (JEP), ainsi que celles qui concernent des médias autres que la radio et la télévision. Le JEP est un organe d'autorégulation, constitué de représentants des annonceurs et de membres de la société civile. Il dispose également d'une compétence d'avis, sur demande volontaire de l'annonceur, avant diffusion d'une publicité.
Lorsque le CSA est saisi d'une plainte en matière de publicité qui ne relève pas de sa compétence, il la transfère automatiquement au JEP.
Le CSA est l'organe qui contrôle le respect des dispositions légales et règlementaires par les éditeurs de services de médias audiovisuels déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CSA remplit sa mission de régulation du secteur audiovisuel sans entraver les principes de la liberté d'expression et de la responsabilité éditoriale des éditeurs de services qu'il autorise. C'est pourquoi il intervient a posteriori, soit d'initiative, soit sur base de plaintes.
Il rédige également à l'attention des éditeurs de services des recommandations telles que le Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants et la Recommandation relative à la communication publicitaire, textes non contraignants, excepté pour la RTBF.
Le CSA a pour mission de réguler les nouveaux formats de programme, dont les programmes de call tv. Régulièrement, il vérifie le respect des obligations, par les chaînes de télévision, des dispositions légales en matière audiovisuel en effectuant des « monitorings » des programmes des éditeurs qui diffusent ce type de programmes. S'il constate des infractions (par exemple une interruption d’un programme de call TV –qualifié de télé-achat– par un message publicitaire), le CSA peut sanctionner l'éditeur. Pour assurer la protection des téléspectateurs/consommateurs, le CSA exerce une compétence conjointe avec la Commission des jeux de hasard. Leurs prérogatives respectives sont délimitées et ne se chevauchent pas :
- la Commission des jeux de hasard applique la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et l'arrêté royal du 21 juin 2011 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ;
- le CSA est, quant à lui, compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s'y appliquent, conformément au décret sur les services de médias audiovisuels.
La publicité virtuelle est une publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé. La publicité virtuelle n'est autorisée qu'à l'occasion de la retransmission, en direct ou en différé, de compétitions sportives. Elle ne peut altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive ; elle ne peut être insérée que sur des surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité ; elle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire ; aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement ; elle ne peut priver, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation ; elle ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site ; elle ne doit pas utiliser de techniques subliminales ; aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés ; le téléspectateur doit être informé de l'utilisation de publicité virtuelle au moins au début et à la fin du programme.
La communication commerciale interactive désigne toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant, grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs – qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès – à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial. L'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.
L'écran partagé désigne toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran. Ce type de communication est interdit dans les journaux télévisés, les programmes d’actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants. Concernant les autres programmes, il est autorisé durant les génériques de fin, durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions ou durant les programmes de divertissement à condition qu'une période de 20 minutes au moins s'écoule entre chaque insertion. De plus, l'écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel il est inséré ; il doit être aisément identifiable par une séparation spatiale nette, grâce à des moyens optiques appropriés ; l'espace attribué à la communication commerciale doit rester raisonnable et permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme.
Oui. Les règles du décret s’appliquent aux services de médias audiovisuels. On entend par là les services relevant de la responsabilité éditoriale d’un éditeur de services dont l’objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires (radio et télévision consommée de façon traditionnelle en analogique ou numérique via TNT, câble, satellite, etc.) ou non linéaires (contenus audiovisuels disponibles via des moyens numériques et permettant de les consommer à la demande, de façon payante ou gratuite).
Les médias de proximité sont soumis à la même réglementation décrétale que les autres services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires. Toutefois, certaines exceptions s’appliquent aux médias de service public dont les médias de proximité font partie. Par rapport aux règles spécifiques en matière de communication commerciale :
- la publicité et l’autopromotion ne peuvent interrompre ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme d’un média de proximité ;
- les programmes de télé-achat ne peuvent être diffusés sur les médias de proximité.
Tel que défini dans le décret, on entend par parrainage, “toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d’une institution ou d’une entreprise, publique ou privée, ou d’une personne physique n’exerçant pas d’activité d’éditeur de services, de fournisseur de services de partage de vidéos ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels, de services de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits”.
Tel que défini dans le décret , on entend par communication commerciale, "toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion.” La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l’autopromotion et le placement de produit. Tous ces modes de communication commerciale sont autorisés en Fédération Wallonie-Bruxelles moyennant des règles spécifiques, inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
Le Jury d’éthique publicitaire (JEP) est un organe d'autorégulation, constitué de représentants des annonceurs et de membres de la société civile. Il dispose également d'une compétence d'avis, sur demande volontaire de l'annonceur, avant diffusion d'une publicité. Les plaintes des citoyen.ne.s qui portent sur le contenu des publicités - en dehors des articles du décret portant notamment sur le respect de la dignité humaine, les discriminations et la protection des mineurs pour lesquels le CSA est compétent - relèvent du Jury d'éthique publicitaire, ainsi que les plaintes qui concernent des médias autres que l’audiovisuel. Lorsque le CSA est saisi d'une plainte en matière de publicité qui ne relève pas de sa compétence, il la transfère automatiquement au JEP. Pour en savoir plus sur le JEP: https://www.jep.be/fr/
Oui, mais seulement dans certains cas précis. En effet, le CSA est compétent, en tant qu'organe de régulation, pour les règles publicitaires en linéaire (télévision et radio) et en non linéaire (radio et télévision en ligne, par exemple Auvio), reprises dans le décret coordonné sur les médias audiovisuels et le contrat de gestion de la RTBF. Ces règles s’adressent aux éditeurs et peuvent porter sur la forme (type de communications commerciales, emplacement, durée…) et sur le fond (articles du décret portant sur le respect de la dignité humaine, les discriminations, la protection des mineurs...). Le CSA rédige également à l'attention des éditeurs de services des recommandations relatives aux communications commerciales telles que le Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants, la Recommandation relative à la communication publicitaire, le Code de conduite sur les communications commerciales sexistes, hypersexualisées et fondées sur des stéréotypes de genre.
Les téléspectateurs ressentent le son des publicités comme plus agressif alors qu'il n'y a, en réalité, pas de variation de volume en valeur absolue (mesurée en décibels). Il faut chercher l'origine du problème en amont du côté des producteurs de spots publicitaires. Ceux-ci recourent à la technique dite de "compression dynamique du son" pour gonfler artificiellement le volume de leurs spots. Concrètement, cela signifie que le niveau des fréquences basses (creux) est augmenté de façon à atteindre celui des fréquences les plus hautes (pics), ce qui crée un son plus "dense". Cette technique de postproduction est utilisée par de nombreuses agences publicitaires, l'objectif est de faire se démarquer les spots du reste de l'offre télévisuelle, donc de garantir leur impact sur les audiences.
Le placement de produit est une forme de communication commerciale, comme la publicité, le parrainage ou l'autopromotion. Elle consiste à insérer un produit, un service ou une marque, ou une référence à un produit, service ou marque dans un programme ou une vidéo créée par l’utilisateur moyennant paiement ou une autre contrepartie. On peut distinguer deux formes de placement de produit : le placement de produit contre paiement et le « placement d'accessoires ». Le placement d'accessoires consiste pour un annonceur à fournir un bien ou un service en vue de l'inclure dans un programme, sans qu'aucun paiement n'intervienne. Il s'agira par exemple des accessoires de production et des lots.
Tel que défini dans le décret, on entend par publicité, “toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.”
La call TV est un format de programme animé par un présentateur qui incite les téléspectateurs à jouer, dans l'espoir de remporter un prix ou de l'argent, en répondant à une question (de culture générale ou de logique) via un numéro d'appel téléphonique surtaxé. Depuis une décision de 2008, le CSA a décidé que la call tv relevait du télé-achat. On entend par télé-achat : la diffusion d’offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots ou de vidéos créées par l’utilisateur, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d’obligations.
| Protection des mineurs
Non. C’est la Commission pour le contrôle des films qui les classe "enfants admis" et "enfants non admis". Un film enfant admis au cinéma est un film pour lequel cette Commission a estimé qu’il peut être vu par un jeune de - de 16 ans. A contrario, le film enfant non admis ne peut être vu par un jeune de - de 16 ans, qu’il soit ou non accompagné.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Non. L'arrêté sur la signalétique ne s’applique pas aux programmes radio et le CSA, doutant de la faisabilité technique d’un tel dispositif, a déconseillé au Gouvernement de prévoir des mesures pour la mise en œuvre d’une signalétique adaptée au média radiophonique.
Toutefois, le CSA recommande que les programmes radiophoniques susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 16 ans ne soient pas diffusés entre 6 heures et 22 heures.
En outre, les programmes de radio sont soumis aux dispositions générales du décret sur les services de médias audiovisuels, notamment l’article 9 relatif au respect de la dignité humaine et la protection des mineurs. Selon la jurisprudence du CSA, les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement des mienurs, en radio, doivent être précédés d'une "mise en garde" du public.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Les services "à la séance" et "à la demande" sont soumis aux obligations inscrites dans l'arrêté "protection des mineurs" du 21 février 2013 (comité de visionnage, signalétique, information sur les programmes, contrôle parental).
Le décodeur qui permet d'accéder à ces services inclut un système de contrôle parental par introduction d'un code PIN qui répond à différentes obligations techniques. Le code parental peut être paramètré par l'utilisateur selon le choix du niveau de protection (-10, -12, -16, -18) qu'il souhaite appliquer aux programmes disponibles. L'activation du code est alors le seul moyen dont disposent les parents pour s'assurer que leur(s) enfant(s) ne regarde(nt) pas des contenus inappropriés aux heures où ils sont "normalement" devant l'écran.
Selon la règlementation, le code PIN de contrôle parental d'un décodeur doit être activé par défaut au niveau "-12". Ce code peut ensuite être désactivé par l'utilisateur, s'il le souhaite, ou parametré pour bloquer les contenus de la catégorie de son choix ("-10", "-12", "-16", "-18")
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Non, mais face à l’essor du phénomène de diffusion des sms, "chat" ou courriels sur le télétexte et dans les programmes généraux, le CSA a adopté une recommandation en 2003 à l’intention des éditeurs de services, dans laquelle il préconise la mise en place d’ "un système de filtrage composé au minimum d’un opérateur humain dont la mission doit être permanente et préalable à la diffusion".
Ces sms, "chat" ou courriels sur le télétexte et dans les programmes généraux sont aussi considérés comme des programmes. Même si la signalétique ne s’y applique pas, ils doivent respecter les dispositions du décret sur les services de médias audiovisuels, notamment l’article 9 relatif au respect de la dignité humaine et à la protection des mineurs.
Le CSA recommande également aux éditeurs de services de mettre à la disposition du public un règlement explicite relatif à la diffusion de messages électroniques (« chat », sms,…). Celui-ci concerne notamment les aspects éthiques et financiers, les règles relatives à la protection de la vie privée, l’interdiction de toute forme de publicité,… Une copie de ce règlement doit également transmise au CSA.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Oui. Les bandes-annonces qui font la promotion de programmes sous le coup d’une signalétique particulière doivent faire apparaître le pictogramme d’identification correspondant et ne peuvent pas contenir de scènes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs à moins de n'être diffusées que dans le cadre des restrictions horaires qui s'appliquent aux programmes signalisés ou de n'être accessibles qu'après avoir introduit un code parental (PIN).
Sur un service de télévision linéaire, les bandes-annonces promotionnant des programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans ne peuvent être diffusées durant la période de 15 minutes qui précède ou qui suit un programme pour enfants.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Non. Néanmoins, la publicité ne doit pas heurter la sensibilité des mineurs. Elle doit respecter certains critères, car les mineurs sont aussi de jeunes consommateurs qui peuvent influencer les comportements d’achat de leurs parents. La publicité ne peut donc pas :
- inciter directement les mineurs à l’achat,
- les inciter directement à influencer les comportements d’achat de leurs parents ou de tiers,
- exploiter la confiance qu’ils ont dans les adultes (parents, enseignants, notamment),
- les présenter en situation dangereuse.
Les journaux télévisés ne font l'objet d'aucune classification, en vertu de l'arrêté « protection des mineurs » du 21 février 2013. Toutefois, si une scène diffusée dans un JT est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, le présentateur doit faire un avertissement oral.
En revanche, la signalétique s'applique aux magazines d'actualité, mais un magazine d'actualité déconseillé aux mineurs de moins de 12 ans peut être diffusé à n'importe quelle heure (exception).
La responsabilité éditoriale des éditeurs est consacrée par le décret sur les services de médias audiovisuels, c'est une des raisons pour laquelle le CSA n'intervient pas avant la diffusion de programmes. Il a toutefois appelé les éditeurs de services, dans une de ses recommandations relative au traitement des conflits armés, "à la vigilance [...] afin qu'ils veillent à ne pas heurter la sensibilité des mineurs par la diffusion d'images violentes aux heures où ils regardent ou écoutent normalement les émissions".
De plus, les rédactions des chaînes de télévision disposent de codes de déontologie, de règlements d'ordre intérieur,.. qui encadrent par exemple la violence et la tentation de dramatiser des images.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
La signalétique ne s'applique pas aux journaux télévisés ni à la publicité. Elle s'applique à tous les autres programmes télévisés.
Dans les JT, le présentateur a l'obligation de faire un avertissement oral dans le cas où une scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, est diffusée.
La protection des mineurs repose donc, dans le cas des journaux télévisés, à la fois sur la responsabilité et la déontologie des journalistes, et sur des dispositions règlementaires.
Concernant la publicité, des règles sont prévues dans le décret sur les services de médias audiovisuels (art. 11) : par exemple, elle ne peut porter atteinte au respect de la dignité humaine ou encourager des comportements dangereux ou violents.
Des limitations spécifiques s'appliquent également aux publicités à destination des mineurs (art. 13). Par exemple, elles ne peuvent inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, ni exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes.
Le CSA a adopté une recommandation relative à la communication publicitaire et son Collège d'avis a rédigé un code d'éthique sur la publicité à destination des enfants.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Oui. L’ensemble des chaînes de télévision (appellées aussi éditeurs de services télévisuel) en Fédération Wallonie-Bruxelles doivent respecter à la fois l’arrêté du 21 février 2013 sur la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental et moral, ainsi que le décret sur les services de médias audiovisuels, notamment l’article 9 relatif au respect de la dignité humaine et à la protection des mineurs.
Dans un souci de cohérence avec les chaînes françaises, qui bénéficient d'une forte audience en Fédération Wallonie-Bruxelles, les chaînes belges francophones appliquent la même signalétique.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Tous les programmes diffusés à la télévision ne s’adressent pas aux enfants et leur protection vis-à-vis de programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement ne repose pas que sur des dispositions règlementaires. Elle dépend également d’une responsabilité partagée entre les chaînes de télévision, l’entourage familial et éducatif de l’enfant et le CSA.
Les adultes ont donc un rôle actif et fondamental à jouer, par exemple en étant vigilants à la classification des programmes, en établissant des heures de vision, en étant attentifs aux avertissements du présentateur dans les journaux télévisés ou en utilisant les systèmes de verrouillage (« code parental ») proposés par les chaînes de télévision.
Dans le cas où un programme me choque ou si la signalétique me paraît inadaptée, je peux également porter plainte auprès du CSA en remplissant le formulaire de plainte en ligne ou en envoyant un mail, un courrier ou un fax.
>> Pour consulter les décisions déjà adoptées en matière de protection des mineurs, consulter le site thématique sur la signalétique (onglet "décisions") : https://csa.be/signaletique
Le CSA remplit sa mission de régulation du secteur audiovisuel sans entraver les principes de la liberté d’expression et de la responsabilité éditoriale des éditeurs de services (c'est-à-dire les chaînes de télévision). C’est pourquoi il intervient a posteriori, soit d’initiative, soit sur base de plaintes.
Il exerce donc un contrôle après la diffusion des programmes, constate l’infraction et peut appliquer une sanction en cas de violation de l’arrêté sur la protection des mineurs du 21 février 2013 ou du décret sur les services de médias audiovisuels.
Par ailleurs, le CSA adresse également des recommandations aux éditeurs de services, comme la recommandation relative à la protection des mineurs.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Tous les éditeurs de services (c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision, y compris les nouveaux services autorisés, de type "à la demande" ou "à la séance") doivent respecter les dispositions de l’arrêté "protection des mineurs" du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013, à savoir :
- Constituer un comité de visionnage qui effectue une classification des programmes et dont la composition est laissée à la responsabilité des éditeurs,
- Informer le CSA, dans les 10 jours, de la constitution ou du changement dans la composition de ce comité de visionnage,
- Indiquer la signalétique sur les programmes qui y sont soumis quand ils communiquent la grille de programmes à la presse, ainsi que sur leurs propres modes de communication sur les programmes qu'ils proposent,
- Indiquer la signalétique dans les guides de programmes électroniques et les catalogues de VOD.
La protection des mineurs repose sur des dispositions règlementaires, ainsi que sur une responsabilité sociale partagée entre les différents intervenants (éditeurs de services, entourage familial et éducatif de l’enfant). Les outils règlementaires mis en œuvre (classification, programmation dans des tranches horaires spécifiques, information sur les programmes, filtrage et contrôle d’accès) doivent être relayés par les adultes par le choix des heures de vision, la réactivité suite à l’avertissement, et l’utilisation active du code parental.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
La signalétique est un garde-fou et un appel à la responsabilisation des différents intervenants (télévision, entourage familial et éducatif de l'enfant, CSA) pour assurer la protection des mineurs contre des programmes audiovisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement.
Pour garantir son efficacité, elle doit être relayée par les adultes, par exemple en étant attentif au choix de heures auxquels les mineurs regardent la télévision, aux avertissements des animateurs ou des présentateurs, et à l'utilisation active du code parental.

- " -10 " : déconseillé aux mineurs de moins de 10 ans; programmes comportant certaines scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 10 ans ;
- " -12 " : déconseillé aux mineurs de moins de 12 ans; programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique ;
- " -16 " : déconseillé aux mineurs de moins de 16 ans; programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs de moins de 16 ans, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère érotique ou de grande violence ;
- " -18 " : déconseillé aux mineurs d'âge; programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère pornographique ou de très grande violence.
Ce classement des programmes en catégories s'accompagne de limitations horaires lorsqu'ils sont diffusés en mode linéaire (télévision traditionnelle) :
- "- 12" : ne peuvent être diffusés de 6h00 à 20h00 en semaine, mais jusqu'à 22 h. les veilles de jours de congé scolaire.
- " - 16 " ne peuvent être diffusés entre 6h00 à 22h00.
- Les films et programmes déconseillés aux moins de 18 ans ne peuvent diffusés qu'entre minuit et 5 h en mode crypté et accessibles uniquement grâce à un code d'accès parental.
Ces limitations horaires ne sont pas d'application sur les services diffusés de manière non linéaire (programmes audiovisuels à la demande) ou sur les services linéaires à condition qu'un dispositif technique permette de n'accéder aux programmes signalisés qu'après avoir introduit un code personnel.
La signalétique (classification des programmes, programmation dans des tranches horaires spécifiques, information sur les programmes, filtrage et contrôle d'accès) est définie dans l'arrêté « protection des mineurs » du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013. Elle constitue une mise en oeuvre du principe de protection des mineurs repris à l'article 9 du décret sur les services de médias audiovisuels, lequel définit le périmètre des limitations autorisées à la liberté d'expression.
>> Télécharger les pictogrammes
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
| Quotas audiovisuels
La Fédération Wallonie-Bruxelles a élaboré un système de quotas propre aux radios à l’exception des radios non linéaires (podcast) et des radios diffusées sur une plateforme ouverte, par exemple via internet (webradio). Les radios doivent assurer un minimum de 70% de production propre et émettre en langue française. De plus, le cas échéant, elles sont tenues de diffuser annuellement au moins 30% de musiques sur des textes en langue française (par rapport à l’ensemble des musiques chantées) et au moins 6% d’œuvres musicales de compositeurs, d’artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française (sur l’ensemble des œuvres musicales). Parmi ces 6 %, au moins ¾ des œuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h. Cette proportion diffusée en journée doit augmenter progressivement pour atteindre en 2026, 10% pour les radios en réseau et 8% pour les radios indépendantes. Certaines dérogations, fondées sur des demandes dûment motivées, peuvent être accordées dans le but de favoriser la diversité des services. Les éditeurs peuvent également s’engager à des proportions supérieures aux minima évoqués plus haut. Enfin, les radios en réseau doivent également participer financièrement à la vitalité de la production en Communauté française, en versant annuellement un montant déterminé en fonction de leur chiffre d’affaires au Fonds d’aide à la création radiophonique. La RTBF est également soumise à des quotas particuliers fixés par le contrat de gestion qui décrit ses missions de service public.
Les pourcentages européens ont été transposés dans l'article 44 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels linéaires. Néanmoins, la formule "chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés" n'a pas été retenue, pour éviter que la règle ne soit déforcée. Cette formulation générale supporte des exceptions (§3 du même article) : sont exemptés de ces quotas principalement les télévisions locales et les services linéaires dont le temps de diffusion se compose d'au moins 80% de production propre ("programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle", article 1er 35° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels).
Le caractère récent des oeuvres européennes indépendantes a été fixé à des oeuvres dont la production ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion. Outre ces quotas de diffusion, la Fédération Wallonie-Bruxelles a également mis en place des quotas de production (article 41 du décret). Les chaînes doivent contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelle, soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA). Les montants que les télévisions doivent investir dans la production sont arrêtés en fonction du chiffre d'affaires de l'éditeur.
Le CCA publie annuellement en mars un état de la production, de la diffusion et de la promotion cinématographiques et audiovisuelles en Fédération Wallonie-Bruxelles (voir en particulier le chapitre sur les coproductions avec les éditeurs et les distributeurs).
Par définition, un quota est un pourcentage, contingent déterminé, imposé ou autorisé. Dans le domaine de l'audiovisuel européen, ce terme recouvre un objectif de protection de la diversité culturelle et de promotion des œuvres audiovisuelles (largement définies dans l'article 1er 23° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels). Les quotas ont été mis en place pour que les oeuvres audiovisuelles européennes ne pâtissent pas de la prolifique production étrangère bon marché, et bénéficient d'une visibilité, voire d'un financement, accrus.
| Numérique
Depuis novembre 2007, la RTBF diffuse gratuitement en TNT ses trois chaînes de télévision (La Une, La Deux et La Trois), ses 5 chaînes de radio (La Première, Vivacité, Musique3, Tipik et Classic21) ainsi que la chaîne de télévision Euronews et les 2 radios de la BRF. Le journal télévisé de 19h30 avec sa traduction gestuelle simultanée est ainsi disponible tous les jours en direct sur La Trois en TNT. Actuellement 90 à 95% du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles est couvert par la TNT. Cette diffusion par la RTBF découle de son obligation de service universel telle qu'édictée dans son contrat de gestion. La diffusion de la télévision analogique hertzienne a été arrêtée par la RTBF le 1er mars 2010. Des informations techniques et pratiques sur la TNT (matériel nécessaire, qualité de réception selon la zone géographique,…) sont disponibles sur le site de la RTBF.
| Services de médias audiovisuels (SMA)
Ces obligations sont inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Certaines règles sont communes à tous les médias dans le but d’assurer au public une protection de base à laquelle il peut légitimement s’attendre face à tout média audiovisuel, quel que soit son support ou son mode de diffusion. D’autres règles sont plus souples parce que vous diffusez sur internet et parce que vous offrez un service à la demande de l’utilisateur.
-
Je dois déclarer mon service de vidéo à la demande auprès du CSA.
-
Je dois faire apparaître sur mon site web quelques mentions légales de transparence, conformément à l’article 6, §1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
L’objectif du décret est de rendre publiques les informations de base me concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans mes programmes.
- Si vous êtes une ASBL, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une société, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une commune ou une autre instance publique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une personne physique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
-
Je dois remplir une fois par an un formulaire fourni par le CSA - appelé le rapport annuel - en communiquant quelques éléments d’informations relatifs au respect de la législation sur le droit d’auteur et droits voisins, à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (seulement si le chiffre d’affaires le permet) et à la mise en valeur des œuvres européennes comprises dans votre catalogue. Le rapport annuel est également l’occasion de signaler au CSA d’éventuelles modifications par rapport aux informations communiquées préalablement dans votre déclaration, ainsi que de signaler les mesures prises en matière de protection des mineurs.
- Je suis enfin tenu de respecter les règles relatives à la dignité humaine et à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité et communication commerciale.
Ces obligations sont inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Certaines règles sont communes à tous les médias dans le but d’assurer au public une protection de base à laquelle il peut légitimement s’attendre face à tout média audiovisuel, quel que soit son support ou son mode de diffusion. D’autres règles sont plus souples parce que vous diffusez sur internet ou parce que vous offrez un service à la demande de l’utilisateur.
- Je dois déclarer ma web TV auprès du CSA.
-
Je dois faire apparaître sur mon site web quelques mentions légales de transparence, conformément à l’article 6, §1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. L’objectif du décret est de rendre publiques les informations de base me concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans mes programmes.
- Si vous êtes une ASBL, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une société, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une commune ou une autre instance publique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une personne physique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Je dois remplir une fois par an un formulaire fourni par le CSA, appelé le rapport annuel, en communiquant quelques éléments d’informations relatifs au respect de la législation sur le droit d’auteur et droits voisins, à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (seulement si le chiffre d’affaires le permet) et à la mise en valeur des œuvres européennes comprises dans votre catalogue. Le rapport annuel est également l’occasion de signaler au CSA d’éventuelles modifications par rapport aux informations communiquées préalablement dans votre déclaration, ainsi que de signaler les mesures prises en matière de protection des mineurs.
- Je suis enfin tenu de respecter les règles relatives à la dignité humaine et à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité et communication commerciale.
Je dois effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services télévisuels que j’entends éditer. Le CSA est compétent, dans le mois de la réception de la déclaration, pour en accuser réception et observer la conformité des éléments que vous communiquez avec les éléments requis par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des services télévisuels. Ce document est disponible à l’unité « Télévisions » du CSA.
Un service de médias audiovisuel ou SMA est défini légalement comme « un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un éditeur de services, dont l’objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir, d’éduquer ou d’assurer une communication commerciale (…) » (article 1.2-1, 52° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médis audiovisuels et aux services de partage de vidéos). Pour être qualifié de SMA, il faut donc remplir les sept critères suivants :
- être un service : cette notion s’apprécie au sens du droit européen, où un service est une prestation fournie moyennant contrepartie. Le fournisseur du SMA (son éditeur) doit donc être rémunéré d’une manière ou d’une autre pour ses prestations (il peut l’être par le public du service, par les annonceurs, ou encore par le versement de fonds publics).
- être édité sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur : ceci implique qu’une personne (l’éditeur) assure un contrôle effectif sur la sélection et l’organisation des contenus qui se trouvent sur le service. Il ne peut pas s’agir d’une simple plateforme ou tout un chacun peut placer des contenus sans contrôle préalable (une telle plateforme pourrait, en revanche, être qualifiée de service de partage de vidéos).
- avoir l’audiovisuel pour objet principal : ce critère implique, lorsqu’un service comporte des contenus audiovisuels et autres (par exemple des contenus écrits), de déterminer si ces contenus audiovisuels peuvent constituer une partie dissociable des autres contenus ou, à défaut, s’ils sont prépondérants par rapport à ces autres contenus.
- être destiné au public : ce critère nécessite que le service ne soit pas destiné à un nombre limité de personnes identifiables mais à un nombre potentiellement illimité de personnes non identifiables.
- être composé de programmes télévisuels ou sonores : à cet égard, un programme télévisuel est défini comme un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, et un programme sonore est défini comme un semble de sons, le tout quel que soit la durée de cet ensemble.
- être communiqué par des réseaux de communication électroniques : ceci vise notamment les voies de transmission hertziennes, le câble, le satellite, ou encore l’Internet, mais pas les salles de cinéma ou les supports matériels tels que le DVD ou le CD.
- poursuivre le but d’informer, de divertir, d’éduquer ou d’assurer une communication commerciale : en pratique, ce critère sera toujours rempli.
Pour savoir si vous devez déclarer votre service de vidéos à la demande, il faut se poser les deux questions suivantes :
-
Mon service de vidéo à la demande relève-t-il de ma responsabilité éditoriale (c’est-à-dire que j’ai un contrôle sur la sélection des vidéos et sur leur organisation) et son objet principal est-il de communiquer au public des programmes télévisuels (c’est-à-dire des images animées combinées ou non à du son) dans le but d’informer ou de divertir ou d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale ?
- Mon service de vidéos à la demande est-il établi en Région wallonne ou constitué de programmes en langue française et établi en Région de Bruxelles-Capitale ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, votre déclaration doit être dûment complétée et introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, à l’adresse suivante :
Boulevard de l’Impératrice, 13 à 1000 Bruxelles
Toute personne physique ou morale basée en Fédération Wallonie-Bruxelles éditant ou voulant créer un service sonore distribué via internet (webradio, podcast) doit en faire la déclaration auprès du CSA. Pour ce faire, il faut suivre la procédure décrite sur le page " https://www.csa.be/radios-autorisation-et-declaration/" et envoyer le formulaire complété au CSA.
La définition légale de l’éditeur de services est : « la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé » (article 1.3-1, 13° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos). Cette définition implique trois éléments :
- Un éditeur est une personne (physique ou morale) : il peut donc s’agir d’un individu, d’une société ou encore d’une ASBL.
- Cette personne exerce une « responsabilité éditoriale »: cela signifie, conformément à la définition légale de la notion de responsabilité éditoriale (article 1.3-1, 47° du décret précité), qu’elle exerce un contrôle effectif sur la sélection et l’organisation de programmes. C’est elle qui, en pratique, sélectionne les programmes qui figureront dans le service, et qui détermine comment ces programmes seront agencés (dans une grille horaire s’il s’agit d’un service linéaire, ou dans un catalogue s’il s’agit d’un service non linéaire ou « à la demande »).
- Cette responsabilité s’exerce sur un « service de médias audiovisuels »: le service sur lequel l’éditeur exerce sa responsabilité éditoriale doit correspondre à la définition légale d’un service de médias audiovisuels (SMA), à savoir « un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale (…) » (article 1.3-1, 52° du décret précité). Cette définition comporte sept critères qui sont détaillés dans la réponse à la question "Qu’est-ce qu’un service de médias audiovisuels (SMA) ?".
Le champ d'application du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009 est déterminé de deux manières:
Tout d'abord, il s’applique à toute activité relative à un service de médias audiovisuel (champ d'application matériel du décret). La notion de "service de médias audiovisuel" (ou SMA) intègre tous les médias audiovisuels, quel que soit leur moyen de diffusion : télévision et radio de flux (linéaires) ou à la demande (non linéaires), par câble, sur satellite, en hertzien, sur GSM, sur Internet.
Par ailleurs, tous les services diffusés ne sont évidemment pas concernés par la législation de la Communauté française. Sont visés les services dont l’éditeur responsable est établi en Région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles capitale. Dans ce dernier cas, les activités de l'éditeur doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française (champ d’application territorial du décret).
Concrètement, cela signifie que, pour que le SMA soit soumis au décret, le domicile de la personne physique (qui ne peut être éditeur que de services sur plateforme ouverte comme Internet) ou le siège social de la personne morale (qui peut être éditeur de services sur toutes plateformes) qui en est l’éditeur doit être situé en Communauté française.
Dans le cas où le domicile de la personne physique ou le siège social de la personne morale se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'usage de la langue française est déterminant pour établir le rattachement à la Communauté française.
Pour savoir si vous devez déclarer votre webTV, il faut se poser les deux questions suivantes :
- Ma web TV relève-t-elle de ma responsabilité éditoriale (c’est-à-dire que j’ai un contrôle sur la sélection des programmes et sur leur organisation) et son objet principal est-il de communiquer au public des programmes télévisuels (c’est-à-dire des images animées combinées ou non à du son) dans le but d’informer ou de divertir ou d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale ?
- Ma web TV est-elle établie en Région wallonne ou constituée de programmes en langue française et établie en Région de Bruxelles-Capitale ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, votre déclaration doit être dûment complétée et introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, à l’adresse suivante :
Boulevard de l’Impératrice, 13 à 1000 Bruxelles
| Télédistribution : opérateur, distributeur
Un accord de coopération a été conclu le 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral et les Communautés concernant la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et de la télévision. L'accord institue une conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) qui réunit les différentes autorités de régulation compétentes dans le domaine des télécommunications et de l'audiovisuel (IBPT, VRM, Medienrat et CSA). Des projets de décision initiés par un membre de la CRC sont ainsi régulièrement soumis à l'accord des autres membres conformément aux dispositions de l'accord de coopération précité.
L’opérateur Télésat commercialise des offres TV payantes en Belgique. Pour plus de détails, rendez-vous directement sur le site Internet de Télésat. Il existe également plus de 500 chaînes disponibles gratuitement en clair comme arte HD ou TV5Monde France-Belgique-Suisse-Monaco HD (« free-to-air »). Cependant certaines chaines belges (La Une, Tipik, RTL-TVI, …) ne sont pas diffusées dans l’offre gratuite.
Non. Pour des raisons constitutionnelles, le CSA n'est pas compétent pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui est soumise à la législation fédérale. L'IBPT (Institut Belge des Postes et des Télécommunications) est le régulateur compétent.
Certains distributeurs de services pratiquent des tarifs sociaux. Vous pouvez donc prendre contact avec votre distributeur pour connaître les conditions applicables.
La péréquation tarifaire, basée sur le principe d'égalité de traitement des citoyens, a pour but d’assurer que pour la même offre de services, le distributeur de services garantit un même prix à l'égard de tout utilisateur des services. Cela vise à éviter les traitements discriminatoires en matière de commercialisation et de tarification des services offerts par le distributeur, par exemple en fonction de la zone desservie. Conformément au principe de neutralité technologique, cela s'applique à l'ensemble des distributeurs déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles, quelle que soit la plateforme utilisée. Avec le service universel, la péréquation tarifaire constitue un élément essentiel de la mission de défense des utilisateurs telle que souhaitée par le législateur et appliquée par le régulateur.
En principe, les distributeurs sont libres de composer leurs offres au public comme ils le souhaitent, afin de répondre au mieux aux envies et habitudes des utilisateurs et utilisatrices. Néanmoins, des dispositions législatives ont été prises par les pouvoirs publics afin d'assurer que le grand public puisse en général avoir accès à un certain nombre de programmes, à une certaine offre de base. Il fallait aussi régler la distribution de programmes étrangers. De ce fait, différentes obligations s'appliquent à la distribution des services de télévision et de radio en fonction, essentiellement, de la nature de ces services. On distinguera les services soumis au "must carry", les services privés, les services étrangers, etc. En résumé, les règles législatives applicables en Fédération Wallonie-Bruxelles se présentent comme suit. Certains distributeurs de services par câble, soit ceux dont les réseaux sont utilisés par un nombre significatif de personnes comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, doivent distribuer les services repris dans l'offre de base. Outre cette offre de base et conformément au décret, les distributeurs de services peuvent distribuer les services de radiodiffusion suivants ("may carry") :
- les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture ;
- les services des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire ;
- les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;
- les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ;
- les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière ;
- les services télévisuels des éditeurs de services , ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci.
Les dispositions liées au "must carry" s 'appliquent aux distributeurs par câble (coaxial ou bifilaire) et/ou par voie satellitaire ou par tout système de transmission (autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique) "pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels". Le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA réévalue régulièrement quels distributeurs de services soumis aux règles de "must carry" et dans quelles zones, en fonction de l'évolution du leur nombre d'abonnés.
| Services télévisuels linéaires | Services sonores linéaires |
| La Une | La Première |
| Tipik (TV) | Vivacité |
| La Trois | Classic 21 |
| TV5 Monde FBSM | Tipik (RD) |
| Eén | Musiq3 |
| Canvas (Op12) | VRT1 |
| BRF TV | VRT2 |
| MDP (dans leurs zones de couverture respectives) | BRF1 |
- les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Fédération Wallonie-Bruxelles : La Une, Tipik et La Trois;
- les services des Medias de Proximité dans leur zone de couverture;
- les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF : seul TV5Monde a jusqu'ici été désigné à ce titre ;
- deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande dès lors que les distributeurs que cette Communauté autorise sont tenus de transmettre deux services de télévision du service public de radiodiffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Eén et Canvas/Ketnet;
- un ou des services du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour dès lors que les distributeurs que cette Communauté sont tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF : BRF;
- les services télévisuels linéaires des éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire : aucun actuellement ;
- les services télévisuels désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion : aucun actuellement.
- les services de la RTBF désignés par le Gouvernement : aucun actuellement;
- les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture : aucun actuellement;
- les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF : aucun actuellement.
- les services de la RTBF émis en modulation de fréquence : La Première, Vivacité, Classic 21, Pure FM et Musiq3;
- deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF : Radio 1 et Radio 2 ou d'autres services de la VRT;
- un service du service public de la Communauté germanophone dès lors que les distributeurs de services de cette Communauté sont tenus de transmettre un service sonore du service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles : BRF1 ou BRF2.
- Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les distributeurs de services par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique doivent diffuser les services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF (La Une, Tipik et La Trois) et les services linéaires, désignés par le Gouvernement, les éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF (TV5). Ils garantissent également la distribution sur leur réseau des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF (aucun actuellement).
En cas de litige avec un distributeur (facturation, questions contractuelles, raccordement, dérangement,…), il est possible de demander l’intervention gratuite du service de médiation pour les télécommunications, compétent pour l’ensemble du secteur des télécoms. Ce service peut agir à partir du moment où aucune solution satisfaisante n'a pu être obtenue auprès du service clientèle du télédistributeur. Pour introduire une plainte ou une réclamation, consultez le site du service de médiation (rubrique "comment introduire une plainte?"). Il est également à noter que la procédure « Easy Switch » facilite le changement d’opérateur si vous disposez au minimum d’un service d’accès à Internet ou d’un service de télévision. Cette procédure vous libère de la plupart des démarches administratives lors d'un changement d'opérateur. Votre nouvel opérateur règle notamment la résiliation de l’ancien contrat, dès que ses services ont été installés chez vous. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) : https://www.ibpt.be/consommateurs/faq/easy-switch
Le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC) du CSA a pour mission de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services. Ce contrôle est effectué annuellement par le CSA et porte notamment sur les sujets suivants :
- péréquation tarifaire ;
- transparence et données comptables ;
- séparation comptable ;
- promotion de la diversité culturelle dont contribution audiovisuelle et contribution télévision locale ;
- composition de l'offre de services dont must carry ;
- positionnement de certains services bénéficiant du must carry ;
- ressources et services associés (EPG, API…).
Par opérateur le décret entend toute entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques ou des ressources associées nécessaires à la transmission auprès du public de services de médias audiovisuels. Actuellement, seules les plateformes du câble coaxial et de l'xDSL sont représentées en Communauté française : le registre publié sur le site du CSA énumère tous les opérateurs de réseau déclarés.
Ce sont les distributeurs eux-mêmes qui décident librement quelles chaînes ils distribuent, en fonction de leur politique commerciale et moyennant accord avec les chaînes concernées. Certains distributeurs sont toutefois tenus de distribuer dans leur offre de base un certain nombre de chaînes. Il s’agit du droit de distribution obligatoire. Pour plus d’informations sur cette question voir la section relative aux obligations des distributeurs.
Vous êtes abonné(e) à :
- Telenet : vous avez accès à ces services ;
- VOO : vérifiez si vous avez accès à ces services à votre adresse sur le site du distributeur;
- Orange propose actuellement la télédistribution et l’accès à Internet et à la téléphonie sur le câble, mais pas encore aux services interactifs tels la VOD ou la télévision de rattrapage.
Oui. En principe, il y a toujours deux offres de télédistribution numérique sur le câble coaxial dans votre région (VOO ou Telenet, d’une part, et Orange, d’autre part). En revanche, il n’est pas possible de choisir entre VOO et Telenet, ceux-ci couvrant chacun des zones distinctes.
Ce sont les distributeurs eux-mêmes qui décident librement quelles chaînes ils distribuent, en fonction de leur politique commerciale et moyennant accord avec les chaînes concernées. Les câblodistributeurs VOO, Telenet et Orange sont toutefois tenus de distribuer dans leur offre de base un certain nombre de chaînes. Il s’agit du droit de distribution obligatoire. En télévision, ce droit de distribution obligatoire concerne les trois chaînes de la RTBF (La Une, Tipik et La Trois/Ouftivi), les télévisions locales dans leur zone de couverture, TV5 Monde, Eén, Ketnet/Canvas et la BRF. A cela s’ajoutent cinq radios de la RTBF (La Première, Vivacité, Classic 21, Tipik et Musiq3), deux radios de la VRT et une radio de la BRF.
Dans la majorité des cas, l’accès à la télévision nécessite l’utilisation d’un décodeur loué ou vendu par votre distributeur et propre à celui-ci. Cependant, certaines offres permettent désormais de s’affranchir d’un décodeur en passant notamment par une application sur votre télévision connectée ou en utilisant à la place une box Apple TV ou Android TV. Pour plus d’informations sur cette question, voir la section relative au prix de la télévision sans décodeur.
Oui. Dès lors que vous avez accès à une offre d’IPTV vous pouvez avoir accès à tous ces services.
Oui, vous avez actuellement le choix entre deux offres (Proximus et Scarlet).
Non. Cependant, l’accès à la télévision de rattrapage est possible en combinant sa liaison satellite avec une connexion Internet via une autre plateforme (en particulier sur le câble de télédistribution ou téléphonique).
Oui. La réception des signaux via satellite peut être affectée lors de fortes chutes de pluie ou de neige, la réception n’est cependant affectée qu’en cas de conditions climatiques extrêmes.
Non. Bien qu’il existe une offre de chaînes gratuites ; les chaînes belges n’en font pas partie. Certains programmes de la RTBF sont toutefois rediffusés sur d’autres chaînes européennes free-to-air comme TV5 Monde.
La réception du signal de la TNT peut être perturbée par différentes causes : distance par rapport à l’émetteur, conditions climatiques, topographie, présence d’immeubles élevés, travaux de maintenance aux émetteurs,… Dans certaines circonstances, il se peut que des installations techniques, comme un parc éolien ou des enseignes lumineuses, aient pour effet d’affaiblir le signal hertzien. Toutefois, d’autres causes étant possibles, il convient de tout d’abord vérifier si d’autres utilisateurs dans votre entourage subissent également le brouillage et si votre installation est toujours en parfait état de fonctionnement. Il suffit parfois de relancer la fonctionnalité de balayage pour régler le problème. Si c’est le cas, il peut être utile de suivre les indication de l’assistance technique de la RTBF et/ou de prendre contact avec le service Médiation de la RTBF (mediation@rtbf.be) afin de demander si une solution technique est envisageable. Il n’est pas à exclure, malheureusement, que les difficultés techniques empêchent de trouver une solution satisfaisante à votre problème (notamment si le signal est trop faible à l’endroit de réception, pour l’une ou l’autre des raisons évoquées ci-dessus).
De manière générale, la TNT s’est bien développée dans les pays où la télévision par voie hertzienne est historiquement bien implantée et largement regardée, comme en France par exemple.
Les distributeurs doivent respecter les obligations suivantes en termes de numérotation des chaînes :
- Deux au moins des services de la RTBF désignés par le Gouvernement doivent être alignés par défaut sur les deux premières positions de l’offre de base des distributeurs de services ;
- Un troisième service de la RTBF désigné par le Gouvernement doit être positionné par défaut parmi les neuf premières positions de l’offre de base des distributeurs de services ;
- Le service de média de proximité dans sa zone de couverture doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l’offre de base des distributeurs de services ;
- Le service TV5Monde doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l’offre de base des distributeurs de services.
L’IPTV, ou Internet Protocol Television, est une forme de télévision où les programmes sont diffusés par IP (Internet Protocol) On l’appelle aussi TV sur IP (IPTV) ou encore télévision sur xDSL. Contrairement à télévision linéaire, qui est diffusée en direct, l’IPTV est diffusée via des boxes Internet. Le câble téléphonique de Proximus (anciennement Belgacom), aussi appelé câble « bifilaire » puisque constitué d’une paire de fils de cuivre, couvre pratiquement l’ensemble du territoire et est d’abord connu comme réseau de téléphonie et de transmissions de données (fax, Internet,…). Depuis 2005, ce réseau est également utilisé pour la télévision numérique qui est aujourd’hui disponible dans un grand nombre de foyers moyennant l’utilisation d’un matériel de décodage. En savoir plus sur l'IPTV : rendez-vous sur notre site dédié.
La CRC ou conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) réunit les différentes autorités de régulation compétentes dans le domaine des télécommunications et de l'audiovisuel (IBPT, VRM, Medienrat et CSA). Des projets de décision initiés par un membre de la CRC sont ainsi régulièrement soumis à l'accord des autres membres de la CRC.
Un distributeur est une société qui met à disposition du grand public (les consommateurs) des chaînes de télévision, de radio et des programmes TV ou radio à la demande. Le distributeur choisit les contenus qui seront disponibles dans son offre. Ces derniers sont fournis la plupart du temps par d’autres entreprises (des éditeurs), dont les chaînes de TV belges et étrangères. La mise à disposition de ces contenus aux consommateurs se fait en recourant à des réseaux de communication : câbles, satellites, ondes hertziennes, etc. Le distributeur est parfois également opérateur de tels réseaux.
Un distributeur est une société qui met à disposition du grand public (les consommateurs) des chaînes de télévision, de radio et des programmes TV ou radio à la demande. Le distributeur choisit les contenus qui seront disponibles dans son offre. Ces derniers sont fournis la plupart du temps par d’autres entreprises (des éditeurs), dont les chaînes de TV belges et étrangères. La mise à disposition de ces contenus aux consommateurs se fait en recourant à des réseaux de communication : câbles, satellites, ondes hertziennes, etc. Le distributeur est parfois également opérateur de tels réseaux.
Le Règlement du 17 juillet 2018 stipule que les distributeurs des chaînes ont l’obligation de mettre à disposition du public, sans coût supplémentaire, les programmes rendus accessibles par les éditeurs. Ils doivent également veiller à faciliter l’utilisation des menus de navigation et plus particulièrement l’activation des fonctionnalités d’accessibilité . Enfin, les distributeurs doivent garantir l’information du public via l’incrustation des pictogrammes définis en annexe du Règlement du 17 juillet 2018 au sein des guides électroniques de programmes , des catalogues de vidéos à la demande et de leur communication externe. Dans le même objectif, les distributeurs doivent s’assurer de l’identification de la piste d’audiodescription. Pour plus d’informations, le Règlement du 17 juillet 2018 est disponible sur notre site : https://www.csa.be/document/reglement-accessibilite-juillet-2018/.
| Audiovisuel public
La RTBF, entreprise publique culturelle autonome, est financée principalement par une dotation de la Communauté française et par des ressources commerciales (publicité, parrainage, commission sur les appels téléphoniques payants et vente de produits dérivés). La part de la publicité commerciale ne peut pas dépasser 25 % des ressources annuelles de la RTBF. Ce financement mixte est caractéristique des éditeurs publics de télévision et de radio en Europe, à l’exception de la radio-télévision publique britannique (BBC), financée exclusivement par la redevance et la vente de produits dérivés et de la radio-télévision publique portugaise (RTP) financée exclusivement par des ressources commerciales. Le financement partiel de la radio-télévision publique par la publicité commerciale est le plus souvent justifié par l’impossibilité pour les pouvoirs publics de financer l’ensemble des activités du service public ou décrite comme un moyen d‘assurer une autonomie relative du service public par rapport aux pouvoirs publics. Inversement, les ressources publiques sont la contrepartie des missions de service public qui lui sont imposées. L’équilibre entre les impératifs d’intérêt général et les contraintes de la concurrence est assuré par l’entreprise dans le cadre de l’autonomie de gestion dont elle dispose en vertu du décret et des obligations découlant du contrat de gestion, obligations dont le respect est contrôlé chaque année par le CSA.
Oui. Selon le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, la publicité et l’autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. La diffusion d’œuvres de fiction cinématographique, d’œuvres de fiction télévisuelle, à l’exclusion des séries et des feuilletons, de programmes d’actualités, de documentaires, de programmes religieux et philosophiques non confessionnels, peut être interrompue par la publicité et l’autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins. Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les médias de proximité, la publicité et l’autopromotion ne peuvent interrompre ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme. La publicité et l’autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et philosophiques non confessionnelles. Les spots isolés de publicité et d’autopromotion doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. La RTBF, tout comme les médias de proximité, ne peut diffuser de programmes de télé-achat.
Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Les téléspectateurs doivent donc être informés de l’accessibilité des programmes par :
- L’incrustation du pictogramme approprié en début de programme et dans les bandes annonces ;
- Une mention sonore, lorsqu’il s’agit de programmes à destination des personnes en situation de déficience visuelle.
- Au sein de la communication externe des éditeurs et des distributeurs (sur leur site par exemple, ou au sein de la presse écrite);
- Au sein des guides électroniques de programmes ( EPG) ;
- Au sein des catalogues de services de vidéos à la demande.
- Un pictogramme comportant les lettres "ST" indique la présence de sous-titres à destination des personnes en situation de déficience auditive .
- Un pictogramme comportant les lettres "AD" indique la présence d’une audiodescription à destination des personnes en situation de déficience visuelle.

 Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants
Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants
Le Contrat de gestion de la RTBF prévoit le respect des « obligations quantitatives et de moyens énoncés par le Règlement du Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle ». Les tableaux ci-dessous reprennent les obligations énoncées par le Règlement du 17 juillet 2018 qui s’appliquent aux chaînes de la RTBF à partir de l’année 2024, au terme de la période transitoire :
| Audience des chaînes de la RTBF | Obligations en matière de sous-titrage adapté et d’interprétation en langue des signes |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 95% des programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 35% de programmes rendus accessibles au moyen du sous-titrage adapté. |
| Audience des chaînes de la RTBF | Obligations en matière d’audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est supérieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 25% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
| Lorsque l’audience moyenne de la chaîne est inférieure à 2.5% | Obligation d’atteindre 15% des programmes de fiction et documentaires du service, diffusés aux heures de grande écoute (13h-24h), à l’exception des formats courts, en audiodescription |
- Garantir un accès avec traduction gestuelle au JT de début de soirée et au JT spécifiquement destiné à la jeunesse, sur AUVIO ou sur une de ses chaînes;
- Considérer les sous-titres comme le principe d’écriture des programmes d’information à destination des plateformes internet ;
- Diffuser sur la plateforme AUVIO les programmes rendus accessibles et diffusés sur les chaînes de télévision ; En vertu du Règlement, la RTBF est également soumise pour sa plateforme AUVIO à l’obligation de tout mettre en œuvre pour atteindre les seuils fixés : 25% de programmes disposant d’un sous-titrage adapté et 25% des programmes de fiction et documentaires audiodécrits. (Voir aussi : Qu’offre la video à la demande en matière d’accessibilité).
- Rendre leur site internet progressivement accessible aux personnes en situation de déficience visuelle ;
- Sous-titrer les interviews réalisées en langue étrangère au sein des JT et magazine d’information, autant que possible.
- La RTBF doit également respecter les critères de qualité énoncés par la Charte de qualité du Collège d’Avis.
- https://www.csa.be/document/reglement-accessibilite-juillet-2018/
- https://www.csa.be/97195/accessibilite-des-programmes-le-secteur-publie-une-charte-qualite/.
Non. Les éditeurs de services publics (la RTBF et les médias de proximité) ne peuvent pas diffuser ce type de programmes, contrairement aux éditeurs de services privés qui peuvent en diffuser mais doit en faire la déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle. Les programmes de télé-achat, qu’ils soient dans les services linéaires ou non linéaires sont soumis à des règles propres. Le CSA a pour mission de réguler ces programmes et de vérifier le respect des obligations, par les éditeurs concernés, des dispositions légales en matière audiovisuel en effectuant des « monitorings ». Si des infractions sont constatées (par exemple une interruption d’un programme de télé-achat par un message publicitaire), le CSA peut sanctionner l’éditeur. Pour assurer la protection des téléspectateurs/consommateurs, le CSA exerce une compétence conjointe avec la Commission des jeux de hasard :
- la Commission des jeux de hasard applique la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et l’arrêté royal du 21 juin 2011 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ;
- le CSA est, quant à lui, compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s’y appliquent, conformément au décret sur les services de médias audiovisuels.
Oui. Le placement de produit a fait son apparition dans la réglementation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le décret du 5 février 2009 qui transposait la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (directive SMA). La directive SMA du 11 décembre 2007 a introduit la notion de placement de produit et admet sa pratique dans différents types de programmes, moyennant le respect de certaines conditions.
Il s'agit donc d'une autorisation partielle et conditionnelle. Elle n'est applicable qu'aux télévisions (donc pas aux radios). Le placement de produit est désormais réglementé à l'article 21 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, pour les programmes produits après le 19 décembre 2009. Le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a adopté une recommandation sur le placement de produit, afin de préciser les contours et critères de cette nouvelle pratique, dans un souci de transparence et de sécurité juridique. Des dispositions particulières s’appliquent à la RTBF.
Les médias de proximité sont soumis à la même réglementation décrétale que les autres services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires. Toutefois, certaines exceptions s’appliquent aux médias de service public dont les médias de proximité font partie. Par rapport aux règles spécifiques en matière de communication commerciale :
- la publicité et l’autopromotion ne peuvent interrompre ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme d’un média de proximité ;
- les programmes de télé-achat ne peuvent être diffusés sur les médias de proximité.
Non. Sauf pour ce qui concerne la RTBF, les médias de proximité qui doivent diffuser des programmes d’’information, la décision de diffuser ou non de l’information relève des choix programmatiques de l’éditeur.
Un média de proximité (anciennement dénommé « télévision locale ») est un éditeur de services de médias audiovisuels de proximité, autorisé par le Gouvernement.Les 12 médias de proximité ont pour mission de service public, dans la zone de couverture les concernant (un ensemble de communes), la production et la réalisation de programmes d’actualités, d’animation, de développement culturel et d’éducation permanente. Ils s’engagent également à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture les concernant. C’est le gouvernement qui autorise les médias de proximité pour une durée de 9 ans (renouvelable). Certaines obligations spécifiques des médias de proximité sont stipulées dans le décret (notamment en matière de communication commerciale), mais c’est la convention, conclue entre le Gouvernement et chaque média de proximité que les modalités particulières d’exécution de la mission de service public sont précisées. Les nouvelles conventions datent de février 2022.
Les missions et obligations spécifiques aux médias de proximité sont définis par des conventions liant chaque média de proximité au Gouvernement. Les missions confiées aux médias de proximité trouvent leur source dans le décret et dans la convention qui lie chaque éditeur au Gouvernement. Ils poursuivent le même objectif d’intérêt public que la RTBF mais avec la proximité propre à leur statut. Les médias de proximité donnent un écho particulier à l’actualité locale sous toutes ses formes. Leur dimension participative est fondamentale, ils veillent dès lors à entretenir des rapports étroits avec leurs téléspectateurs pouvant se concrétiser par une participation effective aux programmes. Cette proximité se traduit également par une obligation liée à la composition de leurs conseils d’administration au sein desquels doit siéger une majorité de représentants des secteurs associatifs et culturels de leur zone de couverture.
Les missions de services public de la RTBF sont définies par son contrat de gestion. Ces principales thématiques des missions sont : Diversité La RTBF s’implique dans la valorisation de la diversité de la société belge francophone, elle veille à élaborer sa programmation en intégrant les principes d’interculturalité, de mixité sociale et d’équilibre des genres. Production La RTBF privilégie la production de programmes par ses effectifs propres. En parallèle, son contrat de gestion lui impose de conclure des partenariats de coproduction avec des producteurs indépendants de la Communauté française. Chaque année, un pourcentage de ses revenus est investi dans ces partenariats. Information L’information est un axe fort de la programmation de la RTBF. En vertu de son contrat de gestion, elle édite notamment trois journaux télévisés quotidiens, des programmes d’investigation, d’entretiens et de débats. De façon générale, elle veille à sensibiliser un public aussi large que possible aux enjeux d’actualité. Développement culturel La RTBF est un acteur important du dynamisme culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, elle veille à mettre en valeur les artistes qui en sont originaires, notamment les talents émergents. En outre, elle accorde du temps d’antenne à des retransmissions de spectacles, à des captations d’événements culturels et au cinéma d’auteur. Education permanente En tant que média de service public, la RTBF contribue à l’éducation permanente de ses publics, à ce titre elle produit des programmes qui développent la connaissance et la réflexion : éducation aux médias, sensibilisation aux enjeux environnementaux, pédagogie scientifique et historique, cohésion sociale, protection des consommateurs… Valorisation du patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles La RTBF veille à ce que sa programmation valorise le patrimoine architectural, naturel et entrepreneurial de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Médiation La RTBF est à l’écoute de son public, via le traitement des plaintes qui arrivent à son service de médiation et via la conception de programmes lui permettant de dialoguer avec ses publics. Jeunesse La RTBF s’adresse à tous les Belges francophones, en ce compris les enfants et adolescents à l’attention desquels elle produit des programmes participatifs spécifiques. Collaborations La RTBF collabore aux projets télévisuels internationaux (ARTE, TV5 monde, Euronews) par la production de contenus reflétant la culture belge francophone. Elle entretient également des partenariats avec la presse écrite, les médias de proximité et la VRT. Production propre La RTBF et les médias de proximité doivent produire une partie de leur programmation en interne avec leurs effectifs propres. Cette obligation s’exprime en durée moyenne quotidienne pour la RTBF et en durée moyenne hebdomadaire pour les médias de proximité. Synergies entre éditeurs de service public Dans un souci d’améliorer leurs services aux citoyens, les télévisions de service public sont amenées à collaborer sous différentes formes, notamment par la mutualisation de moyens de production, des échanges et des coproductions de programmes.
En tant que service public, la RTBF a des obligations spécifiques en matière d’égalité et de diversité. Elles sont définies dans son contrat de gestion. Le contrat de gestion de la RTBF stipule que « la RTBF veille à l’absence de toute discrimination dans sa gestion des ressources humaines et met en œuvre un plan relatif à la diversité au sein de son personnel, basé sur le concept de diversité inclusive et relatif à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein, tant pour le recrutement que pour la gestion de carrière, notamment afin d’augmenter progressivement le nombre de femmes dans les fonctions de responsabilité et managériales ainsi que dans les fonctions à forte visibilité (…) ». Plus particulièrement, le contrat de gestion définit quatre axes s’agissant de l’égalité et de la diversité : mettre en œuvre un plan de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein du personnel ; désigner un référent interne chargé de l’égalité hommes-femmes et de la diversité ; adopter la Charte de l’UER sur l’égalité des chances ; soutenir toute initiative visant à renforcer pratiquement la diversité inclusive dans ses services audiovisuels et inciter son personnel en ce sens. Le CSA remet chaque année un avis sur la réalisation de ces obligations. Les avis qui concernent la RTBF sont disponibles via l'onglet "Régulation" de la fiche RTBF sur notre site pluralisme.
Quand on parle de médias publics, on vise en général, d’une part, la RTBF et, d’autre part, les médias de proximité (anciennement appelés télévisions locales). La manière dont ces deux types de médias sont « politisés » est différente. La RTBF est une entreprise publique autonome créée par un décret de la Communauté française dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique culturelle. A ce titre, elle est soumise à la loi du 16 juillet 1973 dite du « Pacte culturel » qui prévoit qu’il faut associer les différentes tendances idéologiques et philosophiques à cette politique culturelle. Pour cette raison, le décret de la Communauté française précité, qui institue la RTBF, prévoit que son conseil d'administration « est composé de treize administrateurs, élus pour la durée de la législature par le Parlement qui fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ». Les membres du conseil d’administration de la RTBF ont donc une « étiquette politique » et représentent de manière proportionnelle les mêmes partis démocratiques que ceux qui composent le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agit de politiciens aguerris. En effet, la qualité d’administrateur de la RTBF est incompatible avec la quasi-totalité des mandats politiques à part celui de conseiller communal. La présence d’administrateurs représentant les différents partis présents au Parlement vise plutôt à garantir un pluralisme au sein de cet organe, de manière à ce qu’aucun parti en particulier ne puisse dicter sa loi. La politisation de la RTBF est donc un outil visant, in fine, à garantir sa neutralité. Quant aux médias de proximité, leur situation est, juridiquement, quelque peu différente car il s’agit d’ASBL privées, bien que subventionnées. Elles ne sont donc pas directement soumises à la loi dite du Pacte culturel. Mais le principe de représentation proportionnelle des différentes tendances y est également appliqué, sur pied du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médis audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Au sein des médias de proximité, maximum 50 % des administrateurs peuvent avoir la qualité de mandataires politiques. Cette notion couvre seulement certains mandats (conseiller communal, provincial, de l’action sociale, et membre d’un cabinet), tous les autres mandats étant incompatibles avec la qualité d’administrateur d’un média de proximité. En outre, pour ces administrateurs ayant la qualité de mandataires politiques, ils doivent être désignés à la proportionnelle de la composition :
- de l’ensemble des conseils communaux de la zone de couverture du média de proximité concerné (en Wallonie)
- de l’assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) (à Bruxelles)
La RTBF est un éditeur de SMA dit « de service public ». Cela veut dire que les pouvoirs publics (en l’occurrence le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles) lui ont confié un certain nombre de missions d’intérêt général et que, en échange, ils lui octroient les moyens d’assurer ces missions. Le contrat de gestion de la RTBF est le document dans lequel sont listées ces missions et dans lequel sont fixés ces moyens. On parle de contrat car il n’est pas imposé unilatéralement à la RTBF mais négocié entre elle et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus précisément, un nouveau contrat est adopté tous les trois à six ans. Il peut également être modifié en cours d’exécution, toujours de commun accord entre les parties. La RTBF est donc soumise, d’une part, à la majorité des règles auxquelles sont soumis les autres éditeurs de SMA et, d’autre part, aux règles figurant dans son contrat de gestion qui lui imposent des exigences plus strictes qu’aux éditeurs privés. Le contrat de gestion actuel de la RTBF peut être consulté ici.
| Télévision
Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Le règlement prévoit des obligations, pour les éditeurs et les distributeurs, en matière de communication sur les programmes rendus accessible afin de faciliter leur identification par le public. Les téléspectateurs doivent donc être informés de l’accessibilité des programmes par :
- L’incrustation du pictogramme approprié en début de programme et dans les bandes annonces ;
- Une mention sonore, lorsqu’il s’agit de programmes à destination des personnes en situation de déficience visuelle.
- Au sein de la communication externe des éditeurs et des distributeurs (sur leur site par exemple, ou au sein de la presse écrite);
- Au sein des guides électroniques de programmes ( EPG) ;
- Au sein des catalogues de services de vidéos à la demande.
- Un pictogramme comportant les lettres "ST" indique la présence de sous-titres à destination des personnes en situation de déficience auditive .
- Un pictogramme comportant les lettres "AD" indique la présence d’une audiodescription à destination des personnes en situation de déficience visuelle.

 Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants
Le guide des programmes disponible sur le site de la RTBF permet d’identifier facilement les programmes sous-titrés et audiodécrits diffusés sur La Une, Tipik et La Trois grâce aux fonctionnalités de filtre mises à disposition ( https://www.rtbf.be/tv/guide-tv). Il suffit de sélectionner le type de programme recherché pour connaître toutes les diffusions prévues au cours des 14 jours suivants
Je dois effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services télévisuels que j’entends éditer. Le CSA est compétent, dans le mois de la réception de la déclaration, pour en accuser réception et observer la conformité des éléments que vous communiquez avec les éléments requis par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des services télévisuels. Ce document est disponible à l’unité « Télévisions » du CSA.
TNT est l'abréviation de "télévision numérique terrestre". La TNT désigne la diffusion sous format numérique de chaînes de télévision et de radio via les fréquences hertziennes terrestres. Aujourd'hui, un seul bouquet numérique est diffusé sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il contient les trois chaînes de la RTBF et Euronews ainsi que les radios de la RTBF et de la BRF. Chez nous, la réception de la TNT est entièrement gratuite et ne nécessite pas d'abonnement, il suffit pour la recevoir d'une antenne (idéalement de toit) et d'un décodeur DVB-T (présent dans tous les téléviseurs récents). Plus d'information sur la TNT de la RTBF dans la section « 100 questions sur la TNT ».
Oui, dans certaines conditions. Toutefois, une controverse juridique existe quant à la question de savoir quel niveau de pouvoir est compétent pour encadrer ce droit de réponse. Au niveau de la Communauté française, le Parlement n’a jamais décidé d’intervenir dans cette matière. Elle reste donc régie par une loi fédérale du 23 juin 1961 relative au droit de réponse. L'article 7 de cette loi dispose que « sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur ». Cette réponse sera lue par la personne désignée par l'éditeur, sans commentaire, ni réplique. Le bénéficiaire du droit de réponse n'accède en aucun cas personnellement à l'antenne. Si ce droit de réponse est refusé par l'éditeur, le demandeur dispose d'une possibilité de faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux.
Le CSA a pour mission de réguler les nouveaux formats de programme, dont les programmes de call tv. Régulièrement, il vérifie le respect des obligations, par les chaînes de télévision, des dispositions légales en matière audiovisuel en effectuant des « monitorings » des programmes des éditeurs qui diffusent ce type de programmes. S'il constate des infractions (par exemple une interruption d’un programme de call TV –qualifié de télé-achat– par un message publicitaire), le CSA peut sanctionner l'éditeur. Pour assurer la protection des téléspectateurs/consommateurs, le CSA exerce une compétence conjointe avec la Commission des jeux de hasard. Leurs prérogatives respectives sont délimitées et ne se chevauchent pas :
- la Commission des jeux de hasard applique la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et l'arrêté royal du 21 juin 2011 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ;
- le CSA est, quant à lui, compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s'y appliquent, conformément au décret sur les services de médias audiovisuels.
Non. Sauf pour ce qui concerne la RTBF, les médias de proximité qui doivent diffuser des programmes d’’information, la décision de diffuser ou non de l’information relève des choix programmatiques de l’éditeur.
Un média de proximité (anciennement dénommé « télévision locale ») est un éditeur de services de médias audiovisuels de proximité, autorisé par le Gouvernement.Les 12 médias de proximité ont pour mission de service public, dans la zone de couverture les concernant (un ensemble de communes), la production et la réalisation de programmes d’actualités, d’animation, de développement culturel et d’éducation permanente. Ils s’engagent également à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture les concernant. C’est le gouvernement qui autorise les médias de proximité pour une durée de 9 ans (renouvelable). Certaines obligations spécifiques des médias de proximité sont stipulées dans le décret (notamment en matière de communication commerciale), mais c’est la convention, conclue entre le Gouvernement et chaque média de proximité que les modalités particulières d’exécution de la mission de service public sont précisées. Les nouvelles conventions datent de février 2022.
Les missions et obligations spécifiques aux médias de proximité sont définis par des conventions liant chaque média de proximité au Gouvernement. Les missions confiées aux médias de proximité trouvent leur source dans le décret et dans la convention qui lie chaque éditeur au Gouvernement. Ils poursuivent le même objectif d’intérêt public que la RTBF mais avec la proximité propre à leur statut. Les médias de proximité donnent un écho particulier à l’actualité locale sous toutes ses formes. Leur dimension participative est fondamentale, ils veillent dès lors à entretenir des rapports étroits avec leurs téléspectateurs pouvant se concrétiser par une participation effective aux programmes. Cette proximité se traduit également par une obligation liée à la composition de leurs conseils d’administration au sein desquels doit siéger une majorité de représentants des secteurs associatifs et culturels de leur zone de couverture.
Les missions de services public de la RTBF sont définies par son contrat de gestion. Ces principales thématiques des missions sont : Diversité La RTBF s’implique dans la valorisation de la diversité de la société belge francophone, elle veille à élaborer sa programmation en intégrant les principes d’interculturalité, de mixité sociale et d’équilibre des genres. Production La RTBF privilégie la production de programmes par ses effectifs propres. En parallèle, son contrat de gestion lui impose de conclure des partenariats de coproduction avec des producteurs indépendants de la Communauté française. Chaque année, un pourcentage de ses revenus est investi dans ces partenariats. Information L’information est un axe fort de la programmation de la RTBF. En vertu de son contrat de gestion, elle édite notamment trois journaux télévisés quotidiens, des programmes d’investigation, d’entretiens et de débats. De façon générale, elle veille à sensibiliser un public aussi large que possible aux enjeux d’actualité. Développement culturel La RTBF est un acteur important du dynamisme culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, elle veille à mettre en valeur les artistes qui en sont originaires, notamment les talents émergents. En outre, elle accorde du temps d’antenne à des retransmissions de spectacles, à des captations d’événements culturels et au cinéma d’auteur. Education permanente En tant que média de service public, la RTBF contribue à l’éducation permanente de ses publics, à ce titre elle produit des programmes qui développent la connaissance et la réflexion : éducation aux médias, sensibilisation aux enjeux environnementaux, pédagogie scientifique et historique, cohésion sociale, protection des consommateurs… Valorisation du patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles La RTBF veille à ce que sa programmation valorise le patrimoine architectural, naturel et entrepreneurial de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Médiation La RTBF est à l’écoute de son public, via le traitement des plaintes qui arrivent à son service de médiation et via la conception de programmes lui permettant de dialoguer avec ses publics. Jeunesse La RTBF s’adresse à tous les Belges francophones, en ce compris les enfants et adolescents à l’attention desquels elle produit des programmes participatifs spécifiques. Collaborations La RTBF collabore aux projets télévisuels internationaux (ARTE, TV5 monde, Euronews) par la production de contenus reflétant la culture belge francophone. Elle entretient également des partenariats avec la presse écrite, les médias de proximité et la VRT. Production propre La RTBF et les médias de proximité doivent produire une partie de leur programmation en interne avec leurs effectifs propres. Cette obligation s’exprime en durée moyenne quotidienne pour la RTBF et en durée moyenne hebdomadaire pour les médias de proximité. Synergies entre éditeurs de service public Dans un souci d’améliorer leurs services aux citoyens, les télévisions de service public sont amenées à collaborer sous différentes formes, notamment par la mutualisation de moyens de production, des échanges et des coproductions de programmes.
L’édition d’un service télévisuel s’accompagne de responsabilités particulières. Ces missions et obligations des télévisions privées qui suivent sont définies par le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. Ces règles sont communes à tous les types de services télévisuels. Transparence L’éditeur d’un service de média audiovisuel a l’obligation de rendre publiques certaines informations de base le concernant, notamment la composition de son conseil d’administration, son actionnariat, ses bilans et comptes et la mention du CSA comme organe de contrôle. L’objectif de ce principe de transparence est que les auditeurs et les téléspectateurs puissent être informés de l’origine de la programmation. L’éditeur doit concrètement publier ces informations sur son site internet. Quotas de diffusion Les quotas de diffusion sont des outils de politique culturelle. En télévision linéaire, ils prennent plusieurs formes :
- Le temps d’antenne doit être composé majoritairement de programmes en français, et d’un minimum de 20% de programmes d’expression originale francophone.
- Les éditeurs doivent diffuser une majorité d’œuvres européennes et 10% d’œuvres européennes émanant de producteurs indépendants et produites endéans les 5 ans précédant la diffusion.
- Si l’éditeur diffuse de la musique, il doit réserver 4,5% de cette programmation à des compositeurs, artistes-interprètes, ou des producteurs domiciliés en Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Les services proposant au minimum 80% de programmes produits en propre.
- Les services ayant une ligne éditoriale spécifiquement centrée sur des contenus extra européens.
- Les services locaux.
Le concept de télévision se diversifie. Le CSA régule plusieurs types de « services de médias audiovisuels » : publics ou privés, linéaires ou non linéaires. Il peut être résumé en trois grandes catégories :
- les télévisions de service public avec les services télévisuels de la RTBF et les 12 médias de proximité ;
- les télévisions privées en diffusion linéaire ou de type catalogue d’œuvres audiovisuelles à la demande ;
- les services internet (Webtv, vlogueurs, streameurs).
Pour en savoir plus sur la composition exacte du paysage télévisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles : https://www.csa.be/television/VOD pour « vidéo on demand » : désigne les services de médias audiovisuels non linéaires. Leurs programmes sont visionnables à tous moments par les téléspectateurs, soit gratuitement (souvent en contrepartie du visionnage de publicités), soit moyennant un paiement à l’unité (on parle alors de « TVOD » pour désigner le caractère « transactionnel » du visionnage), soit moyennant la souscription d’un abonnement qui permet l’accès illimité à un catalogue (on parle alors de « SVOD » pour désigner le fait qu’une souscription est nécessaire). Les services VOD peuvent également revêtir un caractère hybride en cumulant les types de commercialisation décrits ci-dessus.
La chronologie des médias désigne l’accord sectoriel qui fixe les fenêtres successives d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle en fonction du type de diffusion (télévision à accès libre, télévision premium, TVOD, SVOD…). C’est sur ce système que repose la rentabilité des œuvres et des diffuseurs. Pour chaque film ou documentaire, cette chronologie débute à la sortie de l’œuvre en salle puis se prolonge sur 36 mois divisés en périodes successives comme suit:
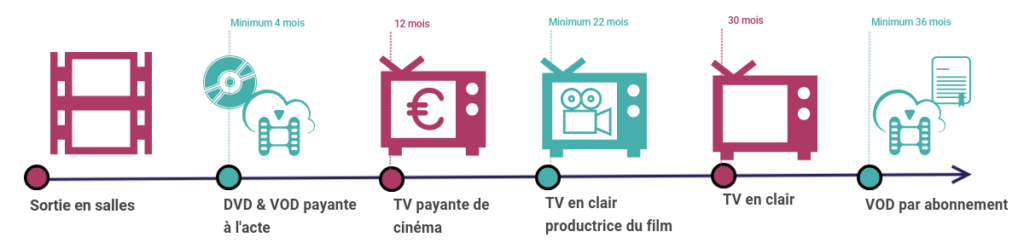
La call TV est un format de programme animé par un présentateur qui incite les téléspectateurs à jouer, dans l'espoir de remporter un prix ou de l'argent, en répondant à une question (de culture générale ou de logique) via un numéro d'appel téléphonique surtaxé. Depuis une décision de 2008, le CSA a décidé que la call tv relevait du télé-achat. On entend par télé-achat : la diffusion d’offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots ou de vidéos créées par l’utilisateur, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d’obligations.
Si certains contenus vidéos mis en ligne sur internet par des chaînes étrangères ne sont pas accessibles depuis la Belgique, c’est avant tout pour des raisons économiques. En effet, les chaînes ne donnent habituellement accès depuis l’étranger qu’aux vidéos pour lesquelles elles disposent de tous les droits de retransmission. Il s’agit en général des émissions produites en interne, par exemple les journaux télévisés. Si les chaînes étrangères souhaitent diffuser sur internet d’autres contenus vidéo pour lesquels elles ne disposent pas à l’origine de tous les droits de retransmission, elles doivent s’acquitter des droits d’auteur. Cette rémunération s’imposant pour chaque territoire national sur lequel la chaîne entend diffuser ces contenus, le surcoût financier pour la libération de ces droits dans le monde entier est souvent très élevé. La mise à disposition sur internet de l’ensemble des programmes à la demande se limite ainsi généralement au territoire de la chaîne en question. Il est également possible qu’une chaîne dispose des droits exclusifs de diffusion de certaines œuvres sur un territoire et qu’une autre chaîne ait acquis ces mêmes droits pour un autre territoire. Il n’y a donc, de la part de ces chaînes, aucune volonté de censure ni d’entrave à la libre circulation des services. L’explication tient également pour les contenus vidéo de chaînes belges qui seraient inaccessibles sur internet depuis l’étranger.
| Radio
DAB+ est l'abréviation de Digital Audio Broadcasting. Il s’agit de la norme pour la diffusion de la radio numérique sur les ondes hertziennes terrestres la plus largement utilisée en Europe. A terme, la diffusion analogique via les fréquences FM devrait être progressivement remplacée par une diffusion en numérique, soit via la norme DAB+, soit via internet (webradio). La réception de radios en DAB+ nécessite un récepteur compatible.
La radiodiffusion hertzienne est soumise à un régime d'autorisation préalable tel que prévu dans le Décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Le CSA est compétent pour autoriser tout service de radiodiffusion sonore de tout éditeur de services privé dans le cadre du cadastre des fréquences défini par le Gouvernement. La délivrance de ces autorisations ne peut toutefois se faire que sur la base des listes de fréquences arrêtées par le Gouvernement. En d'autres termes, c'est le gouvernement qui détermine les fréquences utilisables et le CSA qui détermine qui les utilise. Enfin, le CSA ne peut autoriser un nouvel éditeur radio en mode hertzien (FM ou DAB+) que dans le cadre d'un appel d'offre.
Oui, dans certaines conditions. Toutefois, une controverse juridique existe quant à la question de savoir quel niveau de pouvoir est compétent pour encadrer ce droit de réponse. Au niveau de la Communauté française, le Parlement n’a jamais décidé d’intervenir dans cette matière. Elle reste donc régie par une loi fédérale du 23 juin 1961 relative au droit de réponse. L'article 7 de cette loi dispose que « sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur ». Cette réponse sera lue par la personne désignée par l'éditeur, sans commentaire, ni réplique. Le bénéficiaire du droit de réponse n'accède en aucun cas personnellement à l'antenne. Si ce droit de réponse est refusé par l'éditeur, le demandeur dispose d'une possibilité de faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux.
Oui. Toutefois, le droit à l'image est une matière relevant de la compétence de l'Etat fédéral, et non de celle de la Communauté française. Le respect du droit à l'image ne peut donc être contrôlé par le CSA, sauf s'il s'accompagne d'autres violations comme le respect de la dignité humaine. Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, au même titre que le droit à la vie privée, à l'intimité, à la liberté d'expression,… Ce droit à l'image peut, dans certaines circonstances, être une des expressions du concept de dignité humaine. Le méconnaître pourrait bafouer l'humanité de chaque individu et ainsi manquer à la dignité humaine. En ce sens, ces droits peuvent être considérés comme inviolables et incessibles. Dans un avis relatif à la dignité humaine rendu en 2002, le Collège d'avis du CSA s'est exprimé sur les contours de cette question. Il a notamment estimé que la cession d'une partie des droits liés à la personnalité peut être admise pour autant qu'elle respecte certaines conditions, notamment celles liées aux principes de spécialité (la cession ne peut porter que sur un objet précis) et de précarité (possibilité de retrait). Dans un avis relatif à la mise à disposition du public d'archives audiovisuelles liées à l'actualité qu'il a rendu en juin 2009, le Collège d'avis a estimé que l'équilibre entre droit à l'information et droit à l'image (deux principes soumis à interprétation constante des Cours et Tribunaux) relèvait davantage de la pratique journalistique et que dès lors toutes questions relatives à cet équilibre devaient être discutées au sein du CDJ (Conseil de déontologie journalistique). Il a également retenu que cet équilibre repose sur le principe de l'autorisation préalable (y compris tacite), quel que soit le support sur lequel transite l'information en ce compris pour les utilisations ultérieures. Plutôt que d'instaurer un droit de rétractation unilatéral, qui gênerait l'exercice du droit à l'information et celui du fait de l'histoire, le Collège préfère que les éditeurs informent au mieux le public sur la manière dont ils traitent les éventuelles demandes de rétractation. Il les invite également à indiquer sur leur site ou de toute autre manière qu'ils jugent appropriée, les modalités de rétractation (manière de traiter la plainte, suivi, procédures…) et d'en identifier le service ou la personne responsable. Enfin, dans cet avis, le Collège a également attiré l'attention des éditeurs sur le fait que de nombreuses émissions, en dehors des émissions d'actualité recourent à la participation de spectateurs et que ces émissions ne sont pas encadrées par les règles de déontologie journalistique, contrairement aux émissions d‘actualité. C'est pourquoi il a rappellé l'avis qu'il avait rendu en 2002 sur la télévision de l'intimité et a invité les éditeurs à sensibiliser leurs animateurs aux principes du droit de la personnalité. Il a recommandé également que les éditeurs accordent une attention toute particulière aux contenus audiovisuels qui requièrent la participation de mineurs d'âge et rappellé sa recommandation de mars 2009 relative à la participation et la représentation des mineurs dans les services de médias audiovisuels.
Le Décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos du 4 février 2021 prévoit la possibilité pour un éditeur de modifier ses engagements au cours de la période d’autorisation (Article 3.1.3-7 - §2). Pour toute demande de révision d’engagements transmise par un éditeur, le Collège d’autorisation et de contrôle statue au regard des critères cumulatifs suivants :
- Le respect de l’identité originelle du service sonore du demandeur ;
- L’impact des modifications sur les éléments appréciés par le Collège au moment de l’attribution de l’autorisation ;
- L’impact sur l’équilibre du paysage radiophonique qui doit être préservé ;
- Le contexte interne à l’éditeur de services qui doit justifier positivement la révision des engagements et non constituer une simple régression ;
- Si la demande de modification vise à obtenir une modification des engagements, l’intensité de la contribution du service sonore à la diversité culturelle et linguistique qui doit être conservée.
- La modification demandée ;
- Les raisons la justifiant ;
- La contrepartie proposée.
Une radio reconnue en qualité de « radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente » est une radio indépendante remplissant des missions spécifiques tel que prévu dans le Décret, et bénéficiant à ce titre d’un subside annuel. Les radios ayant le statut de « radio associative » doivent diffuser un volume minimum de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des œuvres de création radiophonique ; elles doivent avoir recourt principalement au bénévolat et associer des bénévoles dans leurs organes de gestion et elles ne peuvent recourir à la publicité ou alors disposer de revenus publicitaires limités. Les 21 radios associatives reconnues en Fédération Wallonie-Bruxelles font l’objet d’un contrôle spécifique de la part du CSA. Plus d’information: https://www.csa.be/document/recommandation-du-14-mai-2020-relative-au-statut-de-radios-associatives/
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les radios privées (en réseau et indépendantes) ont des obligations fixées par le Décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Dans le cadre d’un appel d’offres, les candidats prennent une série d’engagements parfois plus élevés que les obligations minimales fixées par le Décret. Ces obligations et engagements, contrôlés par le CSA, concernent principalement les domaines suivants : information, production propre, promotion culturelle, quotas musicaux, utilisation de la langue Française, transparence, remise de rapport et piges. Plus d’information voir la section radio de notre site internet.
Le CSA peut autoriser l’utilisation de radiofréquences pour une période de trois mois maximum dans le cadre fixé par le Décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Le Décret précise que « Les radiofréquences ne peuvent être assignées qu’à des fins de couverture, par un service spécifique, d’un événement à caractère culturel, sportif, scientifique ou d’intérêt général. » Plus d’informations > https://www.csa.be/document/procedure-de-demande-dautorisation-radios-provisoires
La diffusion radio numérique terrestre se fait par multiplexage, c’est-à-dire que plusieurs stations de radio sont diffusées sur un seul canal de 1,5 MHz de large. Cela permet de mutualiser les coûts de transmission et d’utiliser les mêmes émetteurs et les mêmes sites d’antenne pour tous les services. La radio numérique ne présentera pas les mêmes problèmes de brouillages qu’en FM. Car soit on capte le signal, soit on ne le capte pas. De plus, contrairement à la diffusion analogique (FM), la diffusion numérique permet d’utiliser autant d’émetteurs que nécessaire pour couvrir un territoire donné. Il est possible d’ajouter au flux audio une série d’informations sous forme de textes, d’images fixes ou de vidéo. L’optimisation de l’usage du spectre est également une grande qualité de la numérisation car on occupe moins de capacité pour une qualité de son identique, voire supérieure. Cette rationalisation permet donc d’offrir plus de chaînes, réparties de manière plus équitable sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Non. Sauf pour ce qui concerne la RTBF, les médias de proximité qui doivent diffuser des programmes d’’information, la décision de diffuser ou non de l’information relève des choix programmatiques de l’éditeur.
| Média en ligne
Les obligations définies par le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéo (relatives au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la dignité humaine, à l’incitation à la violence et aux questions de discriminations) s’appliquent aussi bien aux services linéaires que non-linéaires, c’est-à-dire sur internet (web TV, web radio, services de vidéo à la demande, catch up TV/rattrapage, les chaînes des « Vloggeurs » rencontrant les critères d’un service de média audiovisuel). En outre, La directive européenne 2018/1808 sur les services de médias audiovisuels a introduit le concept de « service de plateforme de partage de vidéos » comme nouvelle catégorie à laquelle la régulation audiovisuelle attachait désormais des obligations. Cette directive a été transposée dans la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Désormais, les plateformes de partage de vidéo se voient donc attacher certaines obligations notament pour les fournisseurs de services de partage de vidéos de prendre des mesures pour protéger les utilisateurs (système de signalisation, procédure pour le traitement des réclamations, …).
Ces obligations sont inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Certaines règles sont communes à tous les médias dans le but d’assurer au public une protection de base à laquelle il peut légitimement s’attendre face à tout média audiovisuel, quel que soit son support ou son mode de diffusion. D’autres règles sont plus souples parce que vous diffusez sur internet ou parce que vous offrez un service à la demande de l’utilisateur.
- Je dois déclarer ma web TV auprès du CSA.
-
Je dois faire apparaître sur mon site web quelques mentions légales de transparence, conformément à l’article 6, §1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. L’objectif du décret est de rendre publiques les informations de base me concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans mes programmes.
- Si vous êtes une ASBL, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une société, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une commune ou une autre instance publique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une personne physique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Je dois remplir une fois par an un formulaire fourni par le CSA, appelé le rapport annuel, en communiquant quelques éléments d’informations relatifs au respect de la législation sur le droit d’auteur et droits voisins, à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (seulement si le chiffre d’affaires le permet) et à la mise en valeur des œuvres européennes comprises dans votre catalogue. Le rapport annuel est également l’occasion de signaler au CSA d’éventuelles modifications par rapport aux informations communiquées préalablement dans votre déclaration, ainsi que de signaler les mesures prises en matière de protection des mineurs.
- Je suis enfin tenu de respecter les règles relatives à la dignité humaine et à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité et communication commerciale.
La radio sur internet, parfois aussi appelée radio sur IP, permet d’accéder à un très grand nombre de services sonores en streaming (webradios) via un ordinateur, un smartphone, une enceinte connectée ou un récepteur dédié. Certaines webradios sont les versions en ligne de radios existantes, d’autres ne sont distribuées que via internet. Contrairement aux services transmis sur les ondes hertziennes (FM, DAB+), créer une radio sur internet est accessible à toutes et tous et peut être très bon marché. Mais, à la différence de la FM ou de la radio numérique terrestre (DAB+), l’accès aux radios sur internet n’est pas gratuit pour les utilisateurs. En effet, ils doivent disposer d’une connexion internet. Là où les technologies de radiodiffusions hertziennes permettent un accès universel et anonyme, la réception de la radio via internet est traçable. Ce qui permet de pister les utilisateurs pour leur adresser des contenus ciblés, comme par exemple de la publicité. Enfin, la question de la neutralité de l’internet est pertinente concernant la radio sur internet : les fournisseurs d’accès sont des intermédiaires incontournables qui ont la faculté de ralentir ou bloquer les flux des radios de manière arbitraire, par exemple celles qu’ils considéreraient comme concurrentes ou avec lesquelles ils n’auraient pas conclu d’accord commercial. Tout ceci constitue un enjeu démocratique important.
Toute personne physique ou morale basée en Fédération Wallonie-Bruxelles éditant ou voulant créer un service sonore distribué via internet (webradio, podcast) doit en faire la déclaration auprès du CSA. Pour ce faire, il faut suivre la procédure décrite sur le page " https://www.csa.be/radios-autorisation-et-declaration/" et envoyer le formulaire complété au CSA.
Si certains contenus vidéos mis en ligne sur internet par des chaînes étrangères ne sont pas accessibles depuis la Belgique, c’est avant tout pour des raisons économiques. En effet, les chaînes ne donnent habituellement accès depuis l’étranger qu’aux vidéos pour lesquelles elles disposent de tous les droits de retransmission. Il s’agit en général des émissions produites en interne, par exemple les journaux télévisés. Si les chaînes étrangères souhaitent diffuser sur internet d’autres contenus vidéo pour lesquels elles ne disposent pas à l’origine de tous les droits de retransmission, elles doivent s’acquitter des droits d’auteur. Cette rémunération s’imposant pour chaque territoire national sur lequel la chaîne entend diffuser ces contenus, le surcoût financier pour la libération de ces droits dans le monde entier est souvent très élevé. La mise à disposition sur internet de l’ensemble des programmes à la demande se limite ainsi généralement au territoire de la chaîne en question. Il est également possible qu’une chaîne dispose des droits exclusifs de diffusion de certaines œuvres sur un territoire et qu’une autre chaîne ait acquis ces mêmes droits pour un autre territoire. Il n’y a donc, de la part de ces chaînes, aucune volonté de censure ni d’entrave à la libre circulation des services. L’explication tient également pour les contenus vidéo de chaînes belges qui seraient inaccessibles sur internet depuis l’étranger.
Pour savoir si vous devez déclarer votre webTV, il faut se poser les deux questions suivantes :
- Ma web TV relève-t-elle de ma responsabilité éditoriale (c’est-à-dire que j’ai un contrôle sur la sélection des programmes et sur leur organisation) et son objet principal est-il de communiquer au public des programmes télévisuels (c’est-à-dire des images animées combinées ou non à du son) dans le but d’informer ou de divertir ou d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale ?
- Ma web TV est-elle établie en Région wallonne ou constituée de programmes en langue française et établie en Région de Bruxelles-Capitale ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, votre déclaration doit être dûment complétée et introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, à l’adresse suivante :
Boulevard de l’Impératrice, 13 à 1000 Bruxelles
| Vidéo à la demande (VOD)
Ces obligations sont inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Certaines règles sont communes à tous les médias dans le but d’assurer au public une protection de base à laquelle il peut légitimement s’attendre face à tout média audiovisuel, quel que soit son support ou son mode de diffusion. D’autres règles sont plus souples parce que vous diffusez sur internet et parce que vous offrez un service à la demande de l’utilisateur.
-
Je dois déclarer mon service de vidéo à la demande auprès du CSA.
-
Je dois faire apparaître sur mon site web quelques mentions légales de transparence, conformément à l’article 6, §1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
L’objectif du décret est de rendre publiques les informations de base me concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans mes programmes.
- Si vous êtes une ASBL, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une société, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une commune ou une autre instance publique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une personne physique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
-
Je dois remplir une fois par an un formulaire fourni par le CSA - appelé le rapport annuel - en communiquant quelques éléments d’informations relatifs au respect de la législation sur le droit d’auteur et droits voisins, à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (seulement si le chiffre d’affaires le permet) et à la mise en valeur des œuvres européennes comprises dans votre catalogue. Le rapport annuel est également l’occasion de signaler au CSA d’éventuelles modifications par rapport aux informations communiquées préalablement dans votre déclaration, ainsi que de signaler les mesures prises en matière de protection des mineurs.
- Je suis enfin tenu de respecter les règles relatives à la dignité humaine et à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité et communication commerciale.
La vidéo à la demande présente un certain nombre d’opportunités en matière d’accessibilité des programmes. La principale est que l’utilisateur peut choisir le moment où il souhaite consulter le programme. Avec le règlement du 17 juillet 2018, l’accessibilité des programmes à la demande aux personnes en situation de déficience sensorielle s’adresse également aux “services non linéaires” . Ce terme désigne les services dont les programmes sont destinés à être reçus au moment choisi par le consommateur sur la base d’un catalogue de programmes à la demande. Les éditeurs de services non linéaires ont l’obligation de tout mettre en œuvre afin que 25% des programmes de leur catalogue soient sous-titrés. La même proportion de programmes audiodécrits est attendue. Les critères de qualité énoncés par la Charte du Collège d’Avis du 26 novembre 2019 s’appliquent également aux contenus à la demande. En savoir plus: https://www.csa.be/accessibilite/
Pour savoir si vous devez déclarer votre service de vidéos à la demande, il faut se poser les deux questions suivantes :
-
Mon service de vidéo à la demande relève-t-il de ma responsabilité éditoriale (c’est-à-dire que j’ai un contrôle sur la sélection des vidéos et sur leur organisation) et son objet principal est-il de communiquer au public des programmes télévisuels (c’est-à-dire des images animées combinées ou non à du son) dans le but d’informer ou de divertir ou d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale ?
- Mon service de vidéos à la demande est-il établi en Région wallonne ou constitué de programmes en langue française et établi en Région de Bruxelles-Capitale ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, votre déclaration doit être dûment complétée et introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, à l’adresse suivante :
Boulevard de l’Impératrice, 13 à 1000 Bruxelles
Si certains contenus vidéos mis en ligne sur internet par des chaînes étrangères ne sont pas accessibles depuis la Belgique, c’est avant tout pour des raisons économiques. En effet, les chaînes ne donnent habituellement accès depuis l’étranger qu’aux vidéos pour lesquelles elles disposent de tous les droits de retransmission. Il s’agit en général des émissions produites en interne, par exemple les journaux télévisés. Si les chaînes étrangères souhaitent diffuser sur internet d’autres contenus vidéo pour lesquels elles ne disposent pas à l’origine de tous les droits de retransmission, elles doivent s’acquitter des droits d’auteur. Cette rémunération s’imposant pour chaque territoire national sur lequel la chaîne entend diffuser ces contenus, le surcoût financier pour la libération de ces droits dans le monde entier est souvent très élevé. La mise à disposition sur internet de l’ensemble des programmes à la demande se limite ainsi généralement au territoire de la chaîne en question. Il est également possible qu’une chaîne dispose des droits exclusifs de diffusion de certaines œuvres sur un territoire et qu’une autre chaîne ait acquis ces mêmes droits pour un autre territoire. Il n’y a donc, de la part de ces chaînes, aucune volonté de censure ni d’entrave à la libre circulation des services. L’explication tient également pour les contenus vidéo de chaînes belges qui seraient inaccessibles sur internet depuis l’étranger.
| Etudes et recherches
Depuis 2011, le CSA réalise un Baromètre de l’Egalité et de la Diversité dans les services de médias audiovisuels actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de dresser un état des lieux de l’égalité et de la diversité dans les différents services sur la base de cinq critères : le genre, l’origine, l’âge, la situation socio-professionnelle et le handicap. Quatre éditions du Baromètre Egalité-Diversité des services télévisuels ont été réalisées entre 2011 et 2017. Les trois premières se sont inscrites dans le cadre du Plan pour la diversité et l’égalité dans les médias audiovisuels qui avait été lancé par la ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de l’Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’édition 2017 s’est inscrite, quant à elle, dans le cadre de nouvelles missions confiées au CSA par le législateur*. En 2019 le CSA a mis en œuvre un nouveau Baromètre consacré aux services radiophoniques. * Depuis 2016 la législation audiovisuelle prévoit en effet que le CSA participe à la réalisation d’une analyse périodique concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Consultez le site consacré aux différents Baromètres Le CSA réalise également toute autre recherche en matière d’égalité et de diversité. En effet, outre les Baromètres, le CSA a mené plusieurs recherches portant sur la question de l’égalité. On citera notamment la recherche relative à l’égalité de genre dans les métiers de l’audiovisuel. Elle vise, en autres, à quantifier la présence des femmes et des hommes dans les métiers de l’audiovisuel ainsi qu’à comprendre leurs trajectoires professionnelles. Ces études sont également disponibles sur le site: https://www.csa.be/egalitediversite
- Le CSA contrôle le respect des dispositions prévues dans le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéo (1) ;
- Le CSA contrôle le respect des dispositions prévues dans le contrat de gestion de la RTBF (2) ;
- Le CSA formule des recommandations et des avis (3) ;
- Le CSA réalise un Baromètre de l’Egalité et de la Diversité (4) ;
- Le CSA réalise toute autre recherche en matière d’égalité et de diversité (5) ;
- Le CSA propose des modules de formations à destination des étudiant.e.s (6) ;
- Le CSA participe à divers projets internationaux, notamment sur les questions d’égalité et de diversité (7).
(1) L’article 2.4-1 du décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéo précise que : « Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : 1° portant atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée sur la base du sexe ou de critères assimilés que sont notamment la grossesse, et la maternité, le changement de sexe, l’expression de genre, l’identité de genre ou contenant des incitations à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique ; 2° comportant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier en raison de la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale ». Le CSA contrôle le respect de ces dispositions et peut, le cas échéant, prendre des décisions de sanction.
(2) Le CSA contrôle le respect des dispositions en la matière prévues dans le contrat de gestion de la RTBF. Consutez la question "Quelles sont les obligations de la RTBF en matière d’égalité et de diversité ?".
(3) Le CSA formule des recommandations en matière d’égalité et de diversité à destination des pouvoirs publics et des acteurs du secteur. Son Collège d’avis remet des avis sur les futurs textes de lois ou politiques de l’audiovisuel à la demande des autorités publiques, notamment en matière d’égalité et de diversité.
(4) Depuis 2011, le CSA réalise un Baromètre de l’Egalité et de la Diversité dans les services de médias audiovisuels actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de dresser un état des lieux de l’égalité et de la diversité dans les différents services sur la base de cinq critères : le genre, l’origine, l’âge, la situation socio-professionnelle et le handicap. Plusieurs éditions du Baromètre Egalité-Diversité des services télévisuels ont été réalisées entre 2011 et 2017. Les trois premières se sont inscrites dans le cadre du Plan pour la diversité et l’égalité dans les médias audiovisuels qui avait été lancé par la ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de l’Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’édition 2017 s’est inscrite, quant à elle, dans le cadre de nouvelles missions confiées au CSA par le législateur*. Enfin, en 2019 le CSA a mis en œuvre un nouveau Baromètre consacré aux services radiophoniques. * Depuis 2016 la législation audiovisuelle prévoit en effet que le CSA participe à la réalisation d’une analyse périodique concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Consultez le site entièrement consacré à ces différentes étude: https://www.csa.be/egalitediversite
(5) Le CSA réalise toute autre recherche en matière d’égalité et de diversité. En effet, outre les Baromètres, le CSA a mené plusieurs recherches portant sur la question de l’égalité. On citera notamment la recherche relative à l’égalité de genre dans les métiers de l’audiovisuel. Elle vise, en autres, à quantifier la présence des femmes et des hommes dans les métiers de l’audiovisuel ainsi qu’à comprendre leurs trajectoires professionnelles. Toutes les études du CSA sont disponibles sur notre site internet.
(6) Le CSA propose des modules de formations à l’égalité et à la diversité. Ils sont dispensés dans les Hautes Ecoles, Universités et Ecoles supérieures artistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de renforcer la formation des futurs professionnels et professionnelles des médias et du cinéma sur la représentation des genres et sur les stéréotypes de genre à l’écran. En savoir plus sur les modules de formation.
(7) Enfin, le CSA participe à divers projets internationaux, notamment sur les questions d’égalité et de diversité. Ainsi, il a piloté le groupe de travail Gender Diversity de l’ERGA. Celui-ci avait pour objectif d’augmenter les connaissances que les autorités de régulation et les acteurs du secteur audiovisuel ont quant aux initiatives existant à travers l’UE destinées à promouvoir l’égalité de genre dans les médias et lutter contre les discriminations. Dans le cadre d’un projet de coopération internationale entre la Tunisie et la Fédération Wallonie-Bruxelles le CSA a réalisé, en partenariat avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA), une recherche relative à la place et à la représentation des femmes dans les fictions télévisuelles.
Le Département Etudes et Recherches du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel poursuit plusieurs objectifs :
- Premièrement, un objectif d’analyse prospective sur le paysage audiovisuel, ses transformations et sur les enjeux régulatoires qui en découlent. Il s’agit de mettre en place des recherches sur un ensemble de thématiques qui se trouvent au cœur de l’activité de régulation : l’égalité et la diversité, la consommation des médias, la communication commerciale, etc. Le département fait connaître les résultats de ces recherches en intervenant à des conférences, des colloques, des cours, des formations, ….
- Deuxièmement, le Département Etudes et Recherches vise à stimuler la recherche sur la régulation, éveiller l’intérêt des étudiants, étudiantes, chercheurs et chercheures sur cette thématique. Il développe des liens entre le CSA et le monde académique, belge et étranger, notamment via l’accueil de stagiaires, le développement d’un centre de documentation, la remise d’un Prix du mémoire, la mise en place d’une newsletter à destination du milieu académique.
- Troisièmement, il s’agit de créer des espaces de dialogue et de débat sur les problématiques qui font l’actualité de l’audiovisuel : colloques et conférences, workshops, séminaires, webinaires, rencontres thématiques avec le secteur, etc.
- Enfin, le dernier objectif est de communiquer de l’information spécialisée sur le secteur au secteur, au monde académique, aux étudiants, étudiantes, chercheurs et chercheures.
Oui, le CSA produit des données sur la consommation des médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles dans ses études « MAP : Médias : Attitudes et Perceptions ». Ces études sont consacrées aux modes de consommation des services de médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles ont pour ambition de proposer une analyse scientifique détaillée des habitudes de consommation de la population et des motifs qui les sous-tendent. Les études MAP répondent ainsi au besoin de disposer d’une vue d’ensemble sur des données telles que, notamment, le nombre et la combinaison d’équipements utilisés, le choix des modes de consommation, la fréquence et la durée de leur consommation, l’existence d’une consommation média simultanée ou encore la substituabilité des modes de consommation. Elles visent à répondre à la question suivante : comment évolue l’utilisation de la télévision avec le développement des nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels ? https://www.csa.be/map/ D’autres études ont été consacrées à la consommation des médias et aux pratiques numériques, parmi lesquelles :
- Le « Digimeter » relatif à la consommation des médias en Flandre : https://www.imec.be/nl/expertises/techtrends/imec-digimeter;
- L’étude #Génération2020 du Conseil Supérieur de l’Education aux Médias (CSEM) relative aux pratiques numériques des jeunes publics : https://www.csem.be/actualite/enquete-generation-2020-resultats
Tous les rapports du CSA ainsi que les études et recherches sur consultables ici : https://www.csa.be/documents/?term=etudes-recherches Les études relatives à l’égalité sont publiées dans la collection Diversité & Egalité : https://www.csa.be/egalitediversite/ Enfin, un site est consacré à l’étude « MAP : Médias : Attitudes et Perceptions » : https://www.csa.be/map/
Le CSA propose des modules de formation à l’égalité à destination des étudiant.e.s en publicité, journalisme et communication, dans les filières artistiques et de l’audiovisuel. Ils se déclinent sous trois formes : Module transversal (1), Egalité à l’écran (2) et Egalité derrière l’écran (3). Ces modules de formation allient à la fois cadre théorique et exercices pratiques afin de fournir aux étudiant.e.s des outils pratiques immédiatement mobilisables dans leurs parcours d’apprentissage et dans leur future vie professionnelle. En savoir plus sur les modules de formation. Le CSA compte également de nombreux experts et expertes sur des matières variées (production audiovisuelle, protection des mineurs, publicité, diversité, accessibilité, dignité humaine, discrimination, transparence, pluralisme, plateformes internet…) disposés et disposées à répondre aux questions des étudiants et étudiantes. Le CSA met à disposition des chercheurs, chercheures, étudiants et étudiantes différentes ressources documentaires. Le centre de documentation du CSA leur offre un fonds documentaire d’ouvrages, de périodiques spécialisés, de ressources audiovisuelles et sonores, qui traversent largement le champ de la régulation audiovisuelle : production audiovisuelle, protection des mineurs, publicité, diversité, accessibilité, dignité humaine, droit à l’information, droit à l’image, discrimination, transparence, pluralisme, télécommunication, plateformes internet, … Le centre propose également à la consultation les rapports d’activités des éditeurs et distributeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les documents publiés par le CSA : avis, décisions, plaintes, contributions dans le cadre de consultations publique. Il est également possible d'y consulter les archives audiovisuelles de l’année écoulée. En savoir plus sur le centre de documentation. Consultez également les questions de notre FAQ relatives au centre de documentation. Enfin, le CSA accueille des étudiants et étudiantes en stage et organise un prix du mémoire. Dans ce contexte, il publie des suggestions de sujets de mémoires qui touchent à l’audiovisuel et sa régulation. En savoir plus sur le prix du mémoire du CSA. Consulter les suggestions de sujets de mémoires.
Le prix du CSA vise à récompenser un mémoire de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long (Master 120 d’une université, haute école ou école supérieure artistique ; Master complémentaire et Master de spécialisation) qui constitue une contribution scientifique originale à la compréhension et à la réflexion sur les enjeux juridiques, économiques, sociologiques, politiques, culturels, technologiques ou créatifs de l’audiovisuel. Le prix, d’une valeur actuelle de 1.500 €, est décerné tous les ans. Pour tout savoir sur les conditions de participation, consultez la page: https://www.csa.be/etudes-et-recherches/prix-du-memoire/
| Le Centre de documentation du CSA
La loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur précise entre autres que l'auteur "dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci" et qu'il a "le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation". Elle rappelle que, sauf accord explicite de l'auteur, sont seules autorisées les courtes citations "effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi [...].Les citations visées devront faire mention de la source et du nom de l'auteur".
Le Centre de documentation du CSA a mis en ligne un blog accessible sur le site du CSA. Son objectif est de permettre aux lecteurs de connaître les nouvelles acquisitions du centre de documentation, les informations générales, et un calendrier des événements. De plus, les lecteurs peuvent s'abonner à la Newsletter afin de rester informés.
Il est également possible de s'abonner à la lettre d'information du CSA.
Parmi les documents en consultation au Centre de documentation figurent les rapports d'activités et des rapports de gestion des éditeurs et de distributeurs de la Communauté française, des contenus audiovisuels (échantillons annuels des radios et télévisions, séquences qui ont fait l'objet d'un instruction...), notamment. Ces documents peuvent revêtir, à la demande des opérateurs, une certaine forme de confidentialité et ne peuvent être consultés que dans le cadre de recherches académiques.
Un catalogue informatisé permet aux lecteurs d'effectuer ses recherches documentaires. Ce catalogue a été créé sur PMB, un logiciel de gestion documentaire open source et gratuit. Il permet de répertorier des documents, jouant ainsi le rôle de catalogue virtuel ou d'une Bibliothèque imaginaire.
PMB permet une recherche précise via un large choix de critères : titre, auteur, éditeur, date, collection, sous-collection, mot-clé, mots compris dans les différents champs, format, cote de l'exemplaire, catégories... Il est aussi possible de croiser plusieurs critères pour cerner exactement le document recherché. Avec sa liste de résultats, le lecteur peut consulter les documents imprimés classés en rayons ; les documents numérisés, quant à eux, sont accessibles via un hyperlien joint à la notice bibliographique.
>> voir également la présentation détaillée du logiciel PMB
Le CSA propose des modules de formation à l’égalité à destination des étudiant.e.s en publicité, journalisme et communication, dans les filières artistiques et de l’audiovisuel. Ils se déclinent sous trois formes : Module transversal (1), Egalité à l’écran (2) et Egalité derrière l’écran (3). Ces modules de formation allient à la fois cadre théorique et exercices pratiques afin de fournir aux étudiant.e.s des outils pratiques immédiatement mobilisables dans leurs parcours d’apprentissage et dans leur future vie professionnelle. En savoir plus sur les modules de formation. Le CSA compte également de nombreux experts et expertes sur des matières variées (production audiovisuelle, protection des mineurs, publicité, diversité, accessibilité, dignité humaine, discrimination, transparence, pluralisme, plateformes internet…) disposés et disposées à répondre aux questions des étudiants et étudiantes. Le CSA met à disposition des chercheurs, chercheures, étudiants et étudiantes différentes ressources documentaires. Le centre de documentation du CSA leur offre un fonds documentaire d’ouvrages, de périodiques spécialisés, de ressources audiovisuelles et sonores, qui traversent largement le champ de la régulation audiovisuelle : production audiovisuelle, protection des mineurs, publicité, diversité, accessibilité, dignité humaine, droit à l’information, droit à l’image, discrimination, transparence, pluralisme, télécommunication, plateformes internet, … Le centre propose également à la consultation les rapports d’activités des éditeurs et distributeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les documents publiés par le CSA : avis, décisions, plaintes, contributions dans le cadre de consultations publique. Il est également possible d'y consulter les archives audiovisuelles de l’année écoulée. En savoir plus sur le centre de documentation. Consultez également les questions de notre FAQ relatives au centre de documentation. Enfin, le CSA accueille des étudiants et étudiantes en stage et organise un prix du mémoire. Dans ce contexte, il publie des suggestions de sujets de mémoires qui touchent à l’audiovisuel et sa régulation. En savoir plus sur le prix du mémoire du CSA. Consulter les suggestions de sujets de mémoires.
Le Centre de documentation du CSA propose une collection unique et en permanente évolution de documents, disponibles dans différents formats (imprimés, numériques, audiovisuels) et scannés sous l'angle spécifique de la régulation audiovisuelle.
Il centralise également diverses informations relatives au secteur de l'audiovisuel dont le nombre d'acteurs et la dispersion géographique compliquent souvent la consultation.
Concrètement, le centre donne accès à :
-
des ouvrages généraux comme les dictionnaires ou encyclopédies, des répertoires et listes d'adresses, des statistiques
- des informations relatives au CSA (rapports d'activité, plaintes, demandes d'information, réponses aux plaintes et aux demandes d'information, documents préparatoires aux travaux du Collège d'avis, rapports d'instruction, rapports d'audition ou de visionnage, avis et décisions des collèges, contributions dans le cadre de consultations et auditions publiques) ;
- des revues et périodiques spécialisés tels Iris, Auteurs et médias, Câble et satellite, Ecran total, Journalistes, Revue du Droit et des Technologies de l'Information, Lectures... ;
- différents contenus audiovisuels (échantillons annuels des radios et télévisions, séquences qui ont fait l'objet d'une instruction...) ;
- des rapports d'activité divers, notamment ceux des éditeurs et distributeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (certains depuis 1994) ainsi que des rapports de gestion ;
- des informations relatives aux autres organes de régulation audiovisuels (rapports d'activité et autres documents écrits) ;
- des actes de congrès, symposiums et colloques ;
- des ouvrages relatifs à l'économie, principalement l'économie de l'audiovisuel ;
- des ouvrages de droit, liés aux différents aspects du droit administratif et du droit de l'audiovisuel ;
- des ouvrages sur la communication, le journalisme, l'information ou sur les médias en général ;
- des ouvrages spécialisés sur des questions en lien avec la régulation et le secteur audiovisuel: aspects techniques et économiques de la distribution, des réseaux et infrastructures, concurrence, accessibilité, dignité humaine, protection des mineurs, multiculturalité, éthique publicitaire, violence, sexisme, analyse du public, analyse des programmes, aspects juridiques de la radio et de la télévision sur le plan national, européen ou international, institutions de la radiotélévision, internet & nouvelles technologies, numérique, cinéma,...
Le Centre de documentation propose également des outils de veille documentaire (Netvibes et Pearltrees) qui regroupent des liens pertinents dans le secteur de l'audiovisuel et de la régulation.


